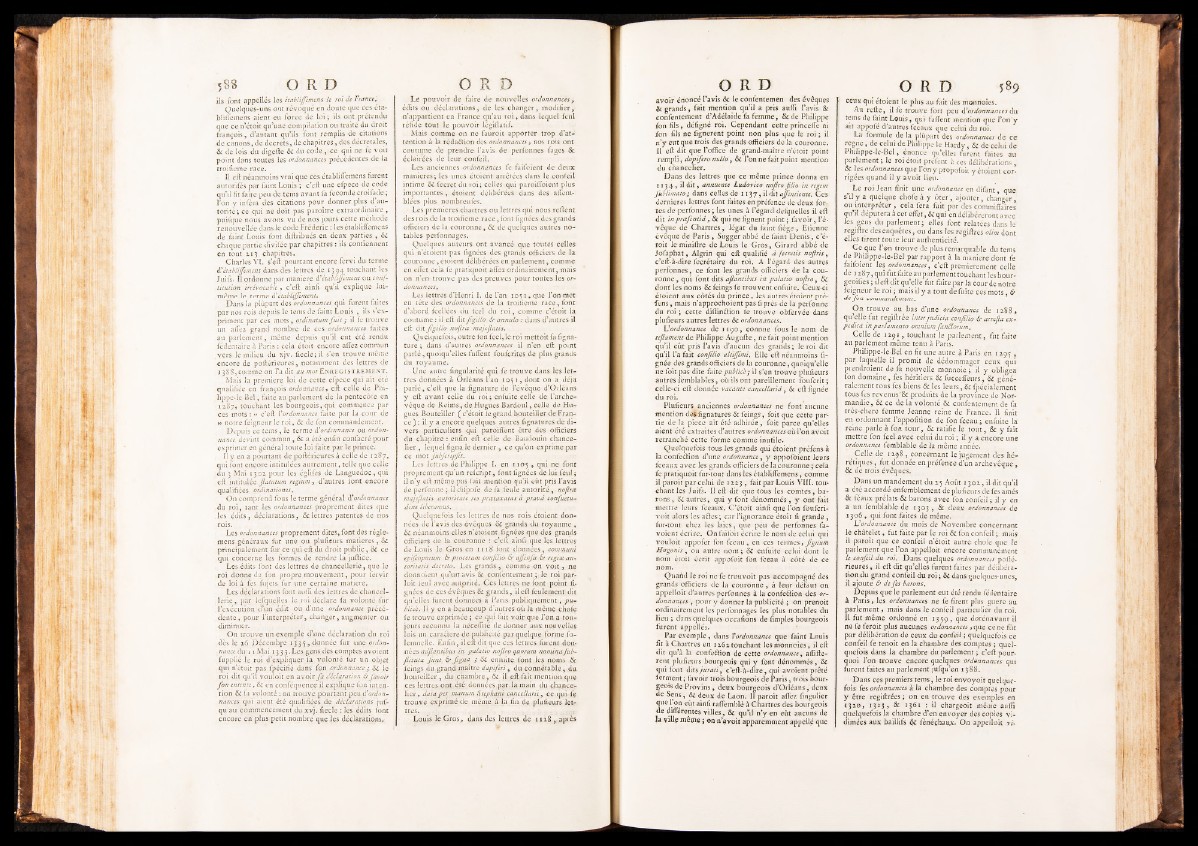
ils font appelles les établiffemens le roi de France
Quelques-uns ont révoqué en doute que ces établiffemens
aient eu force de loi ; ils ont prétendu
que ce n’étoit qu’une compilation ou traité du droit
françois, d’autant qu’ils font remplis de citations
de canons, de decrets, de chapitres, des décrétales,
& de lois du digefte & du code, ce qui ne le voit
point dans toutes les ordonnances précédentes de la
troilieme race.
Il eft néanmoins vrai que ces établiffemens furent
autorifés par faint Louis ; c’eft une efpece de code
qu’il fit faire peu de tems avant fa fécondé croifade ;
l’on y inféra des citations pour donner plus d’autorité
; ce qui ne doit pas paroître extraordinaire ,
puifque nous avons vu de nos jours cette méthode
renouvellée dans le code Frédéric : les établiffemens
de faint Louis font diftribués en deux parties , 6c
chaque partie divifée par chapitres : ils contiennent
en tout 213 chapitres.
Charles VI. s’eft pourtant encore fervi du terme
d'établijfement dans des lettres de 1394 touchant les
Juifs. Il ordonne par maniéré d'établijfement ou constitution
irrévocable > c’eft ainfi qu’il explique lui-
même le terme d'établiffement.
Dans la plupart des ordonnances qui furent faites
par nos rois depuis le tems de faint Louis , ils s’expriment
par ces mots, ordinatum fuit ; il fe trouve
un affez grand nombre de ces ordonnances faites
au parlement, même depuis qu’il eut été rendu
fédentaire à Paris : cela était encore affez commun
.vers le milieu du xjv. fiecle;il s’en trouve même
encore de poftérieures, notamment des lettres de
1388, comme on l’a dit au mot Enregistremen t.
Mais la première loi de cette efpece qui ait été
qualifiée en françois ordonnance, eft celle de Phi-
lippe-le Bel, faite au parlement de la pentecôte en
1x875 touchant les bourgeois, qui commence par
ces mots : » c’eft l'ordonnance faite par la cour de
» notre feigneur le roi, & de fon commandement.
Depuis ce tems, le terme d'ordennance ou ordonnance
devint commun, & a été enfin confacré pour
exprimer en général toute loi faite par le prince.
II y en a pourtant de poftérieures à celle de 1287,
qui font encore intitulées autrement, telle que celle
du 3 Mai 1302 pour les églifes de Languedoc, qui
eft intitulée fatutum regiurn, d’autres font encore
qualifiées ordinationes.
On comprend fous le terme général d’ordonnance
du roi, tant les ordonnances proprement dites que
. les édits, déclarations, & lettres patentes de nos
rois.
Les ordonnances proprement dites, font des régle-
mens.généraux fur une ou plufieurs matières, &
principalement fur ce qui eft du droit public, 6c ce
qui concerne les formes de rendre la juftice.
Les édits font des lettres de chancellerie, que le
roi donne de fon propre.mouvement, pour lervir
de loi à fes fujets fur une certaine matière.
Les déclarations fpnt auffi des lettres de chancellerie,
par lefquelles le roi déclare fa volonté fur
l’exécution d’un édit ou d’une ordonnance précédente,
pour l’interpréter, changer, augmenter ou
diminuer.
On trouve un exemple d’une déclaration du roi
dès le xfi Décembre 13 35., donnée une ordonnance
du i 1 Mai 1333.Les gens,dps comptes avoient
fupplié le roi d’expliquer fa volonté fur un objet
qui n’étoit pas fpécifié dans fon ordonnance ; 6c je
roi dit qu'il voiiloit en avoirfa déclaration & Javoir
fon entente, 6c en conféquence il explique fon intention
6c fa volonté : on trouve pourtant peu ^ordonnances
qui aient été qualifiées de déclarations juf-
qu'au commencement du xvj. fiecle : les édits font
encore en plus petit nombre que les déclaratiçns,
Le pouvoir de faire de nouvelles ordonnances,
édits ou déclarations, de les changer, modifier,
n’appartient en France qu’au ro i, dans lequel feul
réfide tout le pouvoir légiflatif.
Mais comme on ne fauroit apporter trop d’attention
à la rédaction des ordonnances, nos rois ont
coutume de prendre l’avis de perfonnes fages &
éclairées de leur confeil.
Les anciennes ordonnances fe faifoient de deux
maniérés; les unes étoient arrêtées dans le confeil
intime 6c fecret du roi ; celles qui paroiffoient plus
importantes, étoient délibérées dans des affem-
blées plus nombreufes.
Les premières Chartres ou lettres qui nous reftent
des rois de la troifieme race, font fignées des grands
officiers de la couronne, 6c de quelques autres notables
perfonnages.
. Quelques auteurs ont avancé que toutes celles
qui n’étoient pas fignées des grands officiers de la
couronne, étoient délibérées en parlement, comme
en effet cela le pratiquoit affez ordinairement, mais
on n’en trouve pas des preuves pour toutes les ordonnances.
.
Les lettres d’Henri I. de l’an 1051, que l’on met
en tête des ordonnances de la troilieme race, font
d’abord fcellées du fcel du ro i, comme c’étoit la
coutume : il eft ditfigiLLo & atinulo : dans d’autres il
eft dit figillo noflrce majeflatis.
Quelquefois, outre fon fcel, le roi mettoit fa figna-
ture ; dans d’autres ordonnances il n’en eft point
parlé, quoiqu’elles fuffent loufcrites de plus grands
du royaume.
Une autre fingularité qui fe trouve dans les lettres
données à Orléans l’an 1051, dont on a déjà
parlé, c’eft que la fignature de l’évêque d’Orléans
y eft avant celle du roi ; enfuite celle de l’archevêque
de Reims, de Hugues Bardoul, celle de Hugues
Bouteiller ( c’étoit le grand bouteiller de France
) : il y a encore quelques autres fignatures de divers
particuliers qui paroiffent être des officiers
du chapitre : enfin eft celle de Baudouin chancelie
r , lequel figna le dernier, ce qu’on exprime par
ce mot Jubfcripfit.
Les lettres de Philippe I. en x 105 , qui ne font
proprement qu’un refcript, fontfignées de lui feul ;
il n’y eft même pas fait mention qu’il eût pris l’avis
de perfonne ; il difpole de fa feule autorité, noflrce
majefatis autoritate res prcetaxatas a pravâ confuetu-
dine libera mus...
Quelquefois les lettres de nos rois étoient données
de l’avis des évêques 6c grands du royaume ,
6c néanmoins elles n’étoient fignées que des grands
officiers de la couronne : c’eft ainfi que les lettres
de Louis le Gros en 1118 font données, comrnuni
epifcoporuni 6" procerum conjîlio & affenfu & regice.au-
toriuuis decreto. Les grands, cpmme On v o it , ne
donnoient qu’un avis & confentement,;; le roi'partait
feul avec autprité. Ces lettres ne font point fignées
de ces évêques 6c grands, il eft feulementtdit
qu’elles furent données à Paris publiquement, pu-
blicl. Il y en a beaucoup d’autres où la même chofe
fe trouve exprimée ; ce qui fait voir que l’on a toujours
reconnu la néceffité de donner aux nouvelles
.lois un caractère de publicité par quelque forme fo-
lemnelle. Enfin, il eft dit que ces lettres furent données
adfiantibus in palatio noflro quorum nonùnafub-
Jlituta fupt, & figna ,• 6c entui.te font les noms ,6c
fieings .du,grand maître dapiferi, du connétable, du
bouteiller, du chambre, 6c il eft, fait mention que
ces lettres.ont été données par. la main du ç.hancer
lier, data per manum Stéphane ca/icellarii, ce qui. fe
trouve exprimé de même à la fin de plufieurs lettres.
...,
Louis le Gros, dans des lettres de 1128 , après
avoir énoncé l’avis 6c le confentemen des évêques
& grands, fait mention qu’il a pris auffi l’avis &
confentement d’Adélaïde fa femme, & de Philippe
fon fils, défigné roi. Cependant cette princeffe ni
fon fils ne lignèrent point non plus que le roi ; il
n’y eut que trois des grands officiers de la couronne.
Il eft dit que l’office de grand-maître n’étoir point
rempli, dapifero nullo, 6c l’on ne fait point mention
du chancelier.
Dans des lettres que ce même prince donna en
1 13 4 , il d it, annuente Ludovic0 nofiro filio- in regern
Jubliniato; dans celles de 1 13 7 , il dit ajféntiente. Ces
dernieres lettres font faites en préfence de deux for«
tes de perfonnes ; les unes à l’égard defqueUes il eft
dit inpreefentiâ , & qui ne lignent point ; favoir, l’évêque
de Chartres, légat du faint fiége, Etienne
évêque de Paris, Sugger abbé de faint Denis, c ’é-
toit le miniftre de Louis le Gros, Girard abbé de
Jofaphat, Algrin qui eft qualifié à fecrais nofiris,
c’eft-à-dire fecrétaire du roi. A l’éga-rd- des autres
perfonnes, ce font les grands officiers de la couronne
, qui font dits afiantibus in palatio noflro, 6c
dont les noms &feings fe trouvent enfuite. Ceux-ci
étoient aux côtés du prince, les autres étoient pré-
•fens, mais n’approchoient pas fi près de la perfonne
du roi ; cette diftinftion le trouve obfervée dans
plufieurs autres lettres 6c ordonnances.
L’ordonnance de 1190 , connue fous le nom de
tefiament de Philippe Augnfte, ne fait point mention
qu’il eût pris l’ayis d’aucun des grands ; le roi dit
qu’il l’a fait conjîlio ahiffimi. Elle eft néanmoins lignée
des grands officiers de la couronne, quoiqu’elle
ne foit pas dite faite publich; il s’en trouve plufieurs
autres femblables, où ils ont pareillement fouferit ;
celle-ci eft donnée vacante canccllariâ, & eft lignée
du roi.
Plufieurs anciennes ordonnances ne font aucune
mention de&fignatures & feings, foit que cette partie
de la piece ait été adhirée, foit parce qu’elles
aient été extraites d’autres ordonnances où l’on avoit
retranché cette forme comme inutile.
Quelquefois tous les grands qui étoient préfensà
la confection d’une ordonnance, y appoloient leurs
lceaux avec les grands officiers de la couronne ; cela
fe pratiquoit fur-tout dans les établiffemens, comme
il paroît par celui de 1223 , fait par Louis VIII. tou1
chant les Juifs. Il eû dit que tous les comtes, barons
, 6c autreSy qui y font dénommés , y ont fait
mettre leurs lceaux. C ’étoit ainfi que l’on fouferi-
voit alors les aftes ; car l’ignorance étoit fi grande,
fur-tout chez les lares, que peu de perfonnes fa-
voient écrire. On faifoic écrire le nom de celui qui
vouloit appofer fon fceau, en ces termes, fignum
Hugonis, ou autre nom ; 6c enfuite celui dont le
nom étoit écrit appofoit fon fceau à côté de ce
nom.
Quand le roi ne fe trouvoit pas accompagné des
grands officiers de la couronne, à leur défaut on
appelloit d’autres perfonnes à la confection des ordonnances
, pour y donner la publicité ; on prenoit
ordinairement les perfonnages les plus notables du
lieu ; dans quelques occafions de fimples bourgeois
furent appellés.
Par exemple, dans l'ordonnance que faint Louis
fit à Cha rtres en 1262touchant lesmonnoies, il eft
dit qu’à la confection de cette ordonnance, affifte-
rent plufieurs bourgeois qui y font dénommés, &
qui font ditsjuraci, c ’eft-à-dire, qui avoient prêté
ferment ; favoir trois bourgeois de Paris, trois bourgeois
de Provins, deux bourgeois d’Orléans, deux
de Sens, 6c deux de Laon. Il paroît affez fingulier
que I on eût ainfi raffemblé à Chartres des bourgeois
de différentes villes, & qu’il n’y en eût aucuns de
la ville m ê m e ; on n’avoit apparemment appelle que
ceux qui étoient le plus au fait des monnioies.
Au refte, il fe trouve fort peu d’ordonnance s du
tems de faint Louis, qui faffent mention que l’on'y
ait appelé d’autres fceaux que celui du roi.
La formule de la plûpart des ordonnances de ce
régné, de celui de Philippe le Hardy, & de celui de
Phihppe-Ie-Bel, énonce qu’elles furent faites au
parlement; le roi étoit préfent à ces délibérations,
& les ordonnances que l’on y propofoit y étoient corrigées
quand il y avoit lieu.
Le roi Jean finit une ordonnance en difant, que
s’il y a quelque chofe à y ôte r, ajouter, changer,
ou interpréter , cela fera fait par des commiffaires
qu’il députera à cet effet, & qui en délibéreront avec
les gens.du parlement; elles font relatées dans le
regiftre des enquêtes, ou dans les regiftres olim dont
elles tirent toute leur authenticité.
Ce que l’on trouve de plus remarquable du tems
de^ Philippe-Ie-Bel par rapport à la maniéré dont fe
faifoient les ordonnances, c’eft premièrement celle
de 1287, qui fut faiteau parlement touchant les bour-
geoifies ; il eft dit qu’elle fut faite par la cour de notre
feigneur le roi ; mais il y a tout de fuite ces mots, &
de fon commandement.
On trouve au bas d’une ordonnance de 1288,
qu’elle fut regiftrée inter judicia conjîlio & arrefla ex-
pédita in parlamento omnium Janclorum.
Celle de 1291 , touchant le parlement, fut faite
au parlement même tenu à Paris.
Philippe-le-Bel en fit une autre à Paris en 1205 ,
par laquelle il promit de dédommager ceux qui
prendroient de fa nouvelle monnoie ; il y obligea
fon domaine, fes héritiers & fucceffeurs, 6c généralement
tous fes biens 6c les leurs, 6c fpéeialement
tous fes revenus 6c produits de la province de Normandie,
6c ce de la volonté 6c confentement de fa
très-chere femme Jeanne reine de France. Il finit
en ordonnant l’appofition de fon fceau ; enfuite la
reine parle à fo.n tour, 6c ratifie le tput, & y fait
mettre fon fcel avec celui du roi ; il y a encore une
ordonnance femblable de la même année.
; Celle de 1298 , concernant le jugement des hérétiques,
fut donnée en préfence d’un archevêque,
6c de trois évêques. ,
Dans un mandement du 25 Août 1302, il dit qu’il
a été accordé enfemblement de plufieurs de fes amés
& féaux prélats 6c barons avec fon confeil ; il y en
a un femblable de 1303 , & deux ordonnances de
1306, qui font faites de même.
L'ordonnance du mois de Novembre concernant
le châtelet, fut faite par le roi 6c fon confeil ; mais
il paroît que ce confeil n’étoit autre chofe que le
parlement que l ’on appelloit encore communément
le confeil du roi. Dans quelques ordonnances poftérieures,
il eft dit qu’elles furent faites par délibération
du grand conleil du roi ; & dans quelques-unes,
il ajoute & de fes barons.
Depuis que le parlement eut été rendu fédentaire
à Paris, les ordonnances ne fe firent plus guere au
parlement, mais dans le confeil particulier du roi;
Il fut même ordonné en 13Ç9, que dorénavant il
ne fe feroit plus aucunes ordonnances, que ce ne fût
par délibération de ceux du confeil ; quelquefois ce
confeil fe tenoit en la chambre des comptes ; quelquefois
dans la chambre du parlement ; c’eft pourquoi
l’on trouve encore quelques ordonnances qui
lurent faites au parlement jufqu’en 13 88.
Dans ces premiers tems, le roi envoyoir quelquefois
fes ordonnances à la chambre des comptes pour
y être regiftrées ; on en trouve des exemples en
1320, 1323, & 136* : il chargeoit même auffi
quelquefois la chambre d’en envoyer des copies vi-
dimées aux baillifs 6c fénéchaux. On appelloit vi