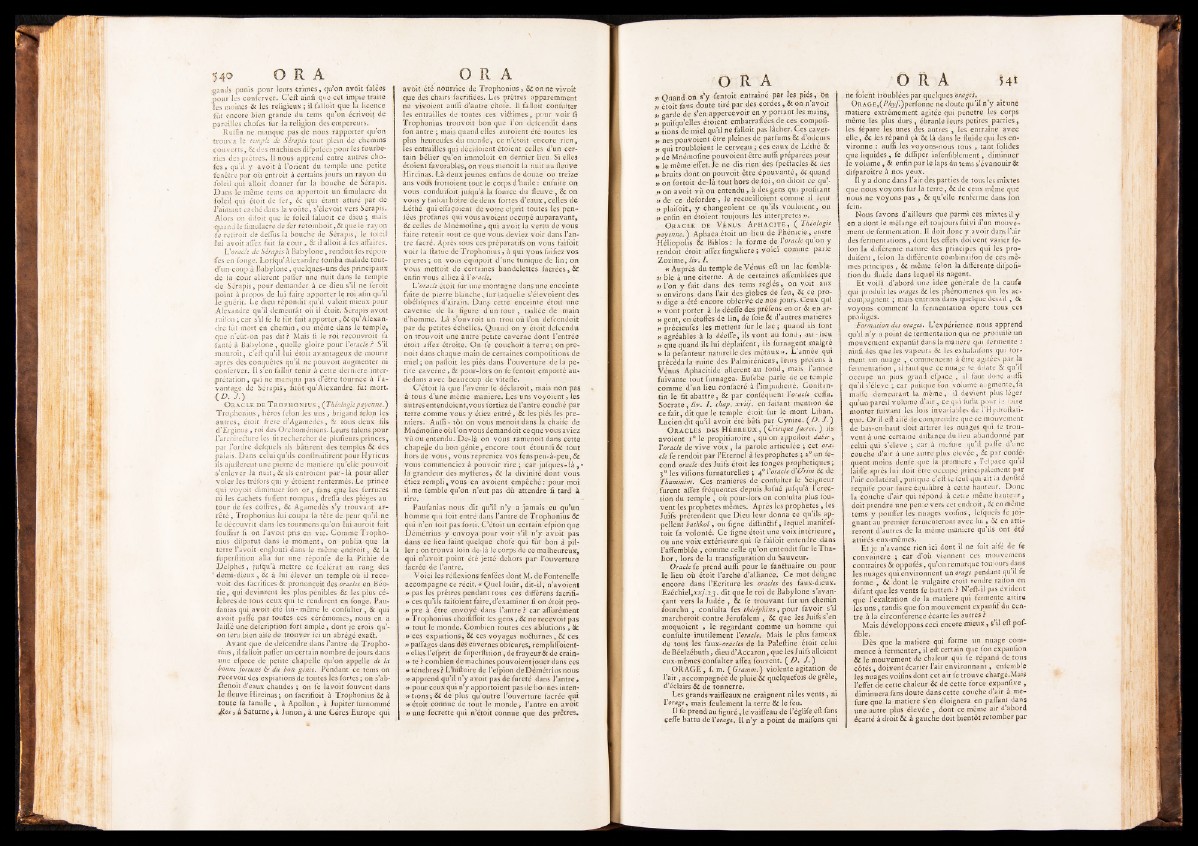
^ 4 ° O R A
panels punis pour leurs crimes, qu’on avoit falees
pour les conferver. C ’eft ainfi que cet impie traite
les moines & les religieux ; il falloit que la licence
fut encore bien grande du tems qu’on écrivait de
pareilles chofes lur la religion des empereurs.
Ruffin ne. manque pas de nous rapporter qu’on
trouva le temple de Sérapis tout plein de chemins
couverts, 6c des machines difpolées pour les fourberies
des prêtres. Il nous apprend entre autres ebo-
fe s , qu’il y avoit à l’orient du temple une petite
fenêtre par où entroit à certains jours un rayon du
foleil qui alloit donner fur la bouche de Sérapis.
Dans le même tems on apportoit un fimulacre du
foleil qui étoit de fer, & qui étant attiré par de
l ’aimant caché dans la voûte, s’élevoit vers Sérapis.
Alors on diloit que le foleil faluoit ce dieu ; mais
•quand le fimulacre de fer retomboit,&que le rayon
fe retiroit de deflus la bouche de Sérapis, le loleil
lui avoit allez fait fa cou r, & il alloit à les affaires.
L'oracle de Sérapis à Babylone, rendoit fes réponses
en fonge. Loriqu’Alexandre tomba malade tout-
ff’un-coup à Babylone, quelques-uns des principaux
<le 1a cour allèrent paffer une nuit dans le temple
■ de Sérapis, pour demander à ce dieu s’il ne feroit
point à propos de lui faire apporter le roi afin qu’il
le guérît. Le dieu répondit qu’il valoir mieux pour
Alexandre qu’il demeurât oii il étoit. Sérapis avoit
rai l’on ; car s’il fe le fût fait apporter, ôcqu’Alexan-
dre fut mort en chemin, ou même dans le temple,
que n’eût-oh pas dit ? Mais fi le roi recouvroit fa
fanté à Babylone, quelle gloire pour Voracle ? S’il
mouroit, c’eft qu’il lui étoit avantageux de mourir
après des conquêtes qu’il ne pouvoit augmenter ni
conferver. Il s’en fallut tenir à cette dermere interprétation
, qui ne manqua pas d’être tournée à l’avantage
de Sérapis, fitôt qu’Alexandre fut mort.
( D . J .)
O racle de T rophonius , (Théologiepayenne.')
Trophonius, héros félon les uns, brigand félon les
■ autres, étoit frere d’Agamedès, & tous deux fils
d’ Erginus , roi des Orchoméniens. Leurs talens pour
l ’architeélure les fit rechercher de plufieurs princes,
par l’ordre defquels ils bâtirent des temples 6c des
palais. Dans celui qu’ils conftruifirentpour Hyricus
■ ils ajufterent une pierre de maniéré qu’elle pouvoit
s’enlever la nuit; & ils entroient par-là pour aller
voler les tréfors qui y étoient renfermés. Le prince
qui voyoit diminuer fon o r , fans que les ferrures
ni les cachets fuffent rompus, dreffa des pièges au
tour de fes coffres, & Agamedès s’y trouvant arrêté
, Trophonius lui coupa la tête de peur qu’il ne
le découvrit dans les tourmens qu’on lui auroit fait
fouffrir fi on l’avoit pris en vie. Comme Trophonius
difparut dans le moment, on' publia que la
terre l’avoit englouti dans le même endroit, 6c la
fuperftition alla fur une réponfe de- la Pithie de
Delphes, jufqu’à mettre ce fcélérat au rang des
' demi-dieux, & à lui élever un temple oit il recevoit
des facrifices & prononçoit des oracles en Béo-
tie, qui devinrent les plus pénibles 6c les plus célébrés
de tous ceux qui fe rendirent en fonge. Pau-
fanias qui avoit été lui-même le confulter, & qui
avoit pafle par toutes ces cérémonies, nous en a
laiffé une description fort ample, dont je crois qu’on
fera bien ailé de trouver ici un abrégé exaâ.
Avant que de defcendre dans l’antre de Trophonius,
il falloir paffer un certain nombre de jours dans
une efpece de petite chapelle qu’on appelle de la
bonne fortune & du bon génie. Pendant ce tems on
recevoit des expiations de toutes les fortes ; on s’ab-
itenoit d’eaux chaudes ; on fe lavoit fouvent dans
le fleuve Hircinas; on facrifioit à Trophonius 6c à
toute fa famille , à Apollon , à Jupiter furnommé
R o i , à Saturne, à Junon, à une Cérès Europe qui
O R A
avoit été nourrice de Trophonius, & on ne vivoît
que des chairs facrifiées. Les prêtres apparemment
ne vivoient auffi d’autre chofe. 11 falloir confulter
les entrailles de toutes ces viéfimes, pour voir fi
Trophonius trouvoit bon que l’on delcendît dans
fon antre ; mais quand elles auroient été toutes les
plus heureufes du monde, ce n’étoit encore rien,
les entrailles qui décidoient étoient celles d’un certain
bélier qu’on immoloit en dernier lieu. Si elles
étoient favorables, on vous menoit la nuit au fleuve
Hircinas. Là deux jeunes enfans de douze ou treize
ans vous frottoient tout le corps d’huile : enfuite on
vous conduifoit jufqu’à la fource du fleuve , 6c on
vous y faifbit boire de deux fortes d’eaux, celles de
Léthé qui effaçoient de votre efprit toutes les pen-
fées .profanes qui vous avoient occupé auparavant,
6c celles de Mnémofine, qui avoit la vertu de vous
faire retenir tout ce que vous deviez voir dans l’antre
facré. Après tous ces préparatifs on vous faifoit
voir la ftatue de Trophonius, à qui yous faifiez vos
prières; on vous équipoit d ’une tunique de lin; on
vous mettoit de certaines bandelettes fa c ré e s ,&
enfin vous alliez à Voracle.
L ’oracle étoit fur une montagne dans une enceinte
faite de pierre blanche, lur laquelle s’élevoient des
obélifques d’airain. Dans cette enceinte étoit une
caverne de la figure d'un four , taillée de main
d’homme. Là s’ouvroit un trou où l’on defeendoit
par de petites échelles. Quand on y étoit defeendu
on trouvoit une autre petite caverne dont l ’entrée
étoit affez étroite. On fe couchoit à terre ; on pre-
noit dans chaque main de certaines compofitions de
miel ; on paffoit les piés dans l’ouverture de la petite
caverne, & pour-lors on fe fentoit emporté au-
dedans avec beaucoup de vîteffe.
C ’étoit là que l’avenir fe déclaroit, mais non pas
à tous d’une même maniéré. Les uns voyoient, les
autres entendoient,vous fortiez de l’antre couché par
terre comme vous y étiez entré, 6c les piés les pre-
„ miers. Aulfi - tôt on vous menoit dans la chaife de
Mnémofine oit l ’on vous demandoit ce que vous aviez
vû ou entendu. De-là on vous ramenoit dans cette
chapelle du bon génie, encore tout étourdi 6c tout
hors de vous, vous repreniez vos fenspeu-à-peu, &
vous commenciez à pouvoir rire ; car jufques-là ,•
la grandeur des mylteres, 6c la divinité dont vous
étiez rempli, vous en avoient empêché: pour moi
il me femble qu’on n’eut pas dû attendre fi tard à
rire.
Paufanias nous dit qu’il n’y a jamais eu qu’un
homme qui foit entré dans l’antre de Trophonius 6c
qui n’en foit pasforti. C ’étoit un certain efpionque
Démétrius y envoya pour voir s’il n’y avoit pas
dans ce lieu faint quelque chofe qui fût bon à piller
: on trouva loin de-là le corps de ce malheureux,
qui n’avoit point été jetté dehors par l’ouverture
facrée de l’antre.
Voici les réflexions fenfées dont M. de Fontenelle
accompagne ce récit. « Quel loifir, dit-il, n’a voient
» pas les prêtres pendant tous ces différens facrifi-
» ces qu’ils faifoient faire, d’examiner fi on étoit pro-
» pre à être envoyé dans l’antre ? car affurément
» Trophonius choififfoit les gens, & ne recevoit pas
» tout le monde. Combien toutes ces ablutions , 6c
» ces expiations, 6c ces voyages no&urnes, 6c ces
» paffages dans des cavernes oblèures, rempliffoient-
» elles l’efprit de fuperftition, de frayeur & de crain-
» te ? combien de machines pouvoient jouer dans ces
» ténèbres ? L ’hiftoire de l’elpion deDémétrius nous
» apprend qu’il n’y avoit pas de fureté dans l’antre,
» pour ceux qui n’y apportoient pas de bonnes intent
i o n s ; & de plus qu’outre l’ouverture facrée qui
» étoit connue de tout le monde, l’antre en avoit
» une fecrette qui n’étoit connue que des prêtres.
° R A 54*
fi Quand bn s’y fentoit entraîné par les piés, On
» étoit fans doute tiré par des cordes, & on n’avoit
» garde de s’en apperçevoir en y portant les mains,
» puifqu’elles étoient embarraffées de ces compofi-
» fions de miel qu’il ne falloit pas lâcher. Ces caver-
» nés pouvoient être pleines de parfums 6c d’odeurs
» qui troubloient le cerveau ; ces eaux de Léthé &
fi de Mnémofine pouvoient être auffi préparées pour
le même effet. Je ne dis rien des fpe&acles 6c des
» bruits dont on pouvoit être épouvanté, 6c quand
fi on fortoit de-là tout hors de lo i , on diloit ce qu’-
» on avoit vu ou entendu, à des gens qui profitant
«d e ce defordre, le recueillofent comme il leur -
fi plaifoit , y changeoient ce qu’ils voulaient, ou
fi enfin en étoient toujours les interprètes ». ^
Or a c le de V én.us A p h a c it e , ( Théologie
payenne.) Aphaca étoit un lieu de Phenicie, entre
Héliopolis 6c Bibles: la forme de Voracle qu’on y
rendoit étoit affez fingulier.e ; voici comme parle
Zozime, liv. I. , .
«Auprès du temple de Vénus eft un lac lemb.a-
fi ble à une citerne. A de certaines affemblées que
» l’on y fait dans des tems réglés, on v,oit aux
« environs dans l’air des globes de feu, 6c ce pro-
» dige a été encore obfervé de nos jours. Ceux qui
» vont porter à la déeffe des préfens en or & en ar-
» gent, en étoffes de lin, de foie ôc d autres matières
» précicufes les mettent fur le lac ; quand ils font
» agréables à la déeffe, ils vont au fond, au-lieu
» que quand ils lui déplaifent, ils furnagent malgie
« la pefanteur naturelle des métaux ». L annee qui
précéda la ruine des Palmireniens, leurs préviens à
Vénus Aphacitide allèrent au fond, mais l’année
fuivante tout furnagea. Eufebe parle de ce temple
comme d’un lieu confacré à l’impudicité. Conftan-
tin le fit abattre, & par conféquent l’oracle ceffa.
Socrate, liv. I. chap, xviij. en tailant mention de
ce fait, dit que le temple éroit fur le mont Liban.
Lucien dit qu’il avoit été bâti par Cyriire. (D . J. )
O r a cle s des Hé b r eu x , (■ Critique Jacrée. ) ils
avoient i° le propitiatoire , qu on appelloit dabir,
l’oracle de vive v o ix , la parole articulée ; cet oracle
fe rendoit par l’Eternel à fes prophètes ; i ° un fécond
oracle des Juifs étoit les fonges prophétiques ;
3° les vifions furnaturelles ; r f Ÿ oracle d Urirn ÔC de
Thummim. Ces maniérés de confulter le Seigneur
J furent affez fréquentes depuis Jofué jufqu’à l’érection
du temple , où pour-lors on confulta plus fou-
vent les prophètes mêmes. Après les prophètes , les
Juifs prétendent que Dieu leur donna ce qu ils appellent
bathkol, ou figne diftin&if, lequel manifef-
toit fa volonté. Ce figne étoit une voix intérieure,
ou une voix extérieure qui fe faifoit entendre dans
l’affemblée, comme celle qu’on entendit fur le Tha-
b o r , lors de la transfiguration du Sauveur.
Oracle fe prend auffi pour le fanéluaire ou pour
le lieu où étoit l’arche d’alliance. Ce mot défigne
encore dans l’Ecriture les oracles des faux-dieux.
Ezéchiel,xx/.2j. dit que le roi de Babylone s’avançant
vers la Judée , & fe trouvant fur un chemin
fourchu , confulta fes théréphins, pour favoir s’il
marcheroit contre Jérufalem , & que les Juifs s’en
moquoient , le regardant comme un homme qui
confulte inutilement, ^oracle. Mais le plus fameux
de tous les faux-oracles de la Paleftine étoit celui
de Béelzébuth, dieu d’Accaron, que les Juifs alloient
eux-mêmes confulter affez fouvent. ( D . J . )
O R AG E , f. m. ( Gramm.) violente agitation^de
l’air, accompagnée de pluie 6c quelquefois de grêle,
d’éclairs & de tonnerre.
Les grands vaiffeaux ne craignent ni les vents, ni
Vorage, mais feulement la terre 6c le feu.
Il fe prend au figuré, le vaiffeau de l’églife eft fans
ceffe battu de Vorage. Il n’y a point de maifons qui
O R A
ne foieht troublées par quelques orages.
O rage,(RAjj'/^perfonne ne doute qu’il n’y ait une
matière extrêmement agitée qui pénétré les corps
même les plus durs , ébranle leurs petites parties,
les fépare les unes des autres , les entraîne avec
elle, 6c les répand çà 6c là dans le fluide qui les environne
: auffi les voyons-nous tous , tant folidei
que liquides , fe diffiper infenfiblement, diminuer
le yolume , & enfin par le laps du tems s’évanouir &
difparoître à nos yeux.
Il y a donc dans l’air des parties de tous les mixtes
que nous voyons fur la terre, 6c de ceux même que
nous ne voyons pas , & qu’elle renferme dans loti
fein.
Nous favons d’ailleurs que parmi ces mixtes il y
en a dont le mélange eft toujours fuivi d’un mouvement
de fermentation. Il doit donc y avoir dans l’air
des fermentations , dont les effets doivent varier félon
la différente nature des principes qui les pro-
duilent, lelon la différente combinaifon de ces mêmes
principes , 6c même félon la différente difpofi-
tion du fluide dans lequel ils nagent.
Et voilà d’abord une idée générale de la caufi#
qui jîjoduit tes orages 6c les phénomènes qui les accompagnent
; mais entrons dans quelque détail , &
voyons comment la -fermentation opéré tous ces
prodiges. T, .
Formation des orages. L expérience nous apprend
qu’il n’y a point de fermentation qui ne produite un
mouvement expanfif dans la matière qui fermente :
ainfi dès que les vapeurs & les exhalaifons qui forment
un nuage , commencent à être agitées par la
fermentation , il faut que ce nuage te dilate & qu’il
occupe un plus grand elpace , il faut donc auffi
qu’il s’élève ; car puilque fon volume augmente, fa
malle demeurant la même, il devient plus léger
qu’un pareil volume d’air, ce qui luffit pour le-taire
monter fuivant les lois invariables de l’Hydroftati-
que. Or il eft ailé de comprendre que ce mouvement
de bas-en-haut doit attirer les nuages qui fe trouvent
à une certaine diftance du lieu abandonné par
celui qui s’élève ; car à mefure qu’il pafle d’une
couche d’a:r à une autre plus élevee , 6c par confe-
quent moins dente que la première, l’elpace qu’il
làiffe après lui, doit être occupé principalement par
l’air collatéral, puilque c’eft le (èul qui ait la denfite
requife pour faire équilibre à cette hauteur. Donc
la couche d’air qui répond à cetie même hauteur,
doit prendre une pente vers cet endroit, 6c en rtieme
tems y pouffer les nuages voifins, lefquels fe joignant
au premier fermenteront avec lui, & en attireront
d’autres de la même maniéré qu’ils ont été
attirés eux-mêmes.
Et je n’avance rien ici dont il ne foit aife de fe
convaincre ; car d’où viennent ces mouvemens
contraires & oppofés, qu’on remarque toujours dans
les nuages qui environnent un orage pendant qu il fe
forme , 6c dont le vulgaire croir rendre raifon en
difant que les vents fe battem ? N’eft-il pas évident
que l’exaltation de la matière qui fermente attire
les uns, tandis que fon mouvement expanfif du centre
à la circonférence écarte les autres ? ^
Mais développons ceci encore mieux, s il eft pof-
fible.
Dès que la matière oui forme un nuage commence
à fermenter, il eft certain que fon expanfion
6c le mouvement de chaleur qui fe répand de tous
côtés, doivent écarter l’air environnant, enfemble
les nuages voifins dont cet air le trouve chargé.Mais
l’effet de cette chaleur 6c de cette force expanfive ,
diminuera fans doute dans cette couche d’air à mefure
que la matière s’en éloignera en paffant dans
une autre plus élevée , dont ce même air d’abord
écarté à droit 6c à gauche doit bientôt retomber par