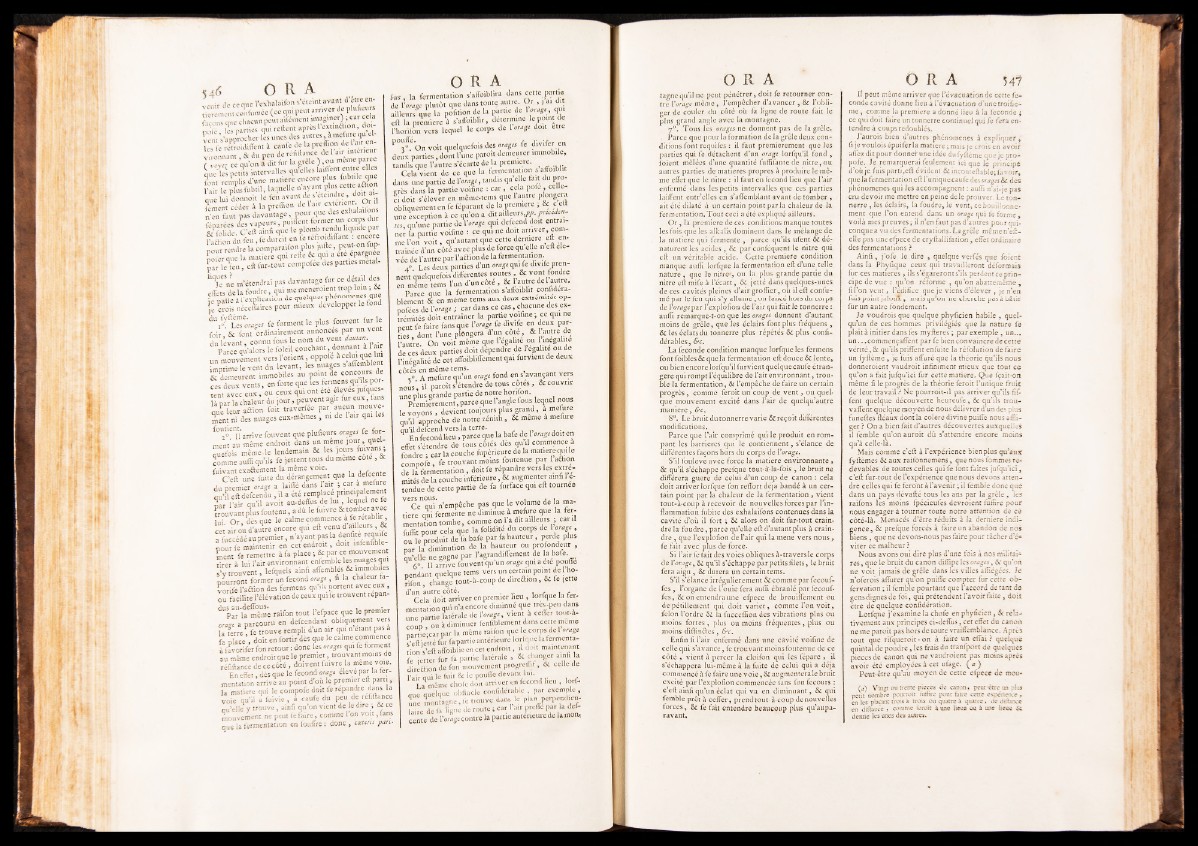
546 O R A
venir i t ce que lkxhalaifon s’éteint avant d’être en-
de,entant canfumée (ce qui peut arriver de « M i
façons que chacun peut ailement imaginer), car cela
p o S , les parties qui relient après l’extma.on dot-
vent s’approcher les unes des autres, èmefure qu el-
les te rétroidiffent à caufe de la preffion de l an en-
vironmnt, & du peu de réfiftance de 1 air intérieur
r »v" cè’qu’on ! dit fur la grêle ) ou même parce
L e t e petits intervalles qu’elles la.ilent entre elles
iont remplis d’une matière encore plus j g j g j g g g
l ’air le plusfubtil, laquelle n’ayant pluscetteaûton
n’en feut pas davantage , pour que des exhalations
f W « des vapeurs, puiffent former un corps dur
& foü d e C’en ainfi que le plomb rendu liquide par
M o n du feu, fedurcit en le rétro,diflant : encore
nour rendre la comparaifon plus pille, peut-on fup-
pour renu . 1 ; refte & qlu a été épargnée
ptrTeTeu, efl fur-tout compofée des parties métalÜq“
ne m’étendrai pas davantage fur ce détail des
effets de la foudre, qui me mèneraient trop loin, 6c
fe naffe à l'explication de quelques phénomènes que
je crois nécelaires pour mieux développer le fond
du fyftème. fe forment k pU)S fouvent for le
foir.’ êc font ordinairement annoncés par un vent
du lev an t, connu fous le nom du vent dautan.
Parce qù’alors le lbleil couchant donnant à 1 air
p vers l’orient, oppofe à celui que lui
“I S r i e v e S du levant, l e s t a g e s s’alfemblent
& demeurent immobiles au point de concours de
ces deux vents, en forte que les fermens qu ils portent
avec eux , ou ceux qui ont ete eleves jufques-
Îà par la chaleur du jour, peuvent agir
que leur aftion foit traverfee par aucun mouve-
Tent ni des nuages eux-mêmes , ni de 1 air qm les
f o jo eIu'arrive fouvent que plufieurs orages fe for-
m»nt’ au même endroit dans un meme jou r, quelquefois
même-le lendemain 8c les jours d iv a n s ,
comme auffi qu’ils fe jettent tous du meme co te , &
fui vaut exaâement la même voie.
bus, la fermentation s’aftoiblira dans cette parti,
de l'orage plutôt que dans toutq autre. Dr , | ai dit
l u n i la pofition de la partie de
ell la première à s’affoiblir, détermine le point de
l’horifon vers lequel le corps de l orage doit etre
P° r 0.eb n voit quelquefois des orages fe divifer en
deux parties, dont l’une parait demeurer immobile,
tandis que l’autre s’écarte de la première. ..
C’eft une fuite du dérangement que la defeente
du premier orage a laiffé dans l’air ; car à mefure
ou’il ell defeendu , il a été remplace principalement
par l'air qu’il avoit au-deffus de lu i , lequel ne fe
frouvantplusfoutenu, adû le fmvre & tomber avec
lui O r , dès que le calme commence à fe rétablir,
cet air ou d’autre encore qui ell venu d ailleurs , &
a fuccédé au premier, n’ayant pas la denlite requife
pour fe maintenir en cet endroit, doit infenfible-
ment fe remettre à fa place ; 8c par ce mouvement
tirer à lui l’ air environnant enfemble les nuages qui
s’y trouvent, lefquels ainfi affembles 8c immobiles
pourront former in fécond orage , fi la chaleur fa-
vorife l’aftion des fermens qu’ils portent avec eux ,
ou facilite L’élévation de ceux qui fe trouvent repandUp“
faeS m é raifon tout l’efpace que le premier
Cela vient de ce que la fermen anon s affoibht
dans une partie de l’orage, tandis qu elle fait du progrès
oraee a parcouru en defeendant obliquement vers
U ferre , fe trouve rempü d’un air qui n étant pas à
fa place , doit en f o r * dès que le calme commence
à favorifer fon retour : donc les orages qui fe forment
au même endroit que le premier, trouvant moins de
réfiftance de ce coté , doivent fmvre la meme voie.
En effet dès que le fécond orage eleve par la fermentation
arrive au point d’où le premier eft parti,
la matière qui le compofe doit fe répandre dans la
voie qu’il a fuivie, à caufe du peu de réfiftance
>e][e y trouve, ainfi qu’on vient de le dire ; oc ce
mouvement ne peut fe faire, comme l’on v o it , fans
que la fermentation en fouffre ; donc , cauris pan■
dans la partie voifine : ca r , cela poté , celle-
t i doit s’élever en même-tems que 1 autre R S M
obliquement en feféparant de la première ; 8c ce t
une exception à ce qu’on a dit a i l l e u r s , pr
tes, qu’une partie de l'orage qui defeend doit entraîner
la partie voifine : ce qui ne doit arriver, comme
l’on v o i t , qu’autant que cette dermere eft en-
traînée d’un côté avec plus de force qu elle n eft élevée
de l’autre par l’aftiou de la fermentation.
4». Les deux parties d’un orage qui fe divife prennent
quelquefois differentes routes 1 8 c vont fondre
en même tems l’un d’un c o te , &
Parce que la fermentation s affoiblit conlidera-
blement & en même tems aux deux extrémités op-
nofées de l’orage ; car dans ce ca s , chacune des extrémités
doit entraîner la partie voifine ; ce qui ne
peut fe faire fans que l’orage le divife en deux parties
, dont l’une plôngera d un cote , & BHEI
l’autre. On voit même que 1 égalité ou 1 inégalité
de ces deux parties doit dépendre de 1 égalité ou de
l’inégalité de cet affoibliffementqui furvient de deux
rntés en même tems.
k° A mefure qu’un orage fond en s avançant vers
nous", il paroît s’étendre de tous cô té s , & couvrir
une nlus grande partie de notre horiton.
Premièrement, parce que l’angle fous lequel nous
i le voyons , devient toujours plus grand, à mefure
qu’il approche de notre zénith, & meme à mefure
qu’il defeend vers la terre. , , •
En fécond lieu, parce que la bafe de 1 orage doit en
effet s’étendre de tous côtés dès ggg commence a
fondre ; car la couche fupéneure de la matière qui le
romDofe , fe trouvant moins foutenue par 1 action
de la fermentation, doit fe répandte vers les extrémités
de la couche inférieure & augmenter ainfi 1 é-
tendue de cette partie de ta furface qui eft tournée
VeCen qui n’empêche pas que le volume de la matière
qui fermente ne diminue à mefure que'la fermentation
tombe, comme on U dit ailleurs , car il
fuffit pour cela que la folidite du corps de 1 orage ,
ou le produit de fa bafe par fa hauteur , perde plus
par la diminution de la hauteur ou profondeur ,
qu’elle ne gagne par l’agrandtffement de la bafe. I
^ 6 ° Il arrive fouvent qu un oraj'rqni a été pouffé
pendant quelque tems vers un certain point de 1 horifon
, change tout-à-coup de direaten, 8c fe jette
d UCela doit arriver en premier lieu , lorfque la fermentation
qui n’a encore diminué que tres-peu dans
nne partie latérale de HH vient à ceffer tout-à-
coup , ou à diminuer fenhblement dans cet e meme
partie-car par la même raifon que tecorps de 1 orage
s’eftiette furfapartieantérieure lorfque 1afermentation
s’eft affoiblie en cet endroit maintenant
fe jetterfur fa partie latérale , 8c changer ainfi a
diréffion de fon mouvement progrcfftl, 6c celle de
l’air qui le fuit 8c le pouffe devant lut.
L ^même choie doit arriver en fécond lieu , lorfque
quelque obftacle confiderable , par exemple ,
Sue montagne, fe trouve dans le plan perpendiculaire
de fa ligne déroute ; car l’ air preflè par la defeente
de l’orage contre la partie anterieure delà mon*
tagne qu’il ne peut pénétrer, doit fe retourner contre
forage même, l’empêcher d’avancer , & l’obliger
<le couler du côté où fa ligne de route fait le
plus grand angle avec la montagne.
'7°. Tous les orages ne donnent pas de la grêle.
. Parce que pour la formation de la grêle deux conditions
font requifes : il faut premièrement que les
parties qui fe détachent d’un orage lorfqu’il fond ,
foient mêlées d’une quantité fuffifantc de nitre, ou
autres parties de matières propres à produire le même
effet que le nitre : il faut en fécond lieu que Pair
enfermé dans les petits intervalles que ces parties
laiffent entr’clles en s’ affemblant avant de tomber ,
ait été dilaté à un certain point parla chaleur de la
fermentation. Tout ceci a été expliqué ailleurs.
O r , la première de ces conditions manque toutes
les fois que les alkalis dominent dans le mélange de
la matière qui fermente , parce qu’ils ufent & dénaturent
les acides , & par conféquent le nitre qui
eft un véritable acide. Cette première condition
manque aulïi lorfque la fermentation eft d’une telle
nature , que le nitre», ou la plus grande partie du
nitre eft mife à l’écart, & jetté dans quelques-unes
de ces cavités pleines d’air groffier, où il eft confu-
mé par le feu qui s’y allume , ou lancé hors du corps
de P orage par l’explofiori de l’air qui fait le tonnerre :
auflî remarqué-t-on que les orages donnent d’autant
moins de grêle, que les éclairs font plus fréquens ,
& les éclats du tonnerre plus répétés & plus confi-
dérables, &c,
La fécondé condition manque lorfque les fermens
font foibles & que la fermentation eft douce & lente,
ou bien encore lorfqu’il furvient quelque caufe étrangère
qui rompt l’équilibre de l’air environnant, trouble
la fermentation, & l’empêche de faire un certain
progrès, comme feroit un coup de vent , ou quelque
mouvement excité dans Pair de quelqu’autre
maniéré, &c.
8°. Le bruit du tonnerre varie & reçoit différentes
modifications.
Parce que l’air comprimé qui le produit en rompant
les barrières qui le contiennent, s’élance de
différentes façons hors du corps de forage.
S’il fouleve avec force la matière environnante ,
& qu’il s’échappe prefque tout-à-la-fois , le bruit ne
différera guere de celui d’un coup de canon ; cela
doit arriver lorfque fon reffort déjà bandé à un certain
point par la chaleur de la fermentation , vient
tout-à-coup à recevoir de nouvelles forces par l’inflammation
fnbite des exhalaifons contenues dans la
cavité d’où il fort ; & alors on doit fur-tout craindre
la foudre, parce qu’elle eft d’autant plus à craindre
, que l’explofion de l’air qui la mene vers nous,
fe fait avec plus de force.
Si l’air fe fait des voies obliques à-traversle corps
de forage, & qu’il s’échappe par petits filets, le bruit
fera aigu, & durera un certain tems.
S’il s’élance irrégulièrement & comme par fecouf-
fes , l’organe de l’ouie fera auffi ébranlé par fecouf-
fes, & on entendra une efpece de brouiffement ou
de'pétillement qui doit varier, comme l’on v o it ,
félon l’ordre & la fucceffion des vibrations plus ou
moins fortes , plus ou moins fréquentes, plus ou
moins diftin&es, &c.
Enfin fi l’air enfermé dans une cavité voifine de
celle qui s’avance, fe trouvant moins foutenue de ce
côté , vient à percer la cloifon qui les fépare , il
s’échappera lui-même à la fuite de celui qui a déjà
commencé à fe faire une v o ie , & augmentera le bruit
excité par l’explofion commencée lans fon fecours :
c e(t ainfi qu’un éclat qui va en diminuant, & qui
femble prêt à ceffer, prendtout-à-coup de nouvelles
forces, & fe fait entendre beaucoup plus qu’aupa-
ravant.
Il peut même arriver que l’évacuation de cette fécond
e cavité donne lieu â l’évacuation d’une troifie-
me, comme la première a donné lieu à la fécondé ;
ce qui doit faire un tonnerre continuel qui fe fera entendre
à coups redoublés.
J aurois bien d’autres phénomènes à expliquer,
fi je vouloisépuiferla matière ; mais je crois en avoir
affez dit pour donner une idée du fyftème que je pro-
pofe. Je remarquerai feulement ici que le principe
d’où je fuisparti,eft évident 6c inconieftable;favoir,
que la fermentation eft l’unique caufe des orages & des
phénomènes qui les accompagnent : auffi n’ai-je pas
cru devoir me mettre en peine de le prouver. Le tonnerre
, les éclairs, la foudre, le vent, ce bouillonnement
que l’on entend dans un orage qui fe forme >
voilà mes preuves ; il n’en faut pas d’autres pour quiconque
a vu des fermentations. La grêle mêmen’eft-
elle pas une efpece de cryftallifation, effet ordinaire
des fermentations ?
Ainfi, j’ofe le dire , quelque verfés que foient
dans la Phyfique ceux qui travailleront déformais
fur ces matières , ils s’égareront s’ils perdent ce principe
de vue : qu’on réforme , qu’on abattemême ,
fi l’on v eu t, l’édifice que je viens d’élever , je n’en
fuis point jalou$ ; mais qu’on ne cherche pas à bâtir
fur un autre fondement.
Je voudrois que quelque phyficien habile , quelqu’un
de ces hommes privilégiés que la nature fe
plaît à initier dans fes myfteres; par exemple , un...
un. ..commençaffent par fe bien convaincre de cette
vérité,& qu’ilspriffent enfuite la réfolution défaire
un fyftème , je fuis affuré que la théorie qu’ils nous
donneroient vaudroit infiniment mieux que tout ce
qu’on a fait jufqu’ici fur cette matière. Que fçait-on
même fi le progrès de la théorie feroit l’unique fruit
de leur travail? Ne pourroit-il pas arriver qu’ils fif-
fent quelque découverte heureufe, & qu’ils trou-
vaffent quelque moyen de nous délivrer d’un des plus
funeftes fléaux dont la colere divine puiffe nous affliger
? On a bien fait d’autres découvertes auxquelles
il femble qu’on auroit dû s’attendre encore moins
qu’à celle-là.
Mais comme c’eft à l’expérience bien plus qu’aux
fyftèmes & aux raifonnemens, que nous fommes redevables
de toutes celles qui fe font faites jufqu’ic i,
c ’eft fur-tout de l’expérience que nous devons attendre
celles qui fe feront à l’avenir ; il femble donc que
dans un pays dévafté tous les ans par la grêle , les
raifons les moins fpécieufes devroient fuffire pour
nous engager à tourner toute notre attention de ce
côté-là. Menacés d’être réduits à la demiere indigence,
& prefque forcés à faire un abandon de nos
biens , que ne devons-nous pas faire pour tâcher d’éviter
ce malheur ?
Nous avons oui dire plus d’une fois à nos militaires
, que le bruit du canon diffipe les orages, & qu’on
ne voit jamais de grêle dans les villes affiégées. Je
n’oferois affiirer qu’on puiffe compter fur cette ob-
fervation ; il femble pourtant que l’accord de tant de
gens dignes de foi, qui prétendent l’avoir faite, doit
être de quelque confédération.
Lorfque j’examine la chofe en phyficien, & relativement
aux principes ci-deffus, cer effet du canon
ne me paroît pas hors de toute vraiffemblance. Après
tout que rifqueroit - on à faire un effai ? quelque
quintal de poudre, les frais du tranfport de quelques
pièces de canon qui ne vaudroient pas moinsapres
avoir été employées à cet ulage. ( a )
Peut-être qu’au moyen de cette efpece de mou-
(a ) Vingt ou trente pièces de canon, peut-être un plus
petit nombre pourroit lutfire pour taire cette expérience ,
en les plaçant trois à trois ou quatre à quatre, vie dtthnee
en diftance , comme feroit à une lieue ou k une lieue Si
demie les unes des autres.