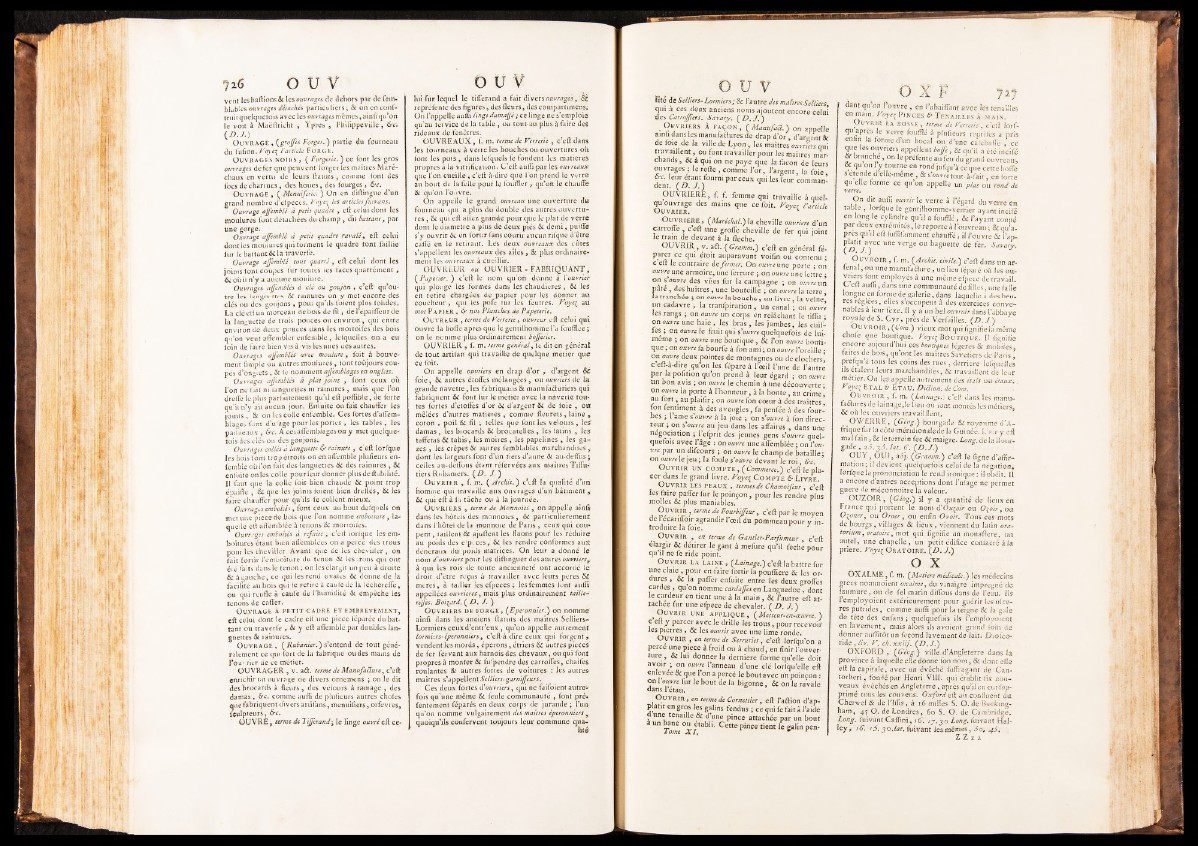
7*6 o U V O Ü V
Vent les battions & les ouvrages de dehors par de fem-
blables ouvrages détachés particuliers ; & on en construit
quelquefois avec les ouvrages mêmes, ainli qu’on
le voit à Maëftricht , Ypres , Philippeville, &c.
(D .J . ) ' N ■
O u vrage , (groffes Forges.,) partie du fourneau
du fufion. Voyc{ l'article Fo rg e.
Ou vrages noirs , ( Forgerie. ) ce font les gros
ouvrages de fer que peuvent forger les maîtres Maréchaux
en vertu de leurs ftatuts, comme font des
focs de charrues, des houes, des fourges y &e.
O uvrage , ( Menuiferie. ) On en diftingue d’un
grand nombre d'elpeces. Voye{ les articles fuivans.
Ouvrage ajfemblé a petit quadre , cft célui dont les
moulures font détachées du champ, dit battant , par
tine gorge.
Ouvrage ajfemblé à petit quadre ravalé, eft celui
dont les moulut es qui forment le quadre font faillie
lur le battant & la traverfe.
Ouvrage ajfemblé tout quarté, eft celui dont les
joints font coupés fur toutes les faces quarrément ,
& o ù i l n’y a aucune moulure.
Ouvrages ajfemblés à clé ou goujon , c’ eft qu’oit-
tre les languettes Sc rainures on y met encore des
clés ou des goujons , pour qu’ils foient plus folides.
La clé eft un morceau de bois de f il, de l’épaiffeur de
la languette de trois ponces ou environ , qui entre
environ de deux pouces dans les morioifes des bois
«■ l’on veut affembler enfemble, lefqueiles. on a eu
loin dé faire bien vis à vis les unes des autres.
Ouvrages ajfemblés avec tnoulure, foit à bouve-
ment fimple ou autres moulures, lont toujours coupés
d’ongiets, & le nomment affemblagés en onglets.
Ouvrages afjemblés à plat joint , l'ont ceux où
l ’on ne fait ni ianguet.tes ni rainures , mais que l’on
drefle le plus parfaitement qu’il eft poflible, de forte
qu'il n’y ait aucun jour. Eniuite On fait chauffer les
joints , & on les colle enfemble. Ces fortes d’affem-
blages font d’uîage pour les portes , les tables, les
panneaux ,- &c. A cesaffembîages on y met quelquefois
desclés ou des goujons.
Ouvrages collés d languette & talnüfe , c eft lorfque
les bois lont trop étroits on en aflëmble plufieürs enfemble
où l’on fait des languettes Sc des rainures , Sc
enfuite on les colle pour leur donner plus de Habilité.
Il faut que la colle foit bien chaude Sc point trop
épaifle , Sc que les joints loient bien dreflés, Sc les
faire chauffer pour qu’ils lé collent mieux.
Ouvrages emboîtés y font ceux au bout desquels on
met une piece de bois que l’on nomme embouure, laquelle
eft affemblée à tenons Sc morioifes.
OuVrjges emboîtés à refuite y c’ell lorique lesem-
boîtures étant bien affembiées on a percé des trous
pour les cheviller Avant que de les cheviller, on
fait fortir l’emboîture du tenon Sc les trous qui ont
été faits dans le tenon ; on les élargit un peu à droite
& à gauche, ce qui les rend ovales Sc donne de la
facilité au bois qui le retire à caufede la léchereffe,
ou qui renfle à caulë de l'humidité & empêche les
tenons de caffer.
OU.VRAGE À PETIT GADRE ET EMBREVEMENT,
eft celui dont le cadre eft une piece féparée du battant
ou traverfe , & y eft affemblé par doubles languettes
& rainures.
Ou v r a g e , (Rubanier.') s’entend de tout géné-
talement ce qui fort de la fabrique ou des mains de
l’ouvrier de ce métier.
OUVRAGER , v. a â . terme de Manufaclurey c’eft
enrichir un ouvrage de divers ornemens ; on le dit
des brocards à fleurs , des velours à ramage , des
damas , &c. comme auffi de plufieurs autres chofes
que fabriquent divers artifans, menuifiers, orfèvres,
foulpteurs, &c.
OUVRÉ, terme de 7ijferand; le linge ouvré eft celui
fur lequel le tifferand a fait divers ouvrages, Sè
repréfente des figures, des fleurs, des compartimensi
On l’appelle aulfi linge ddmajjé;• ce linge né s’emploie
qu’au 1er vice de la table , ou tôut-au-plüs à faire des
rideaux de fenêtres:
OU VREAU X , 1. m. terme de Verrerie , c’eft dans
les fourneaux à verre les bouches ou ouvertures où
font les potâ ; dans lelquels fe fondent les matières
propres à la Vitrification. C ’eft àiifli par les ouvreaux
que fon cueille , c’éft à-dire que l:qn prend le verre
au bout de la felle pour le fouiller , qu’on le chauffé
& qu’on l’ouvre.
On appelle le grand ouvreau une ouverture dtt
fourneau qui a plus du double des autres ouvertures
, Sc qui eft allez grande pour que le plat de verre
dont le diamètre a plus de deux piés & demi, puifle
s’y ouvrir Sc en lortir fans courir aucun rifqtte d’être
cafte en le retirant. Les deux ouvreaux des côtes
s’appellent les ouvreaux des aîles , & plus ordinairement
les ouvreaux à cueillir.
OUVREUR ou OUVRIER - FABRIQUANT*
( Papetier. ) c’eft le nom qu’on donne à l'ouvrier
qui plonge les formes dans les chaudières, Si les
eii retire chargées de papier pour les donner aut
coucheur, qui les pofe lur les feutres: V'oyej au
mot Papier . & nos Planches de Papeterie.
OUVREUR , terme de Verrerie ÿ ouvreur eft Celui qui
ouvre la boflê après que le gentilhomme l’a fouillée ;
on le nomme plus ordinairement bojfetitr.
OUVRIER ÿ f. m. terme général y le dit en général
de tout artiîan qui travaille de quelque métier que
ce foit.
On appelle ouvriers én drap d’or , d’argent St
foie, Si. autres étoffes mélangées, ou ouvriers de la
grande navette, les fabriquans & manufacturiers qui
fabriquent Sc font lur le métier avec la navette toutes
fortes d’étoffes d’or 6c d’argent Sc de foie , out
mêlées d’autres matières ,• comme fleufets, laine ,
coton , poil 6c fil ; telles que font les velours , les*
damas , les brocards Sc brocatelles* les latins , les
taffetas Sc tabis'; les moires , les papelines , les ga-r
zes , les crêpes & autres femblables marchandées ,'
dont les largeurs font d’un tiers d’aune & au-deffus j
celles au-deffows étant réfervées aux maîtres Tiffu-
tiers Rubaniers. (D . J .)
O uvrier , f.,m. ( A r c h it. ) c t f t la qualité d’uri
homme qui travaille aux ouvrages d’un bâtiment y
Sc qui eft à la tâche ou à la journée. ,
O uvriers , terme de Monnoies , on appelle ainfi-
dans les hôteis des monnoies, Sc particulièrement
dans l’hôtel delà monnoie de Paris,- ceux qui coupent
, raillent Sc ajuftent les flaonspour les réduire
au poids des e'peces, Sc les rendre conformes aux
déneraux dû poids matrices. On leur a donné lé
nom d'ouvriers pour les diflingiier des attires ouvriers j
à qui les rois de toute ancienneté ont accordé le
droir d’être reçus à travailler avec leurs peres St
nu. res, à tadler les efpeces ; les femmes font auffi
appellces ouvrières y mais plus ordinairement taille-
rejjès. Boi^itd. (D . J. )
Ouvriers de fo r g e , (Epcronnier.) on nommé
ainfi dans les- anciens ftatuts des maîtres Selliers-
Lormiers ceux d’entr’eu x , qu’on appelle autrement
lormiers-èperonniers, c’eft-à dire ceux qui forgent y
Vendent les mords, éperons, étriers Sc autfes pieceü
de fer fervant aux harnoisdes chevaux, ou qui font
propres à monter Sc fufpendre des carroffes, chaifes
roulantes & autres fortes de voitures : les autres*
maîtres s’appellentSelliers-garniJJ'eurs.
Ges deux fortes d'ouvriers, qui ne faifoient autrefois
qu’une même Sc feule communauté , font pré.
fentement féparés en deux corps- de jurande ; l’un
qu’on nomme vulgairement des maîtres éperonniers
quoiqu’ils couler vent toujours leur commune qua-
O U V
I i te d e Selliers- Lormiers; S c l ’a u t r e àes maîtres Selliers '
q u i à c e s d e u x a n c ie n s nom s a jo u te n t e n c o r e c e lu i
d e b CarroJJiers.. Savary. (D . J .)
O h v m e s s à f a ç o n , ( M a r tu fa c i.') o n a p p e lle
a in h d an s le s m a n u fa S u r e s d e d rap d ’o r , d ’a r a e n t &
d e fo ie d e la v i l l e d e L y o n -, le s m a ît r e s ouvriers n u i
t r a v a i l l e n t , o u fo n t t r a v a i l le r p o u r le s m a ît re s ma r ch
a n d s , & à q u i o n n e p a y e q u e l à fa ç o n d e le u r s
O u v r a g e s ; l e r e f t e , com m e l ’o r , l ’a r g e n t , la fo ie
&c. le u r é ta n t fo u rn i p a r c e u x q u i le s le u r c om m a n d
e n t . ( D . j . y
OUVRIERE, f. f . fem m e q u i t r a v a i l le à qUel-
q u o u v r a g e d e s m a in s q u e c e fo i t , V o y e z V a fc icU
■ Ou v r i e r . l
O U V R IE R E , (Maréchal.} la . c h e v i l le ouvrière d ’uri
c a r r o f f e , c e ft u n e g r o lîe c h e v i l le d e f e r q u i jo in t
l e t ram de d e v a n t à la f lé c h é .
OUVRIR, y. a cl. ( Gramm.y c’eft en général féi
qui éttiit auparavant -voifln ou contenu ;
c eft le contraire de fermer. On ouvre une porte ; on
•ouvre une armoire, une ferrure ; on ouvre une lettre •
on s'ouvre des vues fur la campagne ; on ouvre un
pâté , des huîtres, une bouteille ; on ouvre la terre
la tranchée ; on ouvre la bouche, un livre, la veine*
lin cadavre , la tranfpiration , un canal ; on ouvre
les rangs ; on ouvre un corps en relâchant le tiffu ;
on ouvre une haie > les bras , les jambes, les ciiif-
ïes ; on ouvre le fruit qui s'ouvre quelquefois de lui-
même ; on ouvre une boutique, & l’on ouvre boutique
; on ouvre fa bourfe à fon ami ; on ouvre l’oreille *
on ouvre deux pointes de montagnes ou de clochers^
c ’eft-à-dire qufon les fépare à l’oeil l’une de l’autre
par la pofition qu’on prend à leur égard ; on ouvre
ün bon avis ; on ouvre le chemin à une découverte •
On ouvre la porte à l’honneur, à la honte , au crime \
âu fort, au plaifir; on ouvre fon coeur à des traîtres
fon fentiment à des aveugles, fa penfèe à des fourbes
; Tanne s'ouvre à la joie ; on s'ouvre à fon directeur
; on s'ouvré au jeu dans les affaires , dans une
négociation ; l’efprit des jeunes gens Couvre quelquefois
avec l’âge : on ouvre une affemblée ; on {'ouvre
par un difeours ; on ouvre le champ de bataille;
on ouvre le jeu ; la foule s'ouvre devant le roi &c.
O u v r i r u n c o m p t e , (Commerce.) c ’ e ft le p la c
e r d an s le g r an d liv r e . F o y e { C o m p t e & L i v r e .
O u v r i r LES PEAUX , termes de Chamoifeur, c ’ e ft
le s fa i r e p a f fe r fu r l e p o in ç o n , p o u r l e s r e n d r e plus
m o lle s Sc p lu s m a n ia b le s .
O u v r i r , terme de Fourbiffeur, c ’e ft p a r l e m o y e n
d e T e c a r if fo i r a g r a n d i r l ’oe i l d u p om m e a u p o u r y in t
ro d u i r e la fo ie . J
' O u v r i r , en terme de Gantier-Parfumeur f c ’e ft
é la r g i r Sc d é t i r e r le g a n t à m e fu r e q u ’i l fe c h e p o u r
q u i l n e fe r id e p o in t .
O u v r i r l a l a in e , (Lainage.) c ’ e ft.la b a t t r e fu r
u n e c la ie , p o u r en fa i r e lo r t i r la p o u f lïe r e & le s o r d
u r e s , Sc la p a f fe r e n fu ite e n t re le s d e u x g ro ffe s
c a rd e s , q u ’o n n om m e cardajfesen L a n g u e d o c , d o n t
l e c a rd e u r en t ie n t u n e à la m a in , & l’a u t r e e ft a t t
a c h é e fu r u n e e fp e c e d e c h e v a le t . ( D . J . )
^ O u v r i r u n e a p p l i q u e j ( Metteur- en-oeuvre.)
c e ft y p e r c e r a v e c le d r ille le s t r o u s , p o u r r e c e v o i r
le s p ie r re s , Sc le s ouvrir a v e c u n e lim e ro n d e .
O u v r i r , en terme de Serrurier y c ’ e ft lo r fq u ’o n a
p e r c e u n e p ie c e à f ro id o u à c h a u d , en fin ir l ’o u v e r tu
r e , & lu i d o n n e r la d e rn ie r e fo rm e q u ’e l le d o i t
a v o i r ; o n ouvre l’an n e a u d ’u n e c lé lo r fq u ’e l le e ft
e n le v e e Sc q u e 1 o n a p e r c é l e b o u t a v e c u n p o in ço n :
o n l'ouvre fu r l e b o u t d e la b ig o r n e , & o n le r a v a le
d an s l ’é ta u .
O u v r i r , en terme de Cornettier, e ft l’a ê lio n d’a p -
p la t ir e n g r o s le s g a lin s fen d u s ; c e q u i fe f a i t à l ’a id e
d u n e t e n a ille & d ’u n e p in c e a t t a c h é e p a r u n b o u t
a u n b a n c ôu^ é ta b li . C e t t e p in c e t ie n t le g a lin p en -
O X F 7^?
dant qu*on l’ouvre , en l’abaiffant avec les tenailles
en main. Voye{ Pinces & T enailles à main.
O uvrir la BOSSE, terme de Verrerie, c ’eft lorf-
qu après le verre foufflé à plufieurs reprifes a pris
enfin la forme d’un bocal ou d’une calebaffe , ce
que les ouvriers appellent boffe, Sc qu’il a été incifé
branche, on le préfente au feu du grand ouvreau*
f f î 1 \ Y t°»rne en rond jufqu’à ce que cette boffe
s etende d eile-meme, & s'ouvre tout- à-fait, en forte
qu elle forme ce qu’on appelle un plat ou rond de
i i H H o .......... ...... ciydiu in c u e
en long le cylindre qu il a foufflé, & l’ayant coupé
par deux extrémités, le reporte à l’ouvreau ; Sc qu’a-
pres qu’il eft fuffifamment chauffé, il l’ouvre Sc l’ap-
platit avec une verge ou baguette de fer. Savary.
C d . J. )
O uvroïr , f. m. (Archit. civile.) c’eft dans un ar-
lenal, ou une manufaâure, un lieu féparé où les oit-
vriers font employés à une même efpece de travail.
C ’eft auffi, dans une communauté de filles, une fàlle
longue en forme de galerie, dans laquelle à des heures
reglees, elles s’occupent à des exercices convenables
à leur fexe. 11 y a un bel ouvroir dans l’abbaye
royale de S. C y r , près de Verfailles. (D . J.)
O u v r o ir , (Com.) vieux mot qui fignifie la même
choie que boutique. Voye^ Bo u t iq u e . U fignifie
encore aujourd’hui ces boutiques légères & mobiles*
faites de bois, qu’ont les maîtres Savetiers de Paris ,
prefqu à tous les coins des rues , derrière lefqueiles
ils étalent leurs marchandées, & travaillent de leur
métier. On les appelle autrement des étals ou étauxt ;
V o y e i Et a l & Et a u . Diction, de Com.
O uvroir , f. m. (Lainage.) c ’eft dans les manufactures
de lainage,le lieu où lont montés les métiers,
Sc où les ouvriers travailllent.
^OWERRE, (Géôg.) bourgade Sc royaume d ’A frique
fur la côte méridionalede la Guinée. L’eir y eft
mal fain, Sc le terrein fec Sc maigre. Long, de la Bourgade
, zS.g S. lat. 6. (D . J )
O U Y , O U I , adj. (Gramm.) c’eft le figne d’affirmation
; il devient quelquefois celui de la négation,
lorfque la prononciation le rend ironique: il obéit. Il
a encore d’autres acceptions dont i’ulage ne permet
guere de méconnoître la valeur.
OU ZO IR, (Gèog.) il y a quantité de lieux en
France qui portent le nom d'Ourdir ou O^oir, ou
O^oner y ou O roer y ou enfin Ovoir. Tous ces mots
de bourgs , villages & lieux, viennent du latin oratorium
y oratoire, mot qui fignifie un monaftere, un
autel, une chapelle , un petit édifice confacréàla
priere. Voye^ O r a t o ir e , (D . J.)
o X
OXALME, f. m. (Matière médicale.) les médecins
grecs nommoient oxalme, du vinaigre imprégné de
faumure, ou de fel marin diffous dans de l’eau. Ils
Temployoient extérieurement pour guérir les ulcérés
putrides, comme auffi pour la teigne & la gale
de tête des enfans ; quelquefois ils Temployoient
en lavement, mais alors ils avoient grand loin de
donner auffitôtun fécond lavement de lait. Diolco-
ride , liv. V. ch. xx iij. (D . J.)
O X FO R D , (Géôg.) ville.d’Angleterre dans la
province à laquelle elle donne fon nom, Sc dont elle
eft la capitale, avec un évêché fuffragant de Can-
torberi, fondé par Henri VIII. qui établit fix nouveaux
évêchés en Angleterre, après qu’il en eut fup-
primé tous les couvens. Oxford eût au confluent du
Cherwel & de l’Iffis, à 16 milles S. O. de Buckingham,
45 O. de Londres, 6o S. O. de Cambridge.
Long, fuivant Gaffini, / (T. i j . $ o Long, fuivant Hal-
le y , ïC. ‘ tâ. go.lat. foivant les m êm e s6o, 4.54
Z Z z z