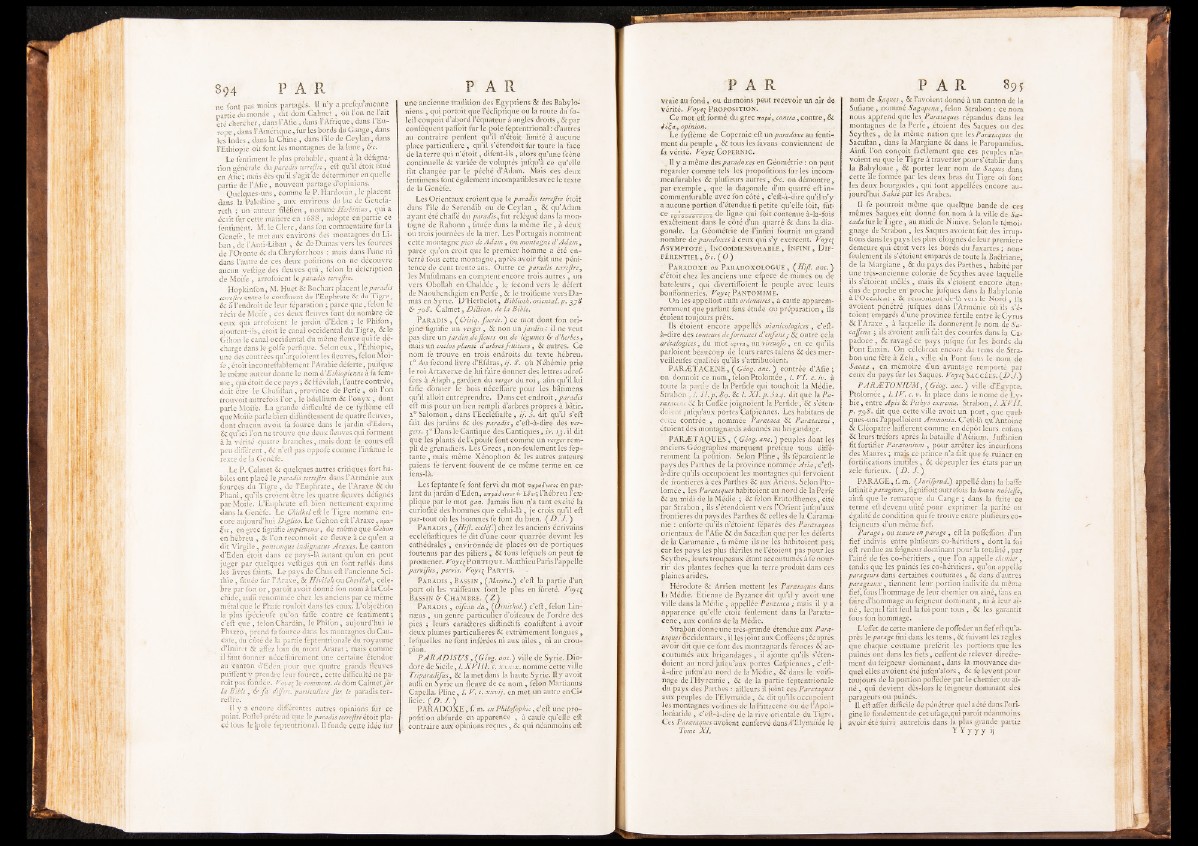
ne font pas moins partagés. Il n’y a prefqu’aucune
partie du monde , dit dom Calmet , oii l’on ne l’ait
été chercher, dans l’Afie, dans l’Afrique, dans l’Europe
, dans l’Amérique, fur les bords du Gange, dans
les Indes, dans la Chine , dans 111e de Ceylan, dans
l’Ethiopie oii font les montagnes de la lune, &c.
Le fentiment le plus probable, quant à la défigna-
tion générale du paradis terrejlre, eft qu’il étoit litue
en Aiie; mais dès qu’il s’agit de déterminer en quelle
partie de l’Afie , nouveau partage d’opinions.
Quelques-uns, comme le P. Hardbuin, le placent
dans la Palefiine , aux environs du lac de Genefa-
reth ; Un auteur filéfien , nommé Herbinius, qui a
écrit fur cette matière en 1688 , adopte en partie ce
fentimènt. M. le C lerc, dans fon commentaire fur la
Genefe, le met aux environs des montagnes du Liban
, de FAnti-Liban , & de Damas vers les fources
de l’Oronte & du Chryforrhoas : mais dans l’une ni
dans l’autre de ces deux pofitions on ne découvre
aucun vefiige des fleuves qui, félon la defcription
de Moïfe , arrofoient le paradis terrejlre.
Hopkinfon, M. Huet & Bochart placent le paradis
terrejlre entre le confluent de l’Euphrate & du Tigre,
& à l’endroit de leur féparation ; parce que, félon le
récit de Moïfe , ces deux fleuves font dû nombre de
ceux qui arrofoient le jardin d’Eden ; le Phifon,
ajoutent-ils, étoit le canal occidental du Tigre, & le
Gihon le canal occidental du même fleuve qui fe de-
charge dans le golfe perfique. Selon eux, l’Ethiopie,
une des contrées qu’arçofoient les fleuves, félon Moïfe
, étoit inconteftablement l’Arabie déferte, puifque
le même auteur donne le nom d'Ethiopienne à fa femme
, qui étoit de ce pays ; Sc Hévilah, l’autre contrée,
doit être le Chufiftan , province de Perfe, où l’on
trouvoit autrefois l’o r , le bdellium & l’onyx , dont
parle Moïfe. La grande difficulté de ce fyfième eft
que Moïfe parle bien diftinCtement de quatre fleuves,
dont chacun avoit fa fource dans le jardin d’Eden *
& q u ’ici l’on ne trouve que deux fleuves qui forment
à la vérité quatre branches, mais dont le cours eft
peu différent, & n’eft pas oppofé comme l’infinue le
texte de la Genèfe.
Le P. Calmet & quelques autres critiques fort habiles
ont placé le paradis terrejlre dans l’Arménie aux
fources du Tigre , de l’Euphrate, de l’Araxe & du
Phani, qu’ils croient être les quatre fleuves défignéS
par Moïfe. L’Euphrate efl bien nettement exprimé
dans la Genèfe. Le Chidkel efl: le Tigre nommé encore
aujourd’hui Diglito. Le Gehon efl l’Araxe, apa.-
, en grec fignifie impétueux, de même que Gehon
en hébreu , & l’on reconnoît ce fleuve à ce qu’en à
dit Virgile, pontemque indignatus Araxes. Le canton
d’Eden étoit dans ce pays-là autant qu’on en peut
juger par quelques veftiges qui en font reflés dans
les livres faints. Le pays de Chus efl l’ancienne Sci-
thie , fituée fur l’Araxe, & Hévilah ou ChevUah, célébré
par fon o r , paroît avoir donné fon nom à laCol-
chide, aufîi renommée chez les anciens par ce même
métal que le Phafe rouloit dans fes eaux. L ’objeCtion
la plus fpécieufe qu’on faffe contre ce fentiment ;
c’eft que , félon Chardin, le Phifon, aujourd’hui le
Phazzo, prend fa fource dans les montagnes du Cau-
cafe, du côté de la partie feptentrionale du royaume
d’Imiret & affez loin du mont Ararat ; mais comme
il faut donner néceffairement une certaine étendue
au canton d’Eden pour que quatre grands fleuves
puiffent y prendre leur fourc'e, cette difficulté ne pà-
roît pas fondée. Voye^ le comment, de dom Calmef/wr
la Bible, & fa dijjert. particulière fur. le paradis ter-
reflre.
Il y a encore différentes autres opinions fur ce
point. Poftel prétend que le paradis terrejlre étoit placé
fous le [pôle feptentrional. Il fonde cette idée fur
une ancienne tradition des Egyptiens & des Babylo«'
niens , qui portoit.que l’écliptique ou la route du fo-
leil coupoit d’abord l’équateur à angles droits, & par
conféquent pafloit fur le pôle feptentrional : d’autres
au contraire penfent qu’il n’étoit limité à aucune
place particulière , qu’il s’étendoit fur toute la face
de la terre qui n’étoit, difent-ils, alors qu’une feène
continuelle & variée de voluptés jufqu’à ce qu’elle
fût changée par le péché d’Adam. Mais ces deux
fentimens font également incompatibles avec le texte
de la Genèfe.
Les Orientaux croient que le paradis terreßre étoit
dans l’île de Serendib ou de Ceylan , & qu’Adam
ayant été chaffé du paradis, fut relégué dans la montagne
de Rahonn , fituée dans la meme île , à deux
ou trois journées de la mer. Les Portugais nomment
cette montagne pico de Adam , ou montagne d'Adam ,
parce qu’on croit que le premier hömme a été enterré
fous cette montagne, après avoir fait une pénitence
de cent trente ans. Outre ce paradis terreßre,
les Mufulmans en comptent encore trois autres , un
vers Obollah en Chaldée , le fécond vers le défert
de Naoubendigian en Perfe, & le troifieme vers Damas
en Syrie. D ’Herbelot, Biblioth. oriental, p. gy8
& y08. Calmet, Diction. de la Bible.
Pa r a d is , ( Cridq. facrée. ) ce mot dont fon origine
fignifie un verger, & non un jardin, : il ne veut
pas dire un jardin de fleurs ou de légumes & d'herbes,
mais un enclos planté d'arbres fruitiers, & autres. Ce
nom fe trouve en trois endroits du texte hébreu.
i° Au fécond livre d’Efdras, ij. 8. où Néhémie prie
le roi Artaxerxe de lui faire donner des lettres adrefi
fées à Afaph, gardien du verger du ro i, afin qu’il lui
faffe donner le bois néceffaire pour les bâtimens
qu’il alloit entreprendre. Dans cet endroit, paradis
efl mis pour un lieu rempli d’arbres propres à bâtir.
1 ° Salofnon, dans l’Eceléfiafte, ij. 5. dit qu’il s’eft
fait des jardins & des paradis, c’eft-à-dire des vergers.
30 Dans le Cantique des Cantiques, iv. ig. il dit
que les plants de lYpoufe font comme un verger rempli
de grenadiers. Lës Grecs, non-feulement les fep-
tante , mais même Xénqôhon & les autres auteurs
païens fe fervent fôuvent de ce même terme en ce
fens-là.
Les feptante fe font fervi du mot Tntpa.S'uaoç en parlant
du jardin d’Eden , wxpàS'utsoy iv e<JV; l’hébreu l’explique,
par le mot gan. Jamais lieu n’a tant excité la
curiofité des hommes que celui-là, je crois qu’il efl
par-tout où les hommes fe font du bien, ( f l , / . )
Pa r a d is , {Hiß. eccléf.)chez les anciens écrivains
eccléfiaftiques fe dit d’une cour quarrée devant les
cathédrales , environnée de placés ou de portiques
foutenus par des piliers , & lous lefquels on peut fe
promener. Voyeç Po r t iq u e .MatthieuParis l’appellè
pitrviftis, pervis. Hiye\ Pa r v is .
Pa r a d is , Ba s s in , {Marine.) c’eft la partie d’un
port ôù les vaifleàux font .le plus en fureté. Voyez
Ba s s in & C h am b r e . , .(Z )
Pa r a d is , oifean du, {Ornithol.) ç’eft, félon Lin-
næus , un genre particulier d’oifeaux de l’ordre des
pies ; leurs caractères diftin&ifs confiftent à avoir
deux plumes particulières & extrêmement longues ,
lefquelles ne font inférées ni aux aîles , ni au croupion.
P A R A D ISU S , {Géog. anc.) ville de Syrie. D io-
dore de Sicile., I. X V I ll . c. xxxix. nommé cette ville
Triparadifus, & la met dans la haute Syrie. Il y avoit
auflï en Syrie un fleuve de ce nom , félon Martianus
Cap.ella. Pline, l. V. c. xxvij. en met un autre enCrt
lïcie. {D . J .)
PARADOXE, f. m. en Philofopliie, c’eft une pfOr-
pofition abfurde en apparence , à caufe qu’elle eft
contraire aux opinions reçues, & qui néanmoins eft
v r a ie au f o n d , o u d u-moins p e u t r e c e v o i r u n a i r d e
v é r i té . Voyei PROPOSITION.
Ce mot eft formé du grec 7rapà, contra, contre, &
, opinion»
Le fyftème de Copernic eft un paradoxe au fentiment
du peuple , & tous les. làvans conviennent de
f a vérité. Voyez_ C o p e r n i c .
. II y a même des paradoxes en Géométrie : on peut
regarder comme tels les propositions fur les incom-
menfurables & plufieurs autres, &c. on démontre,
par exemple , que la diagonale d’un quarré eft in-
commenfurable avec fon cô té, c’eft-à-dire qu’il n’y
a aucune portion d’étendue fi petite qu’elle foit, fut-
ce ,0Ô000-000000 de ligne qui foit contenue à-la-fois
exactement dans le côté d’un quarré & dans la diagonale.
La Géométrie de l’infini fournit un grand
nombre de paradoxes à ceux qui s’y exercent. Voyeç
A s y m p t o t e , In c o m m e n s u r a b l e , In f i n i , D i f f
é r e n t i e l , &c. { O )
P a r a d o x e ou P a r a d o x o l o g u e , {Hifl. anc.)
c’étoit chez les anciens une efpece de mimes ou de
bateleurs, qui divertifloient le peuple avec leurs
bouffonneries. Voye^ P a n t o m im e .
On les appelloît suffi ordinaires, à caufe apparem-
remment que parlant fans étude ou préparation , ils
étoient toujours prêts.
Ils étoienf encore, appellés nianicologices, c’eft-
à-dire des conteurs de for nettes d'enfant ; & outre cela
arétalogices, du mot stpsT«, un virtuofo , en ce qu’ils,
parloient beaucoup de leurs rares talens & des mer-
veilleufes qualités qu’ils s’attribuoient.
PARÆTACENE, ( Géog. anc.') centrée d’Afie ;
on donnoit ce nom, félon Ptolomée , l. VI. c. iv. à
toute la partie de la Perfide qui touchoit la Médie.
Strabon , l. II. p. 80. & /. X I . p. 614. dit que la Pa-
rcetacene & la Coflee joignoient la Perfide, & s’éten-
dôient jufqu’aux portes Cafpièhnes. Les habitans de
cette contrée , nommée Parcetacce & Pamtaceni,
étoient des montagnards adonnés au brigandage.
PARÆTAQUES , ( Géog. anc. ) peuples dont les
anciens Géographes marquent prefque tous différemment
la pofition. Selon Pline , ils féparoient le
pays des Parthes de la province nommée Aria, c’eft-
à-dire qu’ils occupoient les montagnes qui fervoient
de frontières à ces Parthes & aux Ariens. Selon Ptolomée
, les Pamtaques habitoient au nord de la Perfe
& au midi de la Médie ; & félon Eratofthenes, cité
par Strabon, ils s’étendoient vers l’Orient jufqti’aux
frontières du pays des Parthes & celles de la Carama-
nie : enforte qu’ils n’étoient féparés des Parcetaques
orientaux de l’Afie & du Sacaftan que par les déferts
de la Garamanie , fi même ils ne les habitoient pas;
car les pays les plus ftériles ne l’étoient pas pour les
Scythes, leurs troupeaux étant accoutumés à fe nourrir
des plantes feches que la terre produit dans ces
plaines arides.
Hérodote & Arrien mettent les Parcetaques dans
la Médie. Etienne de Byzance dit qu’il y ayoit une
ville dans la Médie , appellée Parætaca ; mais il y a
apparence qu’elle étoit feulement dans la Paræta-
cene, aux confins de la Médie.
Strabon donne une très-grande étendue aux Parcetaques
occidentaux, il les joint aux Cofféens ; & après
avoir dit que ce font des montagnards féroces & accoutumés
aux brigandages , il ajoute qu’ils s’étendoient
au nord julqu’aux portes Cafpiennes , c’eft-
à-dire jufqu’au nord de la Médie, & dans le voifi-
nage de l’Hyrcanie, & de la partie feptentrionale
du pays des Parthes : ailleurs il joint ces Parcetaques
aux peuples de l’Elymaïde, & dit qu’ils occupoient
les montagnes voifines de la Pittacene ou de FApoi-
loniatide , c’eft-à-dire de la rive orientale du Tigre.
Ces Parcetaques avoient confervé dans^’Elymaïde le
Tome XI.
nom de Sjiques, & l’avoient donné à un canton de la
Sufiane, nomme Sagapena, félon Strabon : ce nom
nous apprend que les Parcetaques répandus dans les
montagnes de la Perfe, , étoient des Saques ou des,
Scythes , de la même nation que les Pamtaques du
Sacaftan, dans la Margiane & dans le Paropamifus.
Ainfi l’on conçoit facilement que ces peuples n’a-
voient eu que le Tigre à traverfer pour s’établir dans
la Babylonie , & porter leur nom de Saques dans
cette île formée par les deux bras du T igre où font
les deux bourgades , qui font appellées encore aujourd’hui
Sakié par les Arabes.
Il fe pourroit même que quelque bande de ces
mêmes Saques eût donne fon nom à la ville de Sa-
cada fur le Tigre , au midi de Ninive. Selon le témoignage
de Strab.on , les Saques avoient fait des irruptions
dans les pays les plus éloignés de leur première
demeure qui etoit vers, les bords du Jaxartes ; non-
feulement ils s’étoient emparés de toute la Ba&riane,
de la Margiane , & du pays des Parthes, habité par
une très-ancienne colonie de Scythes avec laquelle
ils s’étoient mêlés , mais ils s’étoient encore étendus
de proche en proche jufques dans la Babylonie
à l’Occident ; & remontant de-là vers le Nord , ils
avoient pénétré jufques dans l’Arménie pù ils s’étoient
emparés d’une province fertile entre leCyrus
& l’Araxe , à laquelle ils donnèrent le nom de Sa-
cajfena ; ils avoient aufli fait des courfes dans la Ca*
padoce , & ravagé ce pays jufque fur les bords du
Pont Euxin. On célébroit encore du tems de Strabon
une fête à Zela, ville, du Pont fous le nom de
Saccea , en mémoire d’un avantage remporté par
ceux du pays fur les Saques. Voye^ S a c c É e s . {D.J.)
PARÆTONIUM, {Géog. anc.) ville d’Egvpte;
Ptolomée , l. IV. c. v. la place dans le nome de Ly-
bie, entre Apis & Pithys extrema. Strabon, l. X V I I .
p. y0)8. dit que cette ville ayoit un port, que quelques
uns l’appelloient Ammonia. C ’eft-là qu’Antoine
& Cléopâtre laifferent comme en dépôt leurs enfans
& leurs tréfors après la bataille d’Àdlium. Juftinien
fit fortifier Parcetonium , pour arrêter les incurfions
des Maures ; maj^ ce prince n’a fait que fe ruiner en
fortifications inutiles, ôc dépeupler les états par un
zele furieux. ( D . j . )
PARAGE, f. m. {Jurifprud.) appelle dans la baffe
latinité paragium, fignifioit autrefois la haute nobleffe,
ainfi que le remarque du Cange ; dans la füite ce
terme eft devenu ufité pour exprimer la parité ou
égalité de condition qui fe trouve entre plufièurs co--
feigneurs d’un même fief.
Parage, ou tenure en parage , eft la poffeflion d’un
fief indivis entre plufieurs co-héritiers , dont la foi
eft rendue aufeigneur dominant pour la totalité, par
l’aîné de fes co-héritiers , que l’on appelle chcmier,
tandis que les puînés fes co-héritiers, qu’on appelle
parageurs dans certaines coutumes , & dans d’autres
parageaux, tiennent leur portion indivife du même
fief, fous l’hommage de leur chemier ou aîné, fans en
faire d’hommage au feigneur dominant, ni à leur aîr
n é , leque l fait feul la foi pour tous , & les garantit
fous fon hommage.
L’effet de cette maniéré de poffederunfiefeft qu’a-
près le parage fini dans les tems, & fuivant les réglés
que chaque coutume preferit les portions que les
puînés ont dans les fiefs, ceffent de relever directement
du feigneur dominant, dans la mouvance duquel
elles av.oient été jufqu’alors , & fe lèvent pour
toujours de la portion poffédée par le chemier ou aîné
, qui devient dès-lors le feigneur dominant des
parageurs ou puînés.
Il eft affez difficile de pénétrer quel a été dans l’orir
gine le fondement de cet ufage,qui paroît néanmoins
avoir été fuivi autrefois dans la plus grande partie
Y Y y y y ij