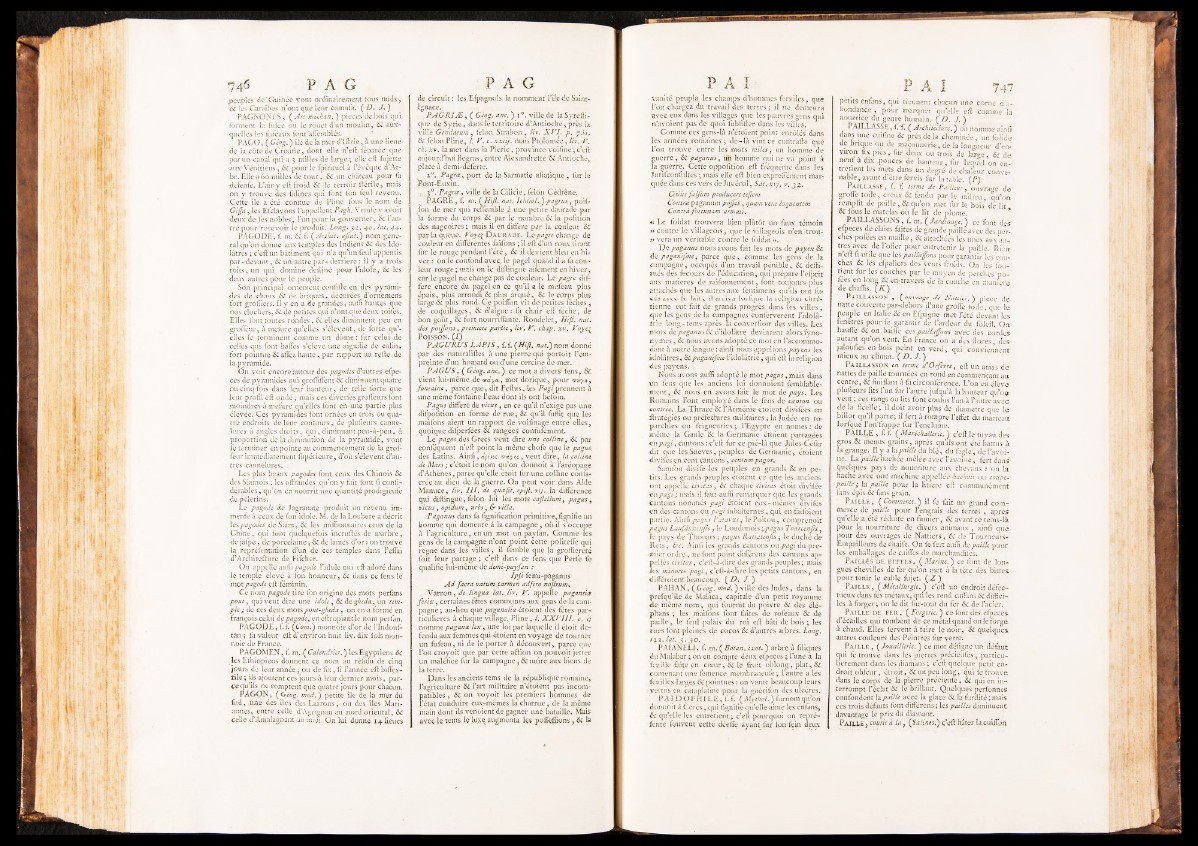
74« P A G
peuples de ' Guinée vont ordinairement tous nùds,
6c les Caraïbes n’ont que leur Camufa. ( D . J .)
PAGNONES , ( Art mèchan..) pièces de bois qui
forment la fufée ou le rouet d’un moulin, 6c aux-
•quelles les fufëaux font àffemblés.
PAGO ,. ( Gèog.^) île de la mer d’Iftrie, à une lieue
de la côte de Croatie, dont elle n’eft féparée,que
•par un canal qui- a 3 milles de large ; elle eft fujette
•aux Vénitiens, 6c pour le fpirituel à l’éveque d’Ar-
;be. Elle a-60 milles de tour, 6c un château pour fa
défenfe. L’air y eft froid & le terroir ftérile, mais
on y trouve des falines qid font fon feul revenu-.
Cette île a été connue de Pline fous , le nom de
Gifla, les Efclâvons l’appellent Pagh. V enifey avoit
deux de fes nobles, l’un pour la gouverner, 6c l’autre
pour recevoir le produit. Long. g 2. 40. lac. 44.
PAGODE, f. m. 6c f. ( Arphit. afiat.i) nom général
qu’on donne aux temples des Indiens 6c des Idov
lâtres ; c’eft un bâtiment qui n’a qu’un feul appentis
par - devant , & Un autre par-derrière : il y a trois
-toîts, un qui domine-deftiné pour l’idole., 6c les
deux autres pour le peuple.
Son principal ornement eonfifte en des pyramides
de chaux 6c de briques, décorées d’ornemens
fort grofïiers. Il y en a de grandes, auffi hautes que
nos clochers, 6c de petites qui n’ont que deux toiles.
Elles font toutes rondes, 6c elles diminuent peu en
groffeur, à mefure qu’elles s’élèvent, de forte qu’elles
fe terminent comme un dôme : fur celui de ,
celles qui font baffes s ’élève une aiguille de câlin,
fort pointue &c affez. haute, par rapport au refte de
la pyramide.
On voit encore autour des pagodes d’autres efpe-
ces de pyramides qui groffiffent 6c diminuent quatre
ou cinq fois dans leur hauteur, de telle forte que
leur profil eft ondé ; mais ces diverfes groffeurs font
moindres à mefure qu’elles font en une partie plus
élevée. Ces pyramides font ornées en trois ou quatre
endroits de leur contours, de plufieurs cannelures
à angles droits, qui, diminuant peu-à-peu, à
proportion de la diminution de la pyramide, vont
fe terminer en pointe au commencement de la groffeur
immédiatement fupérieure, d’où s’élèvent d’autres
cannelures. '
Les plus beaux pagodes font ceux des Chinois 6c
des Siamois ; les offrandes qu’on y fait font li confi-
dérables, qu’on en nourrit une quantité prodigieufe
de pèlerins.
Le pagode de Jagranate produit un revenu im-
menfe à ceux de fon idole. M. de la Loubere a décrit
les pagodes de Siam, 6c les millionnaires ceux de,la
Chine, qui font quelquefois incruftés de'marbre,
de jafpe., de porcelaine, 6c de lames d’or : on trouve
la repréfentation d’un de ces temples dans l’effai
d’Architefture de Fifcher.
On appelle aulîî pagode l’idole qui eft adoré dans
-le temple élevé à fon honneur, & dans ce fens le
mot pagode eft féminin.
Ce nom pagode tire fon origine des mots perfans
pout, qui veut dire une idole, 6c de gheda, un temple
; de ces deux mots pout-gheda, on en a formé en
françois celui de pagode, en eftropiantle nom perfan.
PAGODE, f.f. ( Com.) monnoie d’or de l’Indouf-
tan ; fa valeur eft d’ environ huit liv. dix fols monnoie
de France.
PAGOMEN, f. m. ( Calendrier. ) les Egyptiens 6c
. les Ethiopiens donnent ce nom au réfidu de cinq
„jours de leur année, ou de fix, fi l’année eft biffex-
tile ; ils ajoutent ces jours à leur dernier mois, parce
qu’ils ne comptent que quatre jours pour chacun.
PAGON, (Géog. inod. ) petite île de la mer du
fud, une des îles des Larrons, ou des îles Mari-
annes, entre celle d’Agrignanau nord oriental, &
celle d’Amalagnant au midi. On lui donne 14 lieues
P A G
de circuit: les.Efpagnols la nomment l’île de Saint-
Ignace.
| P A G R I Æ , ( Géôg. une. ) i° . ville de laSyrefti-
que de Syrie, dans le territoire d’Antioche, près la
ville Gendarum, félon Strabon, liv. X V I . p. y5 \.
6c félon Pline, l .V . t . xxiij. mais P'tplômée, liv. F.
ch. xv. la met dans la Pierie, province Voifine; c’eft
aujourd’hui Begras, entre Alexandrette & Antioche,
place à demi-déferte.
■ 20. Pagres y port de la Sarmatie afiatique , furie
-pont-Euxin.
;; 3°. Pagroe, ville de la Cilicie, félon Cédrène.
; PAGRE , f. m. ( Jtift. n a t. Ic litiol. ) p a g r u s , poif-
fon de mer qui reffemble à une petite daurade par
la forme du corps 6c par le . nombre & la pofition
dçs nageoires ; mais. il en différé par la couleur 6c
par la queue. ^oye^ D aurade. Le pagre change de
.couleur en différentes faifons ; il eft d’un roux tirant
fur le rouge pendant l’été, 6c il devient bleu en hiver
: on le confond avec le pagel quand il a fa couleur
rouge ; mais on le diftingue aifément en hiver ,
car. le pagel ne change pas de couleur. Le. Pagre différé
encore du pagel en ce qu’il a le mufeau plus
•épais, plus arrondi 6c plus arqué, 6c le corps plus
large 6c plus rond. Ce poiffon vit de petites féches ,
de coquillages, 6c d’algue : fa chair eft féene, de
bon goût, 6c fort nourriffante. Rondelet, Hift. nat.
dés poiflons, première p a r t ie liv . V , c'hap. x v . Voyez
Poisson. (/)
PAGURUS LA P IS , f. f. ÇÜifl. nat.) nom donné
par des naturaliftes à une pierre qui portoit l’empreinte
d’un homard ou d’une cercine de mer.
P AG U S , ( Géog. anc. .) -ce mot a divers*fens, &
vient lui-même de 'ad.ya, mot dorique, pour
fontaine, parce que, dit Feftus, les P agi prennent à
une même fontaine l’ eau dont ils ont befoin.
Pagus differe.de viens 9 en ce qu’il-n’exige pas une
difpofition en forme de rue, 6c qu’il fuffit que les
maifons aient un rapport de voifinage entre elles,
quoique difperfées 6c rangées confulément.
. Le pagos des Grecs veut dire une colline, 6c par
conféquent n’eft point la même chofe que le pagus
des Latins. Ainfi, dpi toi màyoç, veut dire, la colline
de Mars ; c’étoit le nom qu’on donnoit à l’aréopage
d’Athènes, parce qu’elle étoit fur une colline confa-
crée au dieu de la guerre. On peut Voir dans Aide
Manuce, liv. I I I . de quczfit. epijl.vij. la différence
qui diftingue, félon lui les m.ots caftellum, pagus ,
vicus , optdum, urbs, 6* villa.
Paganus dans la fignification primitive, lignifie un
homme qui demeure à la campagne, où il s’occupe
à l’agriculture, en un mot un payfan. Comme les
gens de la campagne n’ont point cette politeffe qui
régné dans les villes , il femble que la grofliereté
fo.it leur partage ; c’eft dans ce fens que Perfe fe
qualifie lui-même de demi-payfan :
Ipfe femi-paganus
Ad facra vaturn carmen adfero nojlrum»
Varron, de lingua lat. Uv. V. appelle pagantice
feria, certaines fêtes communes aux gens de la campagne
; au-lieu que paganalia étoient des fêtes particulières
à chaque village. Pline, l. X X V I I I . c. i)
. nomme pagana le x , une loi par laquelle il étoit défendu
aux femmes qui étoient en voyage de tourner
un fufeau, ni de le porter à découvert, parce que
l’on croyoit que par cette attion on pouvoit jetter
un maléfice fur la campagne, & nuire aux biens de
.la terre.
Dans les anciens tems de la république romaine,
l’agriculture 6c l’art militaire n’étoient pas incompatibles
, 6c on voyoit les premiers hommes de
l’état conduire eux-mêmes la charrue, de la même
main dont ils venoient de gagner une bataille. Mais
avec le teins le luxe augmenta les poflèffions, 6c la
P A X
Vanité peupla les champs d’hommes feryiles, que
l’on chargea du travail des terres ; il ne demeura
avec eux dans les villages que les pauvret gens qui
11’avoient pas de quoi fubfifter dans les villes.
Comme ces gens-là n’étoient point enrôlés dans
les armées romaines ; de - là vint ce contrafte que
l’on trouve entre lès mots miles, un homme de
guerre, 6c paganus y uti homme" qui ne va point à
la guerre. Cette oppofition eft fréquente dans les
Jurifconfultes ; mais elle eft bien expreffément marquée
dans ces vers de Juvénal , Sut. xvj. y. 32. '
Ci tins falfum producere teflem
Contra paganum pofles, quamvera loquentem
Contra fortunam armati.
« Le foldat trouvera bien plutôt un faux témoin
» contre le villageois , que. le villageois n’en trou-
» vera un véritable contre le foldat ».
De paganus nous avons fait les mots de payen 6c
de paganifme, parce que, comme les gens de la
.campagne, occupés d’un travail pénible, 6c defti-
îués des fecours de l’éducation, qui prépare l’efprit
aux matières de raifonnement, font toujours plus
attachés que les autres aux fentimens qu’ils ont fu-
césavec le lait, il arriva lorfque la religion chrétienne
eut fait de grands progrès dans les v ille s,
que les gens de la campagnes conferverent l’idolâtrie
long-tems après la converfion* des villes. Les
mots àt paganus 6c d’idolâtre devinrent alors fyno-
nymes, 6c nous avons adopté ce mot en l’acçommo-
dant à notre langue : ainfi nous appelions payens les
idolâtres, 6cpaganifme l’ idolâtrie, qui eft la religion
des payens.
Nous avons auffi adopté le mot pagus, mais dans
un fens que les anciens lui don noient femblable-
ment, 6c nous en avons .fait; le mot de pays. Les
Romains l’ont employé dans le fens de canton ou
contrée. La Thrace & l’Arménie étoient divifées en
ftratégies ou préfectures militaires ; la Judée en to-
parchies ou feigneuries;;-. l ’Egypte en nomes : de
même la Gaule & la Germanie étoient partagées
en pagi, cantons : c’eft fur ce pié-là que Jules-Çéfar
dit que lesSueves, peuples de Germanie, étoient
. diviles en cent cantons, centum pagos.
Samfon divife les peuples en grands & en petits.
Les grands peuples etoient ce que les anciens
ont appellé civitas, 6c chaque civitas étoit divifée
en pagi ; mais il faut auffi remarquer que les grands
cantons nommés pagi étoient eux-mêmes divifés
en des cantons ou pagi fubalternes, qui en faifoient
partie. Ainfi pagus Patavus, le Poitou, comprenoit
pagus Làufdumnjis, le Loudunois ; pagus Toarcenjîs,
le pays de Thouars ; pagus Ratiatenjis, le duché de
Rets, &c. Ainfi les grands cantons ou pagi du premier
o rdre, ne font point différens des cantons appelles
civitas, c’eft-à-dire des grands peuples ; mais
les niinores pagi, c’eft-à-dire les petits cantons, en
différoient beaucoup. ( D . J. )
PAHAN, ( Géog. mod. ) ville des Indes, dans la
prefqu’île de Malaca, capitale d’un petit royaume
de même nom, qui fournit du poivre 6c des élé-
phans ; les maifons font faites de rofeaux 6c de
paille, le feul palais du roi eft bâti de bois ; les
rues font pleines de cocos & d’autres arbres. Long.
/22. lat. 3. go.
PAIANELI, f. m. ( Botan. exot. ) arbre à filiques
du Malabar ; on en compte deux efpeces ; l’une a la
feuille faite en coeur, 6c le finit oblong, plat, 6c
contenant une femence membraneufe ; l’autre a les
feuilles larges. 6c pointues : on vante beaucoup leurs
vertus en çataplafme pour la guérifon des ulcères.
P A ID O P H lL E , f . f. ( Mythol. ) furnom qu’on
donnoit à Cérès, qui lignifie qu’elle aime les enfans,
6c qu’elle les entretient ; c’eft pourquoi on repréfente
fouvent cette déeffe ayant fui fon fein deux
P A I 747
petits enfans, qui tiennent chacun une corne d'abondance
, pour marquer qu’elle eft comme la
nourrice du genre humain. {D . J . )
PAILLASSE, f. f. ( Architecture. ) on nommé ainfi
dans une cuifine & près de la cheminée, un folide
de brique ou de maçonnerie, de la longueur d’environ
fix piés, fur deux ou trois de large, 6c de
neuf à dix pouces de hauteur, fur lequel on entretient
les mets dans un degré de chaleur convenable,
avant d’être fervis fur la table. (P )
Paillasse , f. f. terme de Pailleur, ouvrage de
groffe toile, creux 6c fendu par le milieu, qu’on
remplit de paille, 6c qu’on met fur le bois de lit
6c fous le matelas ou fe lit de plume.
PAILLASSONS , f. m. ( Jardinage. ) ce font des
efpeces de claies faites de grande paille avec des perches
pofées en maille, 6c attachées les unes aux autres
avec de l’ofier pour entretenir la paille. Rien
n eft f i utile que les paillàflons pour garantir les couches
6c les efpaliers des Véiits froids. On les fou-
tient fur les couches par le moyen de perches pofées
en long 6c en-travers de la couche en maniéré
de chaffis. (Æ)
Paillasson , ( ouvrage de Nattier. ) pièce de
natte couverte par-dehors d’une groffe toile, que le
peuple en Italie 6C en Ëfpagne met l’été devant les
fenetres pour fe garantir de l’ardeur du fojeil. On
hauffe & on baiffe ces paillaffons avec dés cordes
autant qu’on veut. En France on a des ftores, des
jaloufies en bois peint en verd, qui conviennent
mieux au climat. (Z>. J. )
Paillas,SON en terme d’Orfèvre y eft un amas de
nattes de paille tournées en rond en commençant an
centre, & finiffant à fa circonférence. L’on en éleve
plufieurs lits l’un fur l’autre jufqu’à la hauteur qu’on
veut ; çés rangs ou lits font coulus l’un à l’autre avec
dé la .ficelle ; il doit avoir plus de diamètre que le
billot qu’il porte; il fert à rompre l’effet du marteait
lorfquè l’on'frappe fur l’enclume.
PAILLE., f. f. ( Maréchallerie. ) c’eft le tuyau des
gros 6c menus grains, après qu’ils ont été battus à
la grange. Il y a la paille du blé, du fegle, de l’avoine.
La paille hachée mêlée avec l’avoxne, fert dans
quelques pays de nourriture aux chevaux : on la
hache avec une machine appellée hachoir ou coupe-
paille; y paillé pour la litiere eft communément
fans épis 6c fans grain.
. Pa iu .é , ( Commercé. ) il fe fait un grand commerce
de paille pour l’engrais des terres, après
qu’elle a,été réduite en fumier, 6c avant ce tems-là
pour la nourriture de divers animaux , ainfi que
pour dés ouvrages de Nattiers, 6c de Tourneurs-
Empailleurs de chaife. On fe fert auffi de paille pour
les emballages de caiffes de marchandifes.
PaillêI 'de eittes., ( Marine. ) ce font de longues
chevilles de fer qu’on met à la tête des bittes
pour tenir le cable fujet. ( Z )
Pa il l e , ( Métallurgie. ) c’eft un endroit défectueux
dans fes métaux, qui les rend caflans 6c difficiles
à forger; on le dit fur-tout du fer 6c de l’acier..
Paille de fer , ( Forgerie. ) ce font des efpeces
d’écailles qui tombent de ce métal quand on le forgé,
à chaud. Elles fervent à faire le noir, 6c quelque^
autres couleurs des Peintres fur verre.
Paille , ( Jouaillerie. ) ce mot défigne un défaut
qui fe trouve dans les pierres précieufes, particulièrement
dans les diamans ; c’eft quelque petit endroit
obfcur, étroit, 6c un peu long, qui 1e trouve
dans le corps de la pierre précieul'e, 6c qui en interrompt
l’éclat 6c lé brillant. Quelques perfonnes
confondent la paille avec la glace & la furdité ; mais
ces trois défauts font différens ; les pailles diminuent
davantage le prix du diamant.
Paille, courir à l a , (Salines.) c’eft hâter la cuiffon.