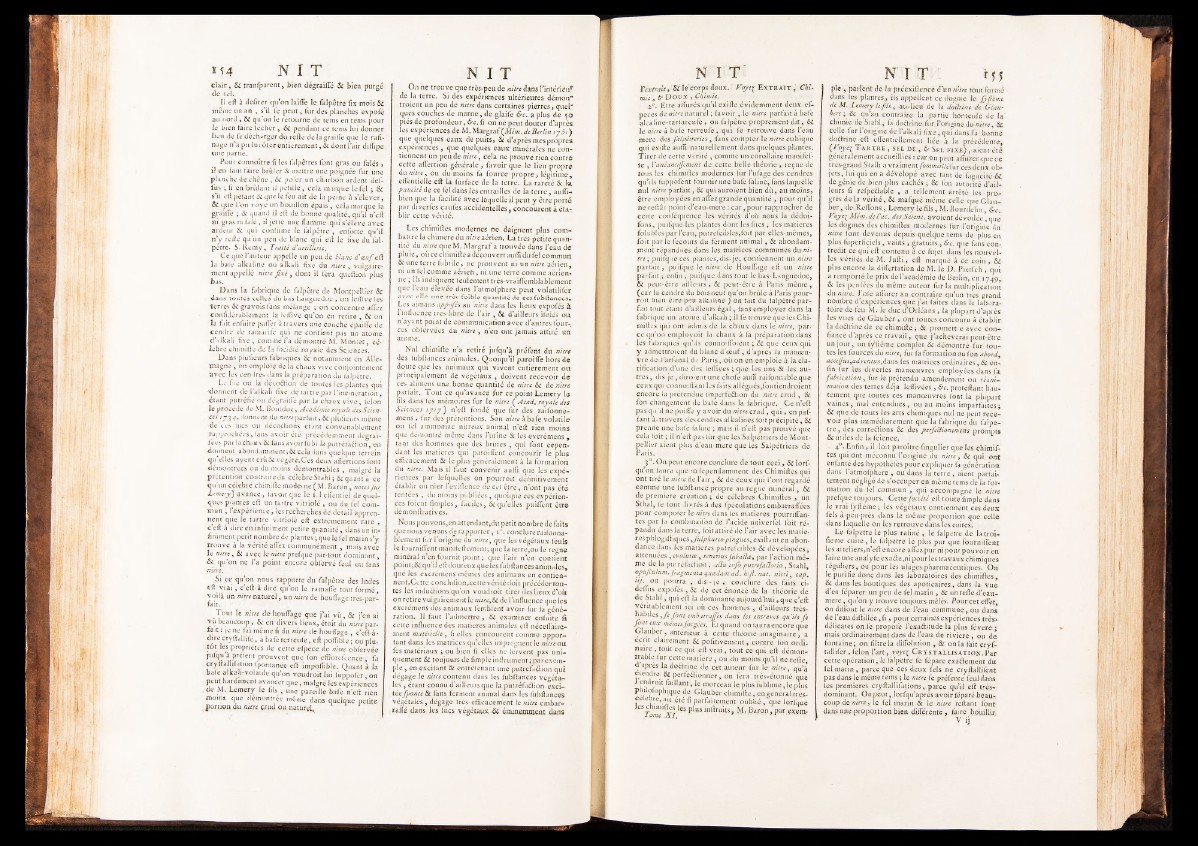
cla ir , & tranfparent, bien dégraifle & bien purgé
de iel.
Il cil à defirer qu’on laiffe le falpêtre fix mois 6c
même un an , s’il Te peut, fur des planches expofé
au nord , 6c qu’on le retourne de te ms en tems pour
le bien taire lécher , 6c pendant ce tems lui donner
lieu de fe déch jrgqr du relie de la graille que le rafi-
nage n’a pu lui ôter entièrement, & dont l’air dilfipe
une partie.
Pour connoître li les falpêrres font gras ou falés ,
il en faut taire brûler & mettre une poignée fur une
planche de chêne , 6c po.fer un charbon ardent def-
lus ; fi en brûlant il pétillé, cela marque le fel ; Sc
s’il ell pelant 6c que le feu ait de la peine à s’élever,
& que l’on voye un bouillon épais , cela marque la
graille ; & quand il ell de bonne qualité, qu’il n’ell
ni gras ni l'a lé , il jette une flamme qui s’élève avec
ardeur & qui coni'ume le falpêtre , enforte qu’il
n’y relie qu’un pèu de blanc qui ell le fixe du falpêtre.
S. Rem y , Traite d'artillerie.
Ce que l’auteur appelle un peu de blanc d'oeuf ell
la baie alkahne ou alkali fixe du nitre , vulgairement
appellé nitre f ix e , dont il fera quellion plus
bas.
Dans la fabrique de falpêtre de Montpellier &
dans toutes celles du bas Languedoc , on lerfi ve les
terres & gravois fans mélange ; ort concentre allez
confidérablement la lelfive qu’o.n en retira , & on
la fait enfuite palier à travers une Couche épaiffe de
cendre de tamarife qui ne contient pas un atome
d’alkali fixe , comme l’a démontré M. Montet, célébré
chimille de là fociété royale des Sciences.
Dans plufieurs fabriques 6c notamment en Alle-
^naëne » on emploie de la chaux vive conjointement
avec les cendres dans la préparation du lalpêtre.
Le foc ou la décoCtion de toutes les plantes qui
-'donnent de l’alkali fixe de tartr e par l ’incinération,
étant putréfié ou dégraifle par la chaux v iv e , félon
le procédé de M. Boni duc, Académie royale desScien-
ces ‘ 734’ donnent du «//«parlait, 6c plufieurs même
-de tes lues ou décodions étant convenablement
rapprochées, fans avoir ete précédemment dégrai-
fées par la chaux & fansavoir fubi la putréfadion en
donnent abondamment, & cela dans quelque terrein
qu’elles ayent crû & végété.Ces deux aliénions font
démontrées pu du-moins démontrables , malgré la
prétention contraire du célebreStahl ; Sc quant à ce
qu’un célébré chimille moderne (M. Baron, notes fur
■ L'merÿ) avance, fayoirque le fil efléntiel de quelques
plantes ell un tartre vitriolé , ou du fel corn- .
mun ; l ’expérience, les recherches de détail apprennent
que le tartre vitriole ell extrêmement rare ,
c’eft à dire en infiniment petite quantité , dans un infiniment
petit nombre de plantes ; que le fel marin s’y
trouve a la vérité allez communément , mais avec
le nitre, & avec le nitre prefque par tout dominant,
& qu’on ne l’a point encore obfervé feul ou fans
■ nitre.
Si ce qu’on nous rapporte du falpêtre des Indes
ell v r a i, c’ell-à dire qu’on le ramaflé tout formé,
voilà un nitre naturel, un nitre de houflage très-parfait.
r
Tout le nitre de houflage que j’ai vû , & j’en ai
vu beaucoup, & en divers lieux, étoit du nitre parfait
: je ne lai même fi du nitre de houflage , c’ell-à-
direcryllallife, à bafe terreufe, ell poflible; ou plutôt
lés propriétés de cette efpece de nitre obfervée
jufqu à prêtent prouvent que fon efEorefcenee , fa
cryllallilation Ipontanée ell impoflible. Quant à la
bafe alkali-volaule qu’on voudroit lui fuppofer, on
peut hardiment avancer que, malgré les expériences
de M. Lemery le fils , une pareille bafe n’ell rien
moins que démontrée même dans quelque petite I
portion du nitre çrud ou naturel,.
On ne trouve que très-peu de nitre dans Hintéfidu*'
de la terre. Si des expériences ultérieures démon-
troient un peu de nitre dans certaines pierres, quelques
couches de marne, de glaife &c. a plus de 50
piés de profondeur, &c. fi on ne peut douter d’après
les expériences de M. Margraf (Mém. de Berlin 1 y St)
que quelques eaux de puits, & d’après mes propres
expériences , que quelques eaux minérales ne contiennent
un peu de nitre, cela ne prouve rien contre
cette aflèrtion générale , favoir que le lieu propre
àu nitre, ou du moins fa fource propre, légitime,
effentielle ell la furface de la terre. La rareté & h.
paucité de ce fel dans les entrailles de la terre, aufli-
bien que la facilité avec laquelle il peut y être porté
par diverfes caufes accidentelles, concourent àéta-.
blir cette vérité.
Les chimilles modernes ne daignent plus combattre
la chimere du nitre aérien. La très-petite quantité
du nitre que M. Margraf a trouvée dans l’eau de
pluie, où ce chimille a découvert aufli du fel commun
& une terre fubtile, ne prouvent ni un nitre aérien,
ni un fel comme aérien , ni une terre comme aerienne
; ils indiquent feulement très-vraiffemblablement
que l’eau élevée dans l’atmofphere peut volatilifer
avec elle une très-foible quantité de ces fubllances.
Les aimans appofes au nitre dans les lieux expofés à
1 influence très-libre de l’air , 8c d’ailleurs ifoiés ou
n’ayant point de communication avec d’autres fourées
oblervées du nitre , n’en ont jamais attiré un
atome.
Nul chimille n’a retiré jufqu’à préfent du nitre
des lubllances animales. Quoiqu’il paroiffe hors de
doute que les animaux qui vivent entièrement ou
principalement de végétaux , doivent recevoir de
ces alimens une bonne quantité de nitre & de nitre
parfait. Tout ce qu’avance fur ce point Lemery le
fils dans fes mémoires fur le nitre ( Acad, royale des
Sciences iy iy ) n’ell fondé que fur des ràifonne-
mens, fur des prétentions. Son nitre à bafe volatile
ou fel ammoniac nitreux animal n’ell rien moins
que démontré même dans l’urine & les excrémens ,
tant des hommes que des brutes , qui font cependant
les matières qui. parodient concourir le plus
efficacement & le plus généralement à la formation
du nitre. Mais il faut convenir auflï que les expériences
par le fqu elles on pourroit définitivement
établir ou nier l’exillence de cet ê tre, n’ont pas été
tentees , du moins publiées , quoique ces expériences
foient fimples, faciles, & qu’elles piaffent être
démonllratives.
Nous pouvons,en attendant,du petit nombre de faits
que nous venons de rapporter, i°. conclure raisonnablement
fur l’origine du nitre, que les végétaux feuls
le lourniffent manifeftement; que la terre,ouïe re^ne
minéral n’en fournit point; que l’air n’en contient
point;& qu’il ell douteux que les fubllances animales,
que Jes excrémens mêmes des animaux en contien-
nent.Cette conclufion,cette vérité doit précéder toutes
les induCtions qu’on voudroit tirer des lieux d’oùt
on retire vulgairement le nitre,6c de l’influence que les
excrémens des animaux femblent avoir fur fa génération.
Il faut l ’admettre , 6c examiner enfuite 1»
cette influence des matières animales ell néceffaire-
ment matérielle , li elles concourent comme apportant
dans les matrices qu’elles imprègnent le nitre ou
fes matériaux ; ou bien fi elles ne fervent pas uniquement
& toujours de fimple infiniment; p.arexemple,
en excitant & entretenant une putréfaction qui
dégage le nitre contenu dans les fubllances végéta^-
le s , étant connu d’ailleurs que la putréfadion exci-
téejponte & fans ferment animal dans les fubllances
végétales , dégage très-efficacement le nitre embar-
raffé dans les lues végétaux 6c éminemment dans
T e x t r a i t , 6 c l e corps doux. ' K o y e ^ E x T R À ÎT C h im
ie , & D O U X , C h im ie .
z°. Etre affurés qu’il exille évidemment deux efi-
peces de n itr e naturel ; favoir , le n itr e parfait à bafe
alcaline-tartareufe , ou falpêtre proprement dit., &
le n itr e à bafe terreufe''* qui fe- retrouve dans l’eau
mere des fa lp ê t r e r i e s , fans compter le n itr e cubique
qui exille aufli naturellement dans quelques plantes.
Tirer de cette vérité , comme un corollaire mànifef-
te , l ' a n é a n tiffem e n t de cette, belle théorie , reçue de
tous les chimilles modernes fur l’ufage des cendres
qu’ ils fuppofeni fournir une bafe faline, fans laquelle
nul n itr e parfait, & quiauroient bien dû, au moins,
être employées en affez grande quantité ,:pour qu’il
ne reliât point d’eau-mere : ca r, pour rapprocher de
cette conféquence les. vérités d’où nous la déduirons,
puifque les plantes (donr.les fucs , les matières
folubles par l’eau, purrefcibles,foit par elles-mêmes,
foit par le fecours du ferment animal, & abondamment
répandues dans les matrices communes du n i tr
e ; puifque ces plantes, dis-je-, contiennent u n ,n itr e
parfait, puifque le n itr e de Houflage ell un n itr e
parfait ; enfin , puifque dans tout le bas-Languedoc,
& peut-être ailleurs, 8c peut-être à Paris même,
(car la cendre du bois neuf qu’on brûle à Paris pourroit
bien être peu alkaline ) on fait du falpêtre parfait
tout étant d’ailleurs éga l, fans employer dans la
fabrique un atome d’alkali ; il fe trouveque les.Chi-
milles qui ont admis de la chaux dans le n itr e , parce
qu’on emploÿoit la chaux à fa préparation dans
les fabriques: qu’ils connoiffoient ; & que ceux qui
y adiuettroient du blanc d’oe u f, d’après la manoeuvre
deuHa.Kfe.naJ, de Parisoù on en emploie à la clarification
id’une des leflîves ; que les uns & le.s -autres
, dis;je, diraient une chofe aufli raifonnable que
ceux qui connoiffant les faits allégués,foutiendroient
encore la prétendue imperfection du n itr e çrud , &
fon changement de baie dans la fabrique. Çe n’ell
pas qu’il ne puiffe y avoir du n itr e ,crud , q u i, en paf-
fant à-travers des cendres alkalines loit précipité, 6c
prenne une baie faline ; mais il n’ell pas prouvé que
cela foit ; il n’etl pas fûr que les Salpétriers de Montpellier
aient plus d’eau-mere que les Salpétriers de
Paris..,;:/:
, 30. On peut encore conclure de tout c e c i, & lorf-
qu’on faura que indépendamment des Chimilles qui
ont tiré le nitre de l’a ir , 6c de ceux qui l’ont regardé
comme une lubltance propre au régné minéral., 6c
de première création ; de célébrés Chimilles , un
Sthal, fe font livrés à des fpéculations embarraffées
pour compofer le nitre dans les matières pourriffan-
tes par la combinaifon de l’acide univerfel foit répandu
dans la terre, (bit attiré de l’air avec les matières
phlogiltjques ,fulphureo-pingues, exillant en abondance
dans les matières putrefcibles & dévelopées,
atténuées, evqlutoe , teneriusfubacloe, par l’aêlion.même
de la .putréfaction, aclujofo. putrcfaclorio , Stahl,
opufculum.fragmenta quoedarn ad. hif.nat. nitri, cap.
iij. on -pourra , dis - je ,- conclure des faits ci-
deffus expofés, 6c. de cet énoncé de la théorie de
de Stahl, qui ell la dominante aujourd’hui, que c ’ell
véritablement ici où ces hommes , d’ailleurs très-
habiles , f e f o n t ernbarrajfés d a n s le s e n tra v e s q u 'ils f e
fo f 1 e“x m êm e s fo r g é e s . Et quand on faura encore que
Glauber , antérieur à cette théorie imaginaire a
écrit clairement 6c pofitivemenf, .contre fon ordinaire
, toüt ce qui ell v rai, tout ce qui ell démontrable
fur cette matière , ou du moins qu’il ne relie,
d apres la doêlrine de cet auteur fur le n itr e f qu’à
etendre & perfectionner, on fera frès-étonné que
i endroit faillant, le morceau le plus fublime, le plus
P,.1 °f°Ptyque de Glauber chimille , en général,très-
celebre, ait été fi parfaitement oublié , que lorfque
W W jm W S plus inftruitsy M,:Baron.,,par;ç®ii>:
pie ,'parlent de la préexiltencé d’un nitre tout formé
dans le s 'p la n r e S j ils appellent ce dogme ilei fyfhne
de M. Lemery le f i s , . a u - l ie u de la doctrine de GlaU*
bert ; 6c qu’au contraire la partie hont-eiife. de la'
chimie, de Stahl* fa doClrine fur l’origine diii«/Ve, &
celle fur 1 origine de l’alkali,fixe, qui dans : la : bonne
dodrine .ell effentiellement liée à la précédente,
( f< Wel T a r t r e , s e l d e „ & S e l f i x e ) . , - a ien t été
généralement accueillies : car on petit affi(rer-que ce
très-grand S ta lh a vràiment fo'mmeilléfur ces deux objets,
lui, qui en a dévelopé avec tant de fag^cité &
de génie de.bien plus cachés ; & fon autorité d’ail-,
leurs fi refpeClable , a tellement arrêté- les progrès
de la vérité, & mafqué.même celle que Glauber
, de Reffons, Lemery lefils, M. Bourdêlin , &c.
Vjye^Mérn.deTac. des.Scienc. avojent dévoilée , que
les dogmes des chimilles modernes fur ,l’origine du
nitre font devenus depuis-quelque tems de. plus en
plus fuperficiels, vains » gratuits., &c. que fans contredit
ce qui ell contenu ! ce fuj.et dans les nouvelles
vérités de M. Jufli, ell marqué à ce coin > 6C
plus encore la differtation de M. le D. Pietfch , qui
a remporté, le prix de l’académie de Berlin,, en 1749,.
& les penfée's du même auteur fur la multiplication
du.«/>«.. J’ofe- àffurer au contraire qu’un très grand
nombre,d’expériences que j’ai faites dans le laboratoire
de feu M. le duc d’Orléans , la plupart d’après
les vues de Glauber , ont toutes concouru à établir
la do&rine de ce chimille; & promettre avec confiance
cl après ce travail, que j ’achèverai peut-être
un jour, un fyftêmç complet 6c démontré fur toutes
les fources du nitre, fur fa formation ou fon abord,
accefjus,adyentus,dans fes matrices ordinaires, & en-,
fin fur les diverfes manoeuvres employées dans fa.
fabrication, fur le prétendu amendement ou ré animation
des terres déjà leffivées , &c. protellant hautement
que toutes ces manoeuvres font la plupart
vaines , mal entendues * ou au moins imparfaites;
& que.de touts les arts chimiques nul ne peut recevoir
plus immédiarement que la fabrique du falpe-
tre , des corrections 6c des perfeclionemens prompts
& utiles de la. fcience.
4°. Enfin ,dl doit paroître fingulier que les chimif-
tes qui ont iméconnu l’origine du nitre , 6c qui ont
enfanté des hypothèl'eS pour expliquer fa génération
dans l’atnjofphere , ou dans la terre , aient parfaitement
négligé de s’occuper en même tems de la formation
du fel commun , qui accompagne le. nitre
prefque toujours. Cette fa u té ell toute fimple dans
le vrai fyllème ; les végétaux contiennent ces deux
fels à-peu-pres dans la même proportion que celle
dans laquelle on les retrouve dans les cuites.'
Le falpetre le plus rafiné le falpetre de la troi-
fieme cuite , le falpetre lé plus pur que fourniffent
les attelierSjrt’efi: encore affez pur ni pour pouvoir en
faire une analyfe exaâe,ni pour les travaux chimiques
réguliers , ou pour les ufages pharmaceutiques. On
le purifie donc dans les laboratoires des chimilles ,
6c dans les boutiques des apoticaires, dans la vue
d’en féparer un peu de fel marin , & un relie d’eau-
mere , qu’on y trouve toujours mêlés. Pour cet effet,
on diffout le nitre dans de l ’eau commune, ou dans
de l’eau dillillée, fi , pour certaines expériences très*.
délicates o.n.fe propofe l’ex.aClitude la plus févere ;
mais ordinairement dans de l’eau de riviere , ou de
fontaine; on filtre la diffolution , & onia fait cryf-
tallifer, félon:l’art, voye[ CftysTALLisa t i o n . Par
cette opération* le falpetre fe fépare exactement du
fel marin, parcequè.çes deux fels ne cryltallifent
pas dans le même rems ; le nitre fe préfente feul dans
les premières eryltallifations, parce qu’il ell très-
dominant. Onp.eut, .lorlqu’après avoir féparé beaucoup
de «//«,'le fel marin & le nitre reliant font
dansune,pr$poi;tionbien différente, faire' bouillir;