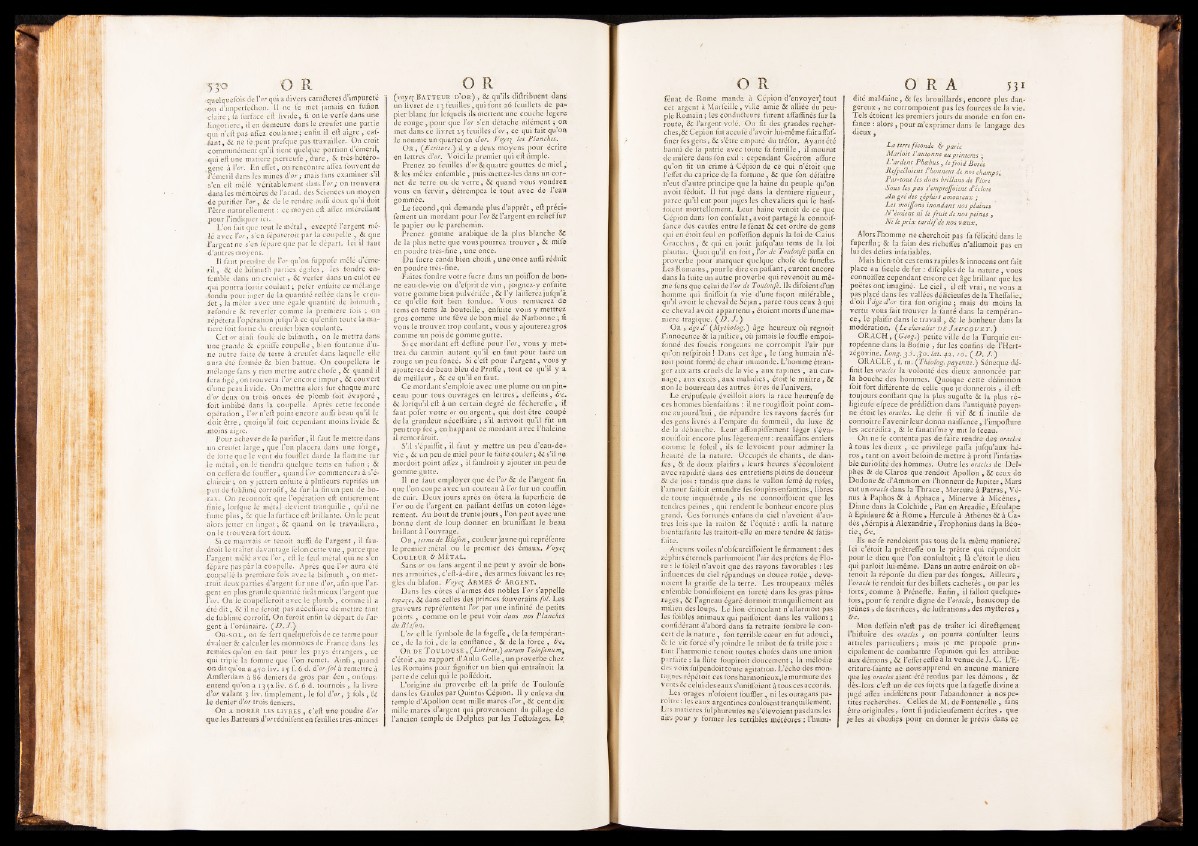
quelquefois de l’or qui a divers caraCteres d’impureté
-ou d’imperfeCtion. Il ne fe met jamais en fufion
-claire ; fa furface eft livide., fi on le verfe dans une
linc'Otiere, il en demeure dans le creufet une partie
-qufn’eft pas affez coulante; enfin il eft aigre , caf-
iant, & ne fepeut prefque pas travailler. On croit
communément qu’il tient quelque portion d’emeril,
-qui eft une matière pierreufe , dure, & très hétero-
.gene à l’or. En effet, on rencontre affez fou vent de
■ l’émeril dans les mines d’or; mais fans examiner s’il
s’en eft mêlé véritablement dans Yor.; on trouvera
dans les mémoires d el’acad. des Sciences un moyen
de purifier l’or, & de le rendre aufli doux qu’il doit
l’être naturellement : ce moyen eft affez intéreffant
.pour l’indiquer ici.
L’on fait que tout le m étal, excepté l’argent mêlé
avec Vor, s ;en fépareroit par la coupelle , & que
l ’argent ne s’en fépare que .par le départ. Ici il faut
•d’autres moyens.
Il faut prendre de l’or qu’on fuppofe mêlé d’éme-
«ril, 5c de bifmuth parties égales, les fondre ensemble
dans un creufet, 5c verfer dans un culot ce
.qui pourra fortir coulant ; pefer enfuite ce mélange
fondu pour juger de la quantité reftée dans le creufet
, la mêler avec une égale quantité de bifmuth,
refondre 5c reverfer comme la première fois ; on
répétera l’opération jufqu’à ce qu’enfin toute la matière
foit fortie du creufet bien coulante.
Cet or ainfi foulé de bifmuth, on le mettra dans
une grande & épaiffe coupelle , bien foutenue d’une
autre faite de terre à creufet dans laquelle elle
aura été formée 5c bien battue. On coupellera le
■ mélange fans, y rien mettre autre chofe , & quand il
•fera figé, on trouvera Y or encore impur, 5c couvert
-d’une peau livide. On mettra alors fur chaque marc
d ’or deux ou trois onces de plomb foit; évaporé ,
foit imbibé dans la coupelle. Après cette fécondé
opération , l’or n’eft point encore aufîi beau qu’il le
doit être, quoiqu’il foit cependant moins livide 5c
.moins aigre.
Pour achever de le purifier, il faut le mettre dans
un creufet large , que l’on placera dans une forge,
de forte que le vent du fouffiet darde la flamme fur
le métal, on le tiendra quelque tems en fufion ; &
on ceffera de fouffler, quand l’or commencera à s’éclaircir
; on y jettera enfuite à plufieurs reprifes un
peu de fublimé corrofif, 5c fur la fin un peu de borax.
On yeconnoît que l’opération eft entièrement
finie, lorfque le métal devient tranquille , qu’il ne
fume plus, 5c que la furface eft brillante. On le peut
alors jetter en lingot ; 5c quand on le travaillera,
on le trouvera fort doux.
Si ce mauvais or tenoit aufli de l’argent, il fau-
droit le traiter davantage félon cette vu e , parce que
l ’argent mêlé avec l’or, eft le feul métal qui ne s’en
fépare pas par la coupelle. Après que l’or aura été
xoupellé la première fois avec le.bifmuth , on met-
<troit deux parties d’argent fur une d’or, afin que Tardent
en plus grande quantité tirât mieux l’argent que
l ’or. On le coupélleroit avec le plomb , comme il a
•été dit, & il ne feroit pas néceffaire de mettre tant
-de fublimé corrofif. On feroit enfin le départ de l’argent
à l’ordinaire. (-D. /.)
Or-sol , on fe fert quelquefois de ce terme pour
évaluer & calculer les monnoies de France dans les
rremifes qu’on en fait pour les pays étrangers , ce
qui triple la fomme que l’on remet. Ainfi , quand
on dit qu’on a 450 liv. 15 f. 6 d. d’or-fol à remettre à
Amfterdam à 86 deniers de gros par écu , ou fous-
.entend qu’on a i3 ç z liv . 6 f.,6 d. tournois , la livre
d’or valant 3 liv. Amplement, le fol d’or, 3 fols , 5c
le denier d’or trois deniers.
Or a dorer les livres , c ’eft une poudre d’or
que les Batteurs d’orréduifent en feuilles très -minces
Cvoyei Ba t t eu r d’or) , & qu’ils diftribuent dans
un livret de 13 feuilles, qui font z6 feuillets de papier
blanc fur lefquels ils mettent une couche legere
de rouge ,pour que l’or s’en détache aifément ; on
met dans ce livret 15 feuilles d’or, ce qui fait qu’on
•le nomme un-quarteron d’or. Voyt{ les Planches.
O r , (Ecriture.) il y a deux moyens pour écrire
-en lettres d’or. Voici le premier qui eft Ample.
Prenez 20 feuilles d’or & quatre gouttes de miel,
& les mêlez enfemble, puis mettez-les dans un cornet
de terre, ou de verre, 5c quand vous .voudrez
vous en fervir, détrempez le tout avec de l ’eau
gommée.
Le fécond, qui demande plus d’apprêt, eft préci-
fement un mordant pour l’or & l’argent en relief fur
le papier ou le parchemin.
Prenez gomme arabique de la plus blanche 5c
de la plus nette que vous pourrez trouver, & mife
en poudre très-fine , une once.
Du fucre candi bien choifi, une once aufli réduit
en poudre très-fine.
Faites fondre votre fucre dans un poiffon de bonne
eau-de-vie ou d’elprit de vin , joignez-y enfuite
votre gomme bien pulvérifée, 5c l’y laifferez jufqu’à
ce qu’elle foit bien fondue. Vous remuerez de
tems en tems la bouteille , enfuite vous y mettrez
gros comme une fève de bon miel de Narbonne ; fi
vous le trouvez trop coulant, vous y ajouterez gros
comme un pois de gomme gutte.
Si ce mordant eft deftiné pour l’or, vous y mettrez
du carmin autant qu’il en faut pour faire un
rouge un peu foncé. Si c’eft pour l’argent, vous y
ajouterez de beau bleu de Pruffe , tout ce qu’il y a
de meilleur, 5c ce qu’il en faut.
Ce mordant s’emploie avec une plume ou un pinceau
pour tous ouvrages en lettres, deffeins, &c.
5c lorlqu’il eft à un certain degré de féchereffe , il
faut pofer votre or ou argent , qui doit être coupé
de la grandeur néceflaire ; s’il arrivoit qu’il fût un
peu trop fe c , en happant ce mordant avec l ’haleine
il remordroit.
SM s’épaiflit, il faut y mettre un peu d’eau-de-
vie , & un peu de miel pour le faire couler ; 5c s’il ne
mordoit point affez , il faudroit y ajouter un peu de
gomme gutte.
Il ne faut employer que de l’or & de l ’argent fin
que l’on coupe avec un couteau à l’or fur un couflin
de cuir. Deux jours après on ôtera la fuperficie de
l’or ou de l’argent en paffant deffus un coton légèrement.
Au bout de trente jours, l’on peut avec une
bonne dent de loup donner en brunifl'ant le beau
brillant à l’ouvrage.
O r , terme de Blafon, couleur jaune qui repréfente
le premier métal ou le premier des émaux. Voytç
C o u l e u r & Mé t a l .
Sans or ou fans argent il ne peut y avoir de bonnes
armoiries, c’eft-à-dire , des armes fuivant les réglés
du blafon. Voye^ A rmes & Arg en t.
Dans les côtes d’armes des nobles l’or s’appelle
topaze, 5c dans celles des princes fouverains /oZ. Les
graveurs repréfenteht l’or par une infinité de petits
points , comme on le peut voir dans nos Planches
du Blafon.
L’or eft le fymbole de la fagefle, de la tempérance
, de la f o i , de la confiance , & de la force , &c.
O r DE TOULOUSE , ( Liitérat.) aurum Tolofanum,
c’étoit, au rapport d’Aulu Gelle, un proverbe chez
les Romains pour lignifier un bien qui entraînoit la
perte de celui qui le poffédoit.
L’origine du proverbe eft la prife de Touloufe
dans les Gaules par Quintus Cépion. Il y enleva du
temple d’Apollon cent mille marcs d’or, 5c cent dix
mille marcs d’argent qui provenoient du pillage de
l’ancien temple de Delphes par les TeCtofages. Le
fénat de Rome manda à Cépion d’envoyer] tout
cet argent à Marfeille, ville amie & alliée du peuple
Romain ; les conducteurs furent affaflinés fur la
route, 5c l’argent volé. On fit des grandes recherch
e s^ Cépion fut accufé d’avoir lui-même faitaffaf-
finer fes gens, 5c s’être emparé du tréfor. Ayant été
banni de fa patrie avec toute fa famille , il mourut
de mifere dans fon exil : cependant Cicéron affure
qu’on fit un crime à Cépion de ce qui n’étoit que
l’effet du caprice de la fortune, & que fon défaftre
n’eut d’autre principe que la haine du peuple qu’on
avoit féduit. Il fut jugé dans la derniere rigueur,
parce qu’il eut pour juges les chevaliers qui le haïf-
ioient mortellement. Leur haine venoit de ce que
Cépion dans fon confulat, avoit partagé la connoif-
fance des caufes entre le fénat & cet ordre de gens
qui en étoit feul en poffeflion depuis la loi de Caius
Gracchus, & qui en jouit jufqu’au tems de la loi
plautia; Quoi qu’il en foit, Yor de Touloufe paffa en
proverbe pour marquer quelque chofe de funefte.
Les Romains, pour le dire en paffant, eurent encore
dans la fuite un autre proverbe qui revenoit au même
fens que celui de Yor de Touloufe. Ils difoient d’un
homme qui finiffoit fa vie d’une façon miférable,
qu’il avoit le cheval de Séjan, parce tous ceux à qui
ce cheval avoit appartenu, étoient morts d’une maniéré
tragique. (D . / .)
Or , â g e d ' (MythologY) âge heureux où regnoit
l’innocence & la juftice, où jamais le foufBe empoi-
fonné des foucis rongeans ne corrompit l’air pur
qu’on refpiroit ! Dans cet âge , le fang humain n’étoit
point formé de chair immonde. L’homme étranger
aux arts cruels de la vie , aux rapines , au carnage
, aux excès , aux maladies, étoit le maître, 5c
non le bourreau des autres êtres de l’univers.
Le crépufcule éveilloit alors la race heureufe de
ces hommes bienfaifans : il ne rougifl'oit point comme
aujourd’h u i, de répandre Tes rayons facrés fur
des gens livrés à l ’empire du fommeil, du luxe 5c
de la débauche. Leur affoupiffement léger s’éva-
nouiffoit encore plus légeremenr : renaiffans entiers
comme le foleil , ils 1e levoient pour admirer la
beauté de la nature. Occupés de chants, de dan-
fes , & de doux plaifirs , leurs heures s’écouloient
avec rapidité dans des entretiens pleins de douceur
& de joie: tandis que dans le vallon femé de rofes,
l’amour faifoit entendre fes foupirsenfantins, libres
de toute inquiétude , ils ne connoiffoient que les
tendres peines , qui rendent le bonheur encore plus
grand. Ces fortunés enfans. du ciel n’avoient d’autres
lois que la raifon 5c l’équité : aufli la nature
bienfaifante les traitoit-elle en mere tendre 5c fatis-
faite.
Aucuns voiles n’obfcurciffoient le firmament : des
zéphirs éternels parfumoient l’air des préfens de Flore
: le foleil n’avoit que des rayons favorables : les
influences du ciel répandues en douce rolée, deve-
noient la graiffe de la terre. Les troupeaux mêlés
enfemble bondiffoient en fureté dans les gras pâturages
, 5c l’agneau égaré dormoit tranquillement au
milieu des loups. Le lion étincelant n’allarmoit pas
les foibles animaux qui paiffoient dans les vallons ;
confidérant d’abord dans fa retraite fombre le concert
de la nature, fon terrible coeur en fut adouci,
& fe vit forcé d’y joindre le tribut de fa trifte joie :
tant l'harmonie tenoit toutes chofes dans une union
parfaite : la flûte foupiroit doucement ; la mélodie
des voix fufpendoit toute agitation. L’écho des montagnes
répétoit ces Ions harmonieux,le murmure des
vents Sc celui des eaux s’uniffoient à tous ces accords.
Les orages n’ofoient fouflïer, ni les ouragans pa-
ronre: les eaux argentines coûtaient tranquillement.
Lys matières fulphureufes ne s’élevoient pas dans les
airs pour y former les terribles météores ; l’hurnidité
mal-faine, & le s brouillards, encore plus dangereux
, ne corrompoient pas les fources de la vie.
Tels étoient les premiers jours du monde en fon enfance
: alors , pour m’exprimer dans le langage des
dieux,
La terre féconde & parée
Marïoit V au tonne au printems ;
L ’ardent Phabus, le froid Borée
Refpecloient Ühonneur de nos champs
Par-tout les dons brillans de Flore
Sous les pas s’'empreffoient d? éclore
Au gré des [ éphirs amoureux ;
Les moiffons inondant nos plaines
N ’étoient ni le fruit de nos peines ,
. .N i le prix tardif de nos vaux.
Alors l’homme ne cherchoit pas fa félicité dans le
fuperflu ; & la faim des richeffes n’allumoit pas en
lui des defirs infatiables.
Mais bien-tôt ces tems rapides & innocens ont fait
place au fiecle de fer : difeipies de la nature, vous
connoiffez cependant encore cet âge brillant que les
poètes ont imaginé. Le c ie l, il eft v rai, ne vous a
pas placé dans les vallées délicieufes de la Theffalie,'
d’où Y âge d’or tira fon origine ; mais du moins la
vertu vous fait trouver la fanté dans la tempérance
, le plaifir dans le travail, 5c le bonheur dans la
modération. (Le chevalier d e Ja u c o v r T.')
OR ACH, ( Gêog.) petite ville de la Turquie européenne
dans la Bofnie , fur les confins de l’Hert-,
zégovine. Long, g S. 30 . lat. 42. 16. ( D . J. )
OR ACLE, i . m. ( Théolog. payennt. ) Séneque définit
les oracles la -volonté des dieux annoncée par
la bouche des hommes. Quoique cette définition
foit fort différente de celle que je donnerois , il eft
toujours confiant que la plus augufte & la plus ré-
ligieufe efpece de prédiction dans l’antiquité payen-
ne étoit les oracles. Le defir fi v if 5c fi inutile de
connoître l’avenir leur donna naiffance, Timpofture
les accrédita , & le fanatifme y mit le fceau.
On ne fe contenta pas de faire rendre des oracles
à tous les dieux , ce privilège paffa jufqu’aux héros
, tant on avoit befoin de mettre à profit i’infatia-
ble curiofité des hommes. Outre les oracles de Delphes
St de Claros que rendoit Apollon , & ceux de
Dodone 5c d’Ammon en l’honneur de Jupiter, Mars
eut un oracle dans la Thrace, Mercure à Patras, Vénus
à Paphos & à Aphaca , Minerve à Micènes,
Diane dans la Colchide , Pan en Arcadie, Efculape
à Epidaure & à Rome, Hercule à Athènes & à Ca-
dès ,Sérapisà Alexandrie, Trophonius dans la Béo-,
t ie , &c.
Ils né fe rendoient pas tous de la même manierei
Ici c’étoit la prêtreffe ou le prêtre qui répondoit
pour le dieu que l’on confultoit ; là c’étoit le dieu
qui parloit lui-même. Dans un autre endroit on ob-
tenoit la réponfe du dieu par des fonges. Ailleurs ,
Y oracle fe rendoit fur des billets cachetés , ou par les
forts, comme à Prénefte. Enfin, il falloit quelquefois,
pour fe rendre digne de Y oracle, beaucoup de
jeûnes , de facrifices, de iuftrations, des myfteres ,
&c.
Mon deffein n’eft pas de traiter ici directement
l’hiftoire des oracles , on pourra confulter leurs
articles particuliers ; mais je me propofe principalement
de combattre l’opinion qui les attribue
aux démons, 5c l’effet ceffé à la venue de J. C. L’E-
criture-fainte ne nous;apprend en aucune maniéré
que les oracles aient été rendus par les démons , 5c
dès-lors c’eft un de ces fujets que la fageffe divine a
jugé affez indifférens pour l’abandonner à nos petites
recherches. Celles de M. de Fontenelle , fans
être originales, font fi judicieufement écrites , que
je les ai çhoifies pour en donner le précis dans ce