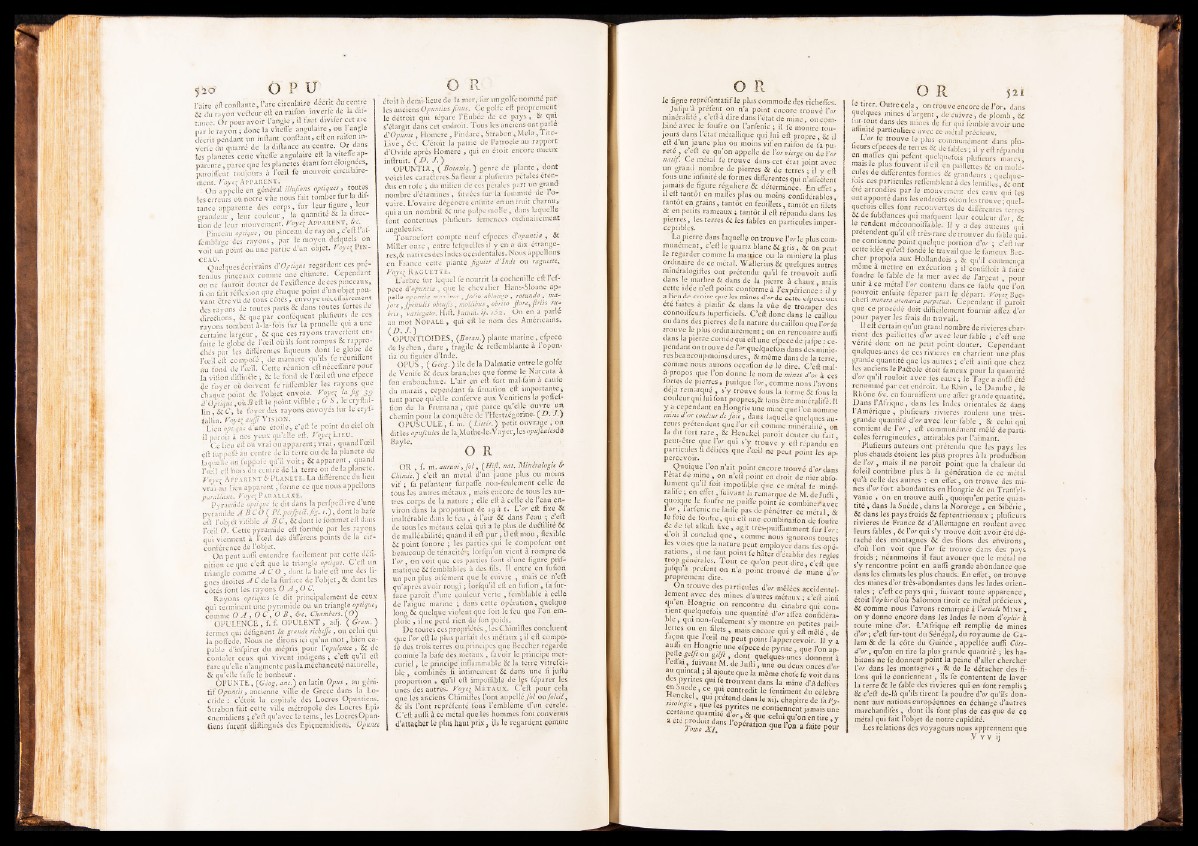
Paire eft confiante, l’arc circulaire décrit du centre
& du rayon veûeur eft en raifon inverfe de la dii-
ïance. Or pour avoir l’artgle , il faut divifer cet arc
par le rayon ; donc la vîteffe angulaire, ou 1 angle
décrit pendant un inftant confiant, eft en raifon inverfe
du qùarré de la diftance au centre. Ordans
les planètes cette vîteffe angulaire eft la vitelie apparente
, parce que les planètes étant fort éloignées,
paroiffent toujours à l’oeil fe mouvoir circulaire-
rfient. V o y t7 Ap parent;
On appelle en général illufwns optiques , toutes
les erreurs où notre vue nous fait tomber fur la alliance
apparente des corps, fur leur figure , leur
grandeur , leur couleur , la quantité ôc la direction
de leur mouvement. Voyez Apparent, &c.
Pinceau optique, ou pinceau de rayon , c elt 1 al-
fcmbla'ge des rayons, par le moyen deiquels on
voit un point ou une partie d’un objet. Voyez Pince
au . . /
Quelques écrivains d'Optique regardent ces prétendus
pinceaux comme une chimere. Cependant
on ne fauroit douter de l’exiftence deces pinceaux,
fi on fait réflexion que chaque point d’un objet pouvant
être vît de tous côtés, envoyé néceffairement
des rayons de toutes parts ôc dans toutes fortes de
direftions, & que par conléquent plufieurs de ces
rayons tombent à-la-fois fur la prunelle qui a une
certaine largeur, & que ces rayons traverfent en-
fuite le globe de l’oeil où ils font rompus ôc rapprochés
par les différentes liqueurs dont le globe de
l’oeil eft conlpofé , de maniéré qu’ils fe réunifient
au fond de l’oeil. Cette réunion eft néccffaire pour
la vifion diftirifte ; ôc le fond de l’oeil eft une efpece
<Je foyer où doivent fe faffembler les rayons que
chaque point de l'objet envoie. Voyez lafig 39
d'Optique ,où.S eft le point vifible'; G S , le c ÿ j ta g
lin , ôcC, le foyer des rayons envoyés fur le cryf-
tallin. Voyez âüffi V ISION. . " , •, ~
Lieu opaque d’une étoile, c’ cft le point du ciel ou
il paroîr à noS yeux qu’elle eft. Voyez L ieu .
' Ce lieu eft ou vrai ou apparent ; v ra i, quand l oeil
eft fuppofé au centre de là terre ou de la planete de
laquelle bn fuppofe qu’il voit ; ôc apparent, quand
i’oeil eft hors du centre de là tefre où delà planete.
Voyez Apparent & Planete. La différence du lieu
vrai au Tien apparent,'forme ce que nous appelions
p a ra lla x e . Voy ez P AR ALLAXE.
Pyramide optique fe dit dans la perfpeftive d’une
pyramide A B CO ( Pl.perfpécï.fig. / .) , dont la bafe
eft l’objet vifible A B C , Ôcdont lefommeteft dans
l’oeil O. Cette pyramide eft formée par les rayons
qui viennent à l’oeil des differens points de la circonférence
de l’objet.
On peut auffi entendre facilement par cette définition
ce que c’eft que le triangle optique. C ’eft un
triangle comme A C O , dont la bafe eft une des li-
gnestlroites A C de la furface de l’objet, & dont les
côtés font les rayons O A , 0 C.
Rayons optiques fe dit principalement de ceux
qui terminent une pyramide ou un triangle optique,
comme 0 A , 0 C , O B , &c. Chambers. ( O)
OPULENCE , f. f. OPULENT , adj. ( Gram. )
termes qui défignent la grande richejje, ou celui qui
la poffede. Nou3 ne dirons ici qu’un mot, bien capable
d’infpirer du mépris pour l'opulence , ÔC de
confoler ceux qui vivent indigens ; c’eft qu il eft
rare qu’elle n’augmente pas la méchanceté naturelle,
& qu’elle faffe le bonheur.
OPUNTE, ( Çéog. anç.) en latin Opus , au génitif
Opuntis, ancienne ville de Grece dans la Lo-
çride : c’étoit la capitale des Locres Opunticns.
Strabon fait cette ville métropole des Locres Epi-*
cnemidiens ; c’eft qu’avec le terns, les Locres Opun-
tiens furent diftingués des Epiçnemidiens. Opunte
(Soit à dcmi-lieuc de la mer, fur un golfe nommé çàŸ
lès anciens Opunuus finus. Ce golfe eft proprement
le détroit qui fépare l’Eubcc de
s’élargit dans cet endroit. Tous les anciens ont parle
d'Opunte , Homere, Pindare, Strabon, Mela-,Tite-
L iv e , &c. C ’étoit la patrie de Patrocle au rapport
d’Ovide après Homere , qui en étoit encore mieux
inftruit. (Z L J . )
OPUNTIA, ( Botaniq. ) genre de plante, dont
voici.les earafîeres.Sa fleur a plufieurs pétales étendus
en rote ; du milieu de ces pétales part un grand-
nombre d’étamines, fituées fur la fçiiimité de l’ovaire.
L’ovaire dégénéré enfuite en un fruit charnu,
qui a un nombril ôc une pulpe molle , dans laquelle
lont contenues plufieurs femences ordinairement
ànguleufes.
Tournefort compte neuf efpeces d'opuntia , &
Miller onze , entre lelquelles ii y en a dix étrangères,&
natives des Indes occidentales. Nous appelions
en F rance cette plante figuier d'Inde ou raguette.
Voyez R a g u e t te . _ ^
L’arbre fur lequel fe nourrit la cochenille eftl’ef-
ppce d’opuntia, que le chevalier Hans-Sloane appelle
opuntia maxima , joho oblctngo , rotundo , majore
, J'pinulis obtujis, mollibus, obrito fore, flriis rw-
bris, variegato. Hift. Jamaï. ij. i5z . On en a parlé
; au mot Nopale , qui eft le nom des Américains.
( D . J .)
OPUNTIOIDES, (.Botan.) plante marine, efpece
de lychen, dure , fragile ôc reliemblante à 1 opon^
tia'ou figuier d’Inde.
OPUS , ( Géog. ) île de la Dalmatie entre le golfe
de Venife Ôc deux branches que forme le Narcuta à
fon embouchure. L’air en eft- fort mal-fain à caufe
du marais , cependant fa fituatiôn eft importante j
tant parce qu’elle conferve aux Vénitiens la poffef-
fion de la Frumana, què parce qu’elle ouvre un
chemin pour la conquête de l’Hertzégorine. (Z>. Z.)
OPUSCULE, f. m. ( Littér. ) petit ouvrage , on
dit les opufcules de laJMoihe-le-Vayer, les opujculesd®
Bayle.
O R
OR , f. m. auruniyfiol, (H ifi. nat. Minéralogie &■
Chimie.) c’eft un métal d’un jaune plus ou moins
v if ; fa pefanteur furpaffe non-feulement celle de
tous les autres métaux, mais encore de tous les autres
corps de la nature ; elle eft à celle de l’eau environ
dans la proportion de 19 à 1. L’or eft fixe &
inaltérable dans le feu , à l’air & dans l’eau ; c’eft
de tous les métaux celui qui a le plus de ductilité &
de malléabilité; quand il eft pur, il eft m ou, flexible
& point fonore ; les parties qui le compofent ont
beaucoup de ténacité*; fforfqu’on vient à rompre de
l’or, on voit que ces parties font d’une figure prif-
matique & femblabies à des fils. Il entre en fufion
un peu plus aiféinent que le cuivre , mais ce n’eft
qu’après avoir rougi ; lorfqu’il. eft en fufion , fa fur-
face paroît d’une couleur verte , femblable à celle
de l’aigue marine ; dans cette opération, quelque
long &. quelque violent que foit le feu que l’on emploie
, il ne perd rien de fon poids.
Dé toutes ces propriétés, les Chimiftes concluent
que l’or eft le plus parfait des métaux ; il eft compo-
fé des trois terres pu principes que Beccher regarde
comme la bafe des métaux , favoir le principe me.tr
curiel, le principe’ inflammable & la terre vitréfei-
ble combines fi intimement ôc dans une fi jufté
proportion , qu’il eft impofîible de les féparer les
unes des autres. Voyez Mé t a u x . C ’eft pour cela
que lès anciens Chimiftes l’ont appelléj'ol ou/oleil,
ôc ils l’ont repréfenté fous l’emblème d’ un cercle,
C ’eft aufli à ce métal que les hommes font convenus
d’attacher le plus haut prix t ils le regardent comme
le figne repréfentatif le plus commode des richeffes.
Jufqu’à préfent on n’a point encore trouvé l’or
minéralifé , c’eft à dire dans l’état de mine, ou combiné
avec le foufre ou l’arfenic ; il fe montre toujours
dans letat métallique qui lui eft propre, ôc il
eft d’un jaune plus ou moins v if en raifon de fa pureté
, c’eft ce qu’on appelle de Vor vierge ou de l ’or
natif. Ce métal fe trouve dans cet état joint avec
un grand nombre de pierres ôc de terres ; il y eft
fous une infinité de formes différentes qui n’affe&ent
jamais de figure reguliere ôc déterminée. En effet,
il eft tantôt en malles plus ou moins considérables,
tantôt en grains, tantôt en feuillets, tantôt en filets
Ôc en petits rameaux ; rantôt il eft répandu dans les
pierres , les terres ôc les fables en particules imperceptibles.
La pierre dans laquelle on trouve l’or le plus communément,
c’eft le quartz blanc ôc gris, Ôc on peut
le regarder comme la matçice ou la minière la plus
ordinaire de ce métal. Wallerius ôc quelques autres
mméralogiftes ont prétendu qu’il fe trouvoit auffi
dans le marbre ôc dans de la pierre à chaux , mais
cette idée n’eft point conforme à l’expérience : il y
a lieu de croire que les mines d’or de cette efpece ont
été faites à plaifir ôc dans la vue de tromper des
connoiffeurs luperficiels. C ’eft donc dans le caillou
ou dans des pierres de la nature du caillou que l’or fe
trouve le plus ordinairement ; on en rencontre auffi
dans la pierre cornée qui eft une efpece de jafpe : cependant
on trouve de l’or quelquefois dans des minières
beaucoup moins dures, ôc même dans de la terre,
comme nous aurons occafion de le dire. C ’eft malà
propos que l’on donne le nom de mines d’or à ces
fortes de pierres, puifque l’or, comme nous l’avons
déjà remarqué , s’y trouve fous la forme Ôc fous la
couleur qui lui font propres,ôc fans être minéralifé. Il
y a cependant en Hongrie une mine que l’on nomme
mine d or couleur de foie , dans laquelle quelques au-
îeurs prétendent qiiçl’or eft comme minéralifé, oft
la dit J-or r rare, ÔC Hentkel paroît dotiter du fait
peut-etre que l’or qui s’y trouve y eft répandu en
particules fi déliées que l’oeil ne peut point les ap-
percevoir. r
Quoique l’on n’ait point encore trouvé d’or dans
I état de mine , on n’eft point en droit de nier abfo-
lument qu’il foit impoffible que ce métal fe miné-
rahfe ; en effet, fuivant la remarque de M. de Jufti
quoique le foufre ne puiffe point fe combineiAavec
1 % • j ,"1Crne laiffe Pas de pénétrer ce métal, ôc
s 11Cr 1 n i - *7 <ÏU1 une combinaifon de foufre
cc de tel alkali fixe, agit très-puiffamment fur l’or:
doit il conclud qne;, comme nous ignorons toutes
les voies que la nature peut employer dans les opé-
xations , il ne faut point fe hâter d’établir des réglés
trop générales. Tout ce qu’on peut dire, c’eft que
jufqu a prefent on n’a point trouvé de mine d’or
proprement dite.
On trouve des particules d’or mêlées accidentellement
avec des mines d’autres métaux ; c’eft ak.fi
q.uen H<Jngne on rencontre du cinabre qui contient
quelquefois une quantité d’oraffez confidéra-
t)Ie, qui non-feulement s’y montre en petites pail-
lettes ou-en fflets , mais encore qui y eft mêlé , de
façon que 1 oeil ne peut point l’appercevoir. Il y a
I que l’on ap.
pellc ^Z/^ou g d ft , dont quelques-unes donnent’ à
l effai , fuivant M. de Jufti , «ne ou deux onces d’or
’ 1 ?J?utetIue Ia même chofe fe voit dans
e n i ï lA qm fe- trouvent dans la mine d’Adelfors
ritoloJ, 1 <ïui Pretend dans le xij. chapitre de fa Pyi
i iM H B d v te& ne iamaîs I a pré nroflnît i Q i> I ^ ^.ue ce^ui on en tire , y
* CC- C3U1# contredit le fentament du célébré
Tome JT/.305 * °Perat-‘on ,que *’0» a faite pour
le tirer. Outré cela, on trouve encore de l’or, dans
quelques mines d’argent, de cuivre, de plomb , &
dans des mines de fer qui feinbie avoir une
affinité particulière avec ce métal précieux.
L or le trouve le plus communément dans plufieurs
efpeces de terres & de fables ; il y eft répandu
en malles qui pefent quelquefois plufieurs marcs,
mais le plus fouvent il eft en paillettes & en molécules
de differentes formes & grandeurs ■ quelquefois
ces particules rcffcmblent à des lentilles, & ont
ete arrondies par le mouvement des eaux ’qui les
ont apporté dans les endroits oii on les trouve ■ quelquefois
elles font recouvertes de différentes terres
de de fubftances qui mafquent leur couleur d’or 8c
le rendent méconnoiffable. II y a des auteurs qui
prétendent qu’il eft très-rare de trouver du fable qui.
ne contienne point quelque portion d’or ; c’eft lur
cette idée qu’eft fondé le travail que le fameux Bec-
cher propofa aux Hollandois , & qu’il commença
meme à mettre en exécution ; il confiftoit à faire
fondre le fable de la mer avec de l’argent , pour
unir à ce métal l’or contenu dans ce fable que l’on
pouvoit enfuite féparer part le départ. Voyez Bcc“
chéri minera arenaria perpétua. Cependant il paroît
que ce procédé doit difficilement fournir affez d’or
pour payer les frais du travail.
Il eft certain qu’un grand nombre de rivières charrient
des paillettes d’or avec leur fable ; c’eft une
vérité dont on ne peut point douter. Cependant
quelques-unes de ces rivières en charrient une plus
grande quantité que les autres ; c’eft ainfi que chez
les anciens le Paâole étoit fameux pour la quantité
d’or qu’il rouloit avec fes eaux ; le Tage a auffi été
renommé par cet endroit. Le Rhin , le Danube , le
Rhône &c. en fourniffent une affez grande quantité.
Dans l’Afrique, dans les Indes orientales Ôc dans
l’Amérique , plufieurs rivières roulent une très-
grande quantité d’or avec leur fable , & celui qui
contient de l’or , eft communément mêlé de particules
ferrugineuses, attirables par l’aimant.
Plufieurs auteurs ont prétendu que les pays les
plus chauds étoient les plus propres à la production
de l’o r , mais il ne paroît point que la chaleur du
foleil contribue plus à la génération de ce métal
qu’à celle des autres : en effet, on trouve des mines
d’or fort abondantes en Hongrie Ôc en Tranfyl-
vanie , on en trouvé auffi, quoiqu’en petite quantité
, dans la Suede, dans la Norvège, en Sibérie,
ÔC dans les pays froids ÔC feptentrionaux ; plufieurs
rivières de France ôc d’Allemagne en roulent avec
leurs fables, ôc l’or qui s’y trouve doit avoir été détaché
des montagnes ôc des filons des environs,
d’où l’on voit que l’or fe trouve dans des pays
froids ; néanmoins il faut avouer que le métal ne
s’y rencontre point en auffi grande abondance que
dans les climats les plus chauds. En effet , on trouve
des mines d’or très-abondantes dans les Indes orientales
; c’eft ce pays q u i, fuivant toute apparence,
étoit Yophirfl’où Salomon tiroit ce métal précieux ,
ôc comme nous l’avons remarqué à Y article Min e ,
on y donne encore dans les Indes le nom tfophir à
toute mine d’or. L ’Afrique eft remplie de mines
d’or ; c ’eft fur-tout du Sénégal, du royaume de Ga-
Iam & de la côte du Guinee, appellée auffi Côte-
d’or, qu’on en tire la plus grande quantité ; les ha-
bitans ne fe donnent point la peine d’aller chercher
l’or dans les montagnes , & de le détacher des filons
qui le contiennent, ils fe contentent de laver
la terre ôc le fable des rivières qui en font remplis ;
Ôc c ’eft de-là qu’ils tirent la poudre d’or qu’ils donnent
aux nations européennes en échange d’autres
marchandifes , dont ils font plus de cas que de ce
métal qui fait l’objet de notre cupidité.
Les relations des voyageurs nous apprennent que
Y v v ij