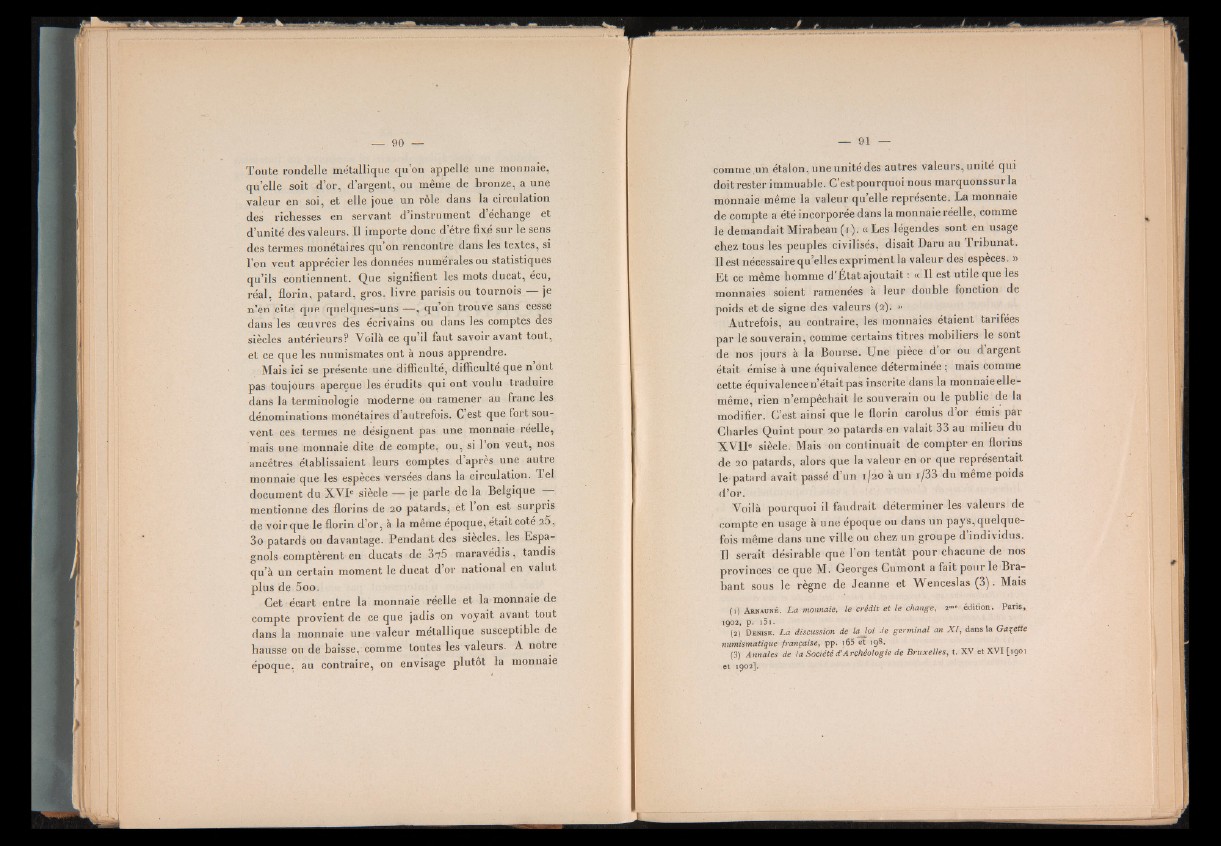
Toute rondelle métallique qu’on appellé une monnaie,
qu’elle soit d’or, d’argent, ou même de bronze, a une
valeur en soi, et elle joue un rôle dans la circulation
des richesses en servant d’instrument déchange et
d’unité des valeurs. Il importe donc d’être fixé sur le sens
des termes monétaires qu’on rencontre dans les textes, si
l’on veut apprécier les données numérales ou statistiques
qu’ils contiennent. Que signifient les mots ducat, ecu,
réal. florin, patard, gros, livre parisis ou tournois je
n’en cite que quelques-uns —, qu’on trouve sans cesse
dans les oeuvres des écrivains ou dans les comptes des
siècles antérieurs? Voilà ce qu’il faut savoir avant tout,
et ce que les numismates ont à nous apprendre.
Mais ici se présente une difficulté, difficulté que n ont
pas toujours aperçue les érudits qui ont voulu traduire
dans la terminologie moderne ou ramener a,u franc les
dénominations monétaires d’autrefois. C est que fort souvent
ces termes ne désignent pas une monnaie réelle,
mais une monnaie dite de compte, ou, si 1 on veut, nos
ancêtres établissaient leurs comptes d après une autre
monnaie que les espèces versées dans la circulation. Tel
document du XVIe siècle t— je parle de la Belgique
mentionne des florins de 20 patards, et Ion est surpris
de voir que le florin d’or, à la même époque, était coté 25,
3o patards ou davantage. Pendant des siècles, les Espagnols
comptèrent en ducats de 375 maravédis, tandis
qu’à un certain moment le ducat d’or national en valut
plus de 5oo.
Cet écart entre la monnaie réelle et la monnaie de
compte provient de ce que jadis on voyait avant tout
dans la monnaie une valeur métallique susceptible de
hausse 011 de baisse, comme toutes les valeurs. A notre
époque, au contraire, on envisage plutôt la monnaie
comme,un étalon, une unité des autres valeurs, unité qui
doit rester immuable. C’est pourquoi nous marquonssurla
monnaie même la valeur qu’elle représente. La monnaie
de compte a été incorporée dans la monnaie réelle, comme
le demandait Mirabeau (y). « Les légendes sont en usage
chez tous les peuples civilises, disait Daru au Tribunat.
Il est nécessaire qu’elles expriment la valeur des espèces. »
Et ce même homme d’État ajoutait : « Il est utile que les
monnaies soient ramenées à leur double fonction de
poids et de signe des valeurs (2). »
Autrefois, au contraire, les monnaies étaient tarifées
par le souverain, comme certains titres mobiliers le sont
de nos jours à la Bourse. Une pièce d’or ou d’argent
était émise à une équivalence déterminée; mais comme
cette équivalence n’était pas inscrite dans la monnaieelle-
même, rien n’empêchait le souverain ou le public de la
modifier. C’est ainsi que le florin carolus d’or émis par
Charles Quint pour 20 patards en valait 33 au milieu du
XVIIe siècle. Mais on continuait de compter en florins
de 20 patards, alors que la valeur en or que représentait
le patard avait passé d un 1/20 a un i/33 du meme poids
d ’or.
Voilà pourquoi il faudrait déterminer les valeurs de
compte en usage à une époque ou dans un pays,quelquefois
même dans une ville ou chez un groupe d’individus.
Il serait désirable que l’on tentât pour chacune de nos
provinces ce que M. Georges Cumont a fait pour le Bra-
bant sous le règne de Jeanne et Wenceslas (3). Mais
(1) A r n a u n è . La monnaie, le crédit et le change, 2“ ' .édition. Paris,
1902, p. i 5 i.
(2) Denise. Là discussion de la loi de germinal an X t , d an s la G ale tte
numismatique française, pp. i 65 et 198.
(3) Annales de la Société d Archéologie de Bruxelles, t. XV et XVI [1901
e t 1902].