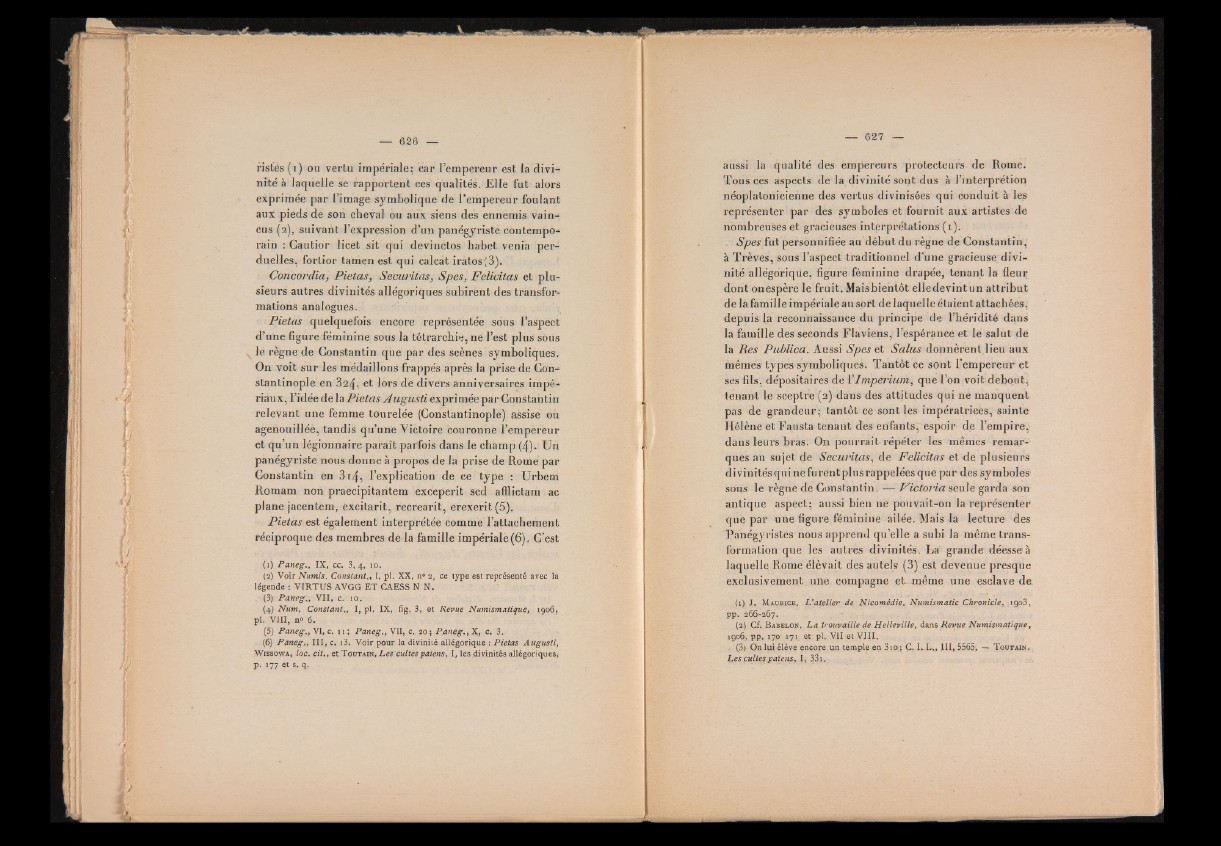
ristes (i) ou vertu impériale; car l’empereur est la divinité
à laquelle se rapportent ces qualités. Elle fut alors
exprimée par l’image symbolique de l ’empereur foulant
aux pieds de son cheval ou aux siens des ennemis vaincus
(2), suivant l’expression d’un panégyriste contemporain
: Cautior licet sit qui devinctos habet venia per-
duelles, fortior tamen est qui calcat iratos (3). '
Concordia, Pietas, Securitas, Spes, Félicitas et plusieurs
autres divinités allégoriques subirent des transformations
analogues.
Pietas quelquefois encore représentée sous l’aspect
d’une figure féminine sous la tétrarchie, ne l’est plus sous
le règne de Constantin que par des scènes symboliques.
On voit sur les médaillons frappés après la prise de Constantinople
en 324, et lors de divers anniversaires impériaux,
l’idée de la Pietas Augusti exprimée par Constantin
relevant une femme tourelée (Constantinople) assise ou
agenouillée, tandis qu’une Victoire couronne l’empereur
et qu’un légionnaire paraît parfois dans le champ (4). Un
panégyriste nous donne à propos de la prise de Rome par
Constantin en 3 t4 , l’explication de ce type : Urbem
Romam non praecipitantem exceperit sed afflictam ac
plane jacentem, excitarit, recrearit, erexerit(5).
Pietas est également interprétée comme l’attachement
réciproque des membres de la famille impériale (6). C’est
(1) Paneg.y IX, cc. 3, 4, 10.
(2) Voir Numis. Constant., I, p!. XX, n° 2, ce type est représenté avec la
légende : VIRTÜS AVGG ET CAESS N N .
(3) Paneg.y VII, c. 10.
(4) Num. Constant., I, p l . IX, fig. 3, et Revue Numismatique, 1906,
pl. VIII, n° 6.
(5) Paneg.y VI, c. 11 ; Paneg.y VII, c.. 20 ; Paneg.y X, c. 3.
(6 ) Pànég,, III, c. i 3. V o i r p o u r l a d i v i n i t é a l l é g o r i q u e : Pietas Augusti,
W i s s o w a , loc. c it., e t T o u t a i n , L e s cultes païens y I , l e s d i v i n i t é s a l l é g o r i q u e s ,
p . 1 7 7 e t s . q .
aussi la qualité des empereurs protecteurs de Rome.
Tous ces aspects de la divinité sont dus à l’interprétion
néoplatonicienne des vertus divinisées qui conduit à les
représenter par des symboles et fournit aux artistes de
nombreuses et gracieuses interprétations (i).
, Spes fut personnifiée au débutdu règne de Constantin,
à Trêves, sous l’aspect traditionnel d’une gracieuse divinité
allégorique, figure féminine drapée, tenant la fleur
dont onespère le fruit. Maisbientôt elledevintun attribut
delà famille impériale au sort de laquelle étaient attachées,
depuis la reconnaissance du principe de l’héridité dans
la famille des seconds Flaviens, l’espérance et le salut de
la Res Publica. Aussi Spes et Salus donnèrent lieu aux
mêmes types symboliques. Tantôt ce sont l’empereur et
ses fils, dépositaires de Y Imperium, que l’on voit debout,
tenant le sceptre (2) dans des attitudes qui ne manquent
pas de grandeur; tantôt ce sont les impératrices, sainte
Hélène et Fausta tenant des enfants, espoir de l’empire,
dans leurs bras. On pourrait répéter les mêmes remarques
au sujet de Securitas, de Félicitas et de plusieurs
divinitésquinefurentplusrappeléesque par des symboles
sous le règne de Constanli 11 'yJ-A Victoria seule garda son
antique aspect; aussi bien ne pouvait-on la représenter
que par une figure féminine ailée. Mais la lecture des
Panégyristes nous apprend qu’elle a subi la même transformation
que les autres divinités. La grande déesse à
laquelle Rome élèvait des autels (3) est devenue presque
exclusivement une compagne et même une esclave de
(1) J. M a u r i c e . L ’atelier de Nicomédie. Numismatic Chronicle, 1908,
pp. 266-267.
( 2 ) Cf. B a b e l o n . La trouvaille de Helleville, d a n s Revue Numismatique,
1906, pp. 170 171, et p l . VII et VIII.
. (3) On lui élève encore un temple en 3 io;_; Ç. I. L., III, 5565, — T o u t a i n .
Les cultes païens, I . 331.