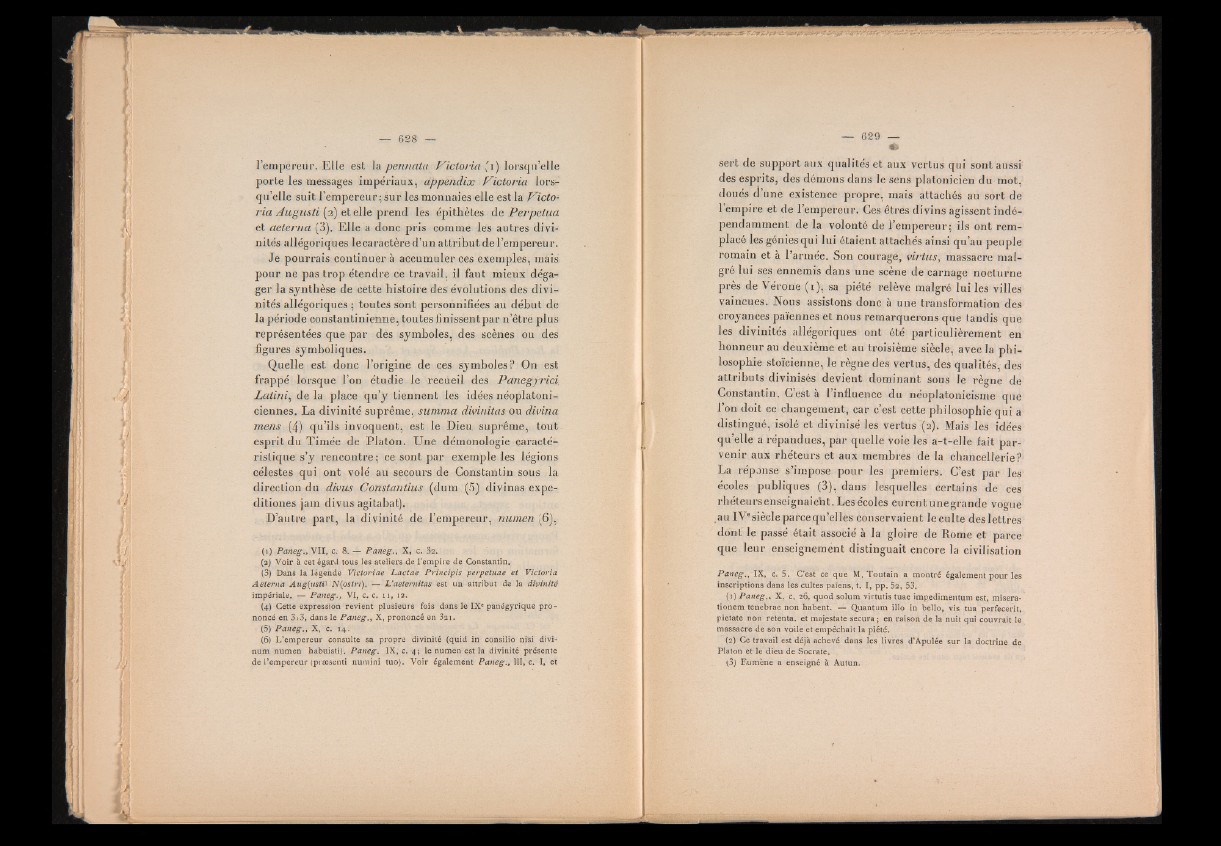
l’empereur. Elle est la pennata Victoiia ,'i) lorsqu’elle
porte les messages impériaux, appendix Victoria lorsqu’elle
suit l’empereur;sur les monnaies elle est la Victoria
Augusti (2) et elle prend les épithètes de Perpetua
et aeterna (3). Elle a donc pris comme les autres divinités
allégoriques lecaractère d’un attribut de l’empereur.
Je pourrais continuer à accumuler ces exemples, mais
pour ne pas trop étendre ce travail, il faut mieux dégager
la synthèse de cette histoire des évolutions des divinités
allégoriques ; toutes sont personnifiées au début de
la période constantinienne, toutes finissent par n ’être plus
représentées que par des symboles, des scènes ou des
figures symboliques.
Quelle est donc l’origine de ces symboles? On est
frappé lorsque l’on étudie le recueil des Panegirici.
Latini, de la place qu’y tiennent les idées néoplatoniciennes.
La divinité suprême, summa divinitas ou divitia
mens (4) qu’ils invoquent, est le Dieu, suprême, tout
esprit du Timée de Platon. Une démonologie caractéristique
s’y rencontre; ce sont par exemple les légions
célestes qui ont volé au secours de Constantin sous la
direction du divus Constantius (dum (5J divinas expe-
ditiones jam divus agitabat).
D’autre part, la divinité de l’empereur, numen *6),
(1) Paneg., VII, c. 8. — Paneg., X, c. 32.
(2) Voir à cet égard tous les ateliers de l'empire de Constantin.
(3) Dans la légende Victoriae Lactae Principis perpetuae et Victoria
Aeierna Aug(iisti\ N(ostri). — L ’aeternitas est un attribut de la divinité
impériale. — Paneg., VI, c. c. 11, 12.
(4) Cette expression revient plusieurs fois dans le IXe panégyrique prononcé
en 3 13, dans le Pan eg ., X, prononcé en 321.
(5) Pan eg., X, c. 14.
(6) L’empereur consulte sa propre divinité (quid in consilio ni'si divi-
num numen habuisti). Paneg. IX; c . -4; le numen est la divinité présente
de l’empereur (præsenti numini tuo). Voir également Paneg;, 111, c. I, et
sert de support aux qualités et aux vertus qui sont aussi
des esprits, des démons dans le sens platonicien du mot,
doués d’une existence propre, mais attachés au sort de
1 empire et de l’empereur. Ces êtres divins agissent indépendamment
de la volonté de l’empereur; ils ont remplacé
les génies qui lui étaient attachés ainsi qu’au peuple
romain et à l’armée. Son courage, virtus, massacre malgré
lui ses ennemis dans une scène de carnage nocturne
près de Vérone (i), sa piété relève malgré lui les villes
vaincues. Nous assistons donc à une transformation des
croyances païennes et nous remarquerons que tandis que
les divinités allégoriques ont été particulièrement en
honneur au déuxième et au troisième siècle, avec la philosophie
stoïcienne, le règne des vertus, des qualités, des
attributs divinisés devient dominant sous le règne de
Constantin. C’est à l’influence du néoplatonieisme que
l’on doit ce changement, car c’est cette philosophie qui a
distingué, isolé et divinisé les vertus (2). Mais les idées
qu’elle a répandues, par quelle voie les a-t-elle fait parvenir
aux rhéteurs et aux membres de la chancellerie?
La réponse s’impose pour les premiers. C’est par les
écoles publiques (3), dans lesquelles certains de ces
rhéteursenseignaieht.Les écoles eurentunegrande vogue
au IVe siècle parce qu’elles conservaient le culte des lettres
dont le passé était associé à la gloire de Rome et parce
que leur enseignement distinguait encore la civilisation
Paneg., IX, c. 5 . C'est ce que M. Toutain a montré également pour les
inscriptions dans les cultes païens, t. I, pp. 52, 53.
(î) Paneg.* X, c. 26, quod solum virtutis tuae impedimentum est, misera-
tionem tenebrae non habent. — Quantum illo in bello, vis tua perfecerit,
pietate non retenta, et majestate secura ; en raison de la nuit qui couvrait le
massacre de son voile et empêchait la piété.
(2) Ce travaîlest déjà achevé dans les livres d’Apulée sur la doctrine de
Platon et le dieu de Socrate. .
^3) Eumène a enseigné à Autun.