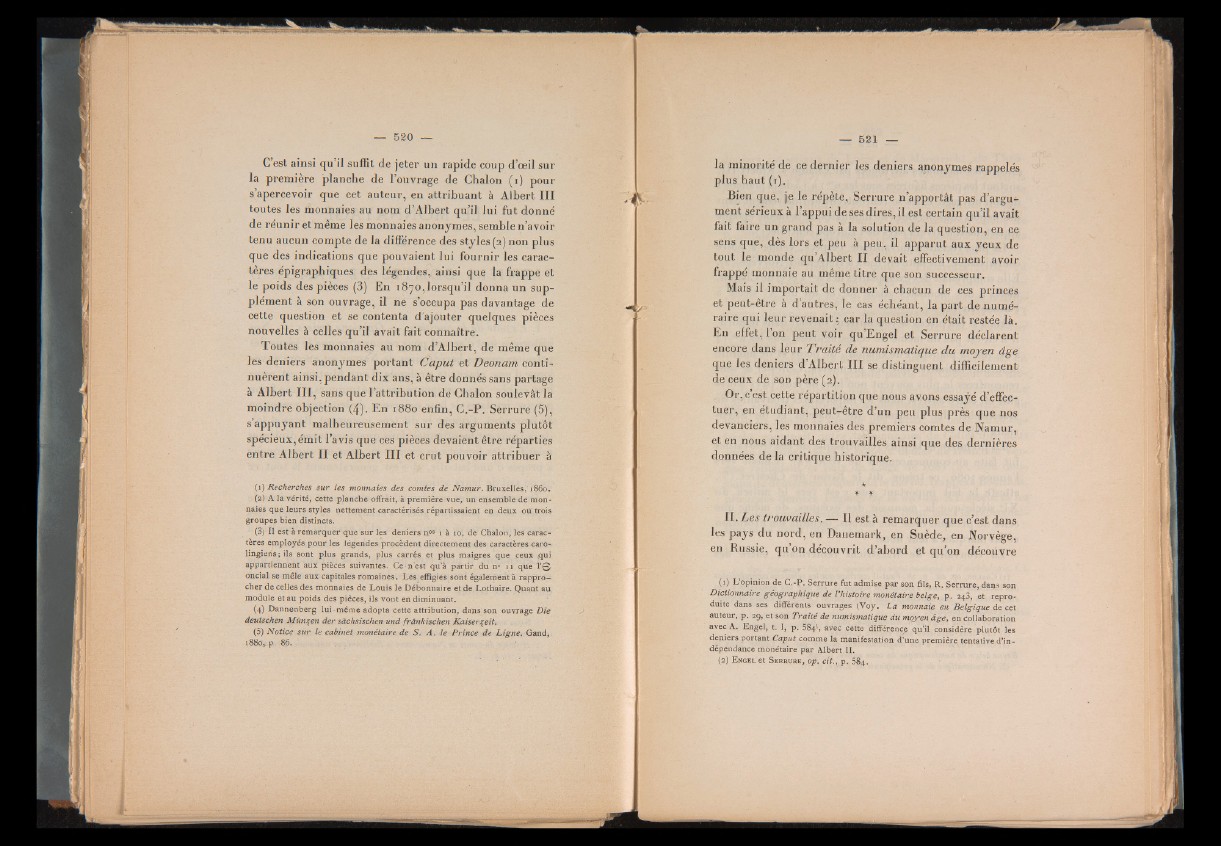
C’est ainsi qu’il suffit de jeter un rapide coup d’oeil sur
la première planche de l’ouvrage de Chalon (i) pour
s’apercevoir que cet auteur, en attribuant à Albert III
toutes les monnaies au nom d ’Albert qu’il lui fut donné
de réunir et même les monnaies anonymes, semble n’avoir
tenu aucun compte de la différence des styles (2) non plus
que des indications que pouvaient lui fournir les caractères
épigraphiques des légendes, ainsi que la frappe et
le poids des pièces (3) En 1870,lorsqu’il donna un supplément
à son ouvrage, il ne s’occupa pas davantage de
cette question et se contenta d’ajouter quelques pièces
nouvelles à celles qu’il avait fait connaître.
Toutes les monnaies au nom d’Albert, de même que
les deniers anonymes portant Caput et Deonam continuèrent
ainsi, pendant dix ans, à être donnés sans partage
à Albert III, sans que l’attribution de Chalon soulevât la
moindre objection (4 ). En 1880 enfin, C.-P. Serrure (5),
s’appuyant malheureusement sur des arguments plutôt
spécieux, émit l’avis que ces pièces devaient être réparties
entre Albert II et Albert III et crut pouvoir attribuer à
(1) Recherches sur les monnaies des comtes de Namur. Bruxelles. 1860,
(2) A la vérité, cette planche offrait, à première vue, un ensemble de m o n naies
que leurs styles nettement caractérisés répartissaient en deux ou trois
groupes bien distincts.
(3; I l est à remarquer que su r les deniers n os 1 à 10, de Chalon, les caractères
employés p our les légendes procèdent directement des caractères caro--
lingiens; ils sont plus grands, plus carrés et plus maigres que ceux ,qui
appartiennent aux pièces suivantes. Ce n ’est qu ’à p a rtir du n° 11 que l ’@
oncial se mêle aux capitales romaines. Les effigies sont également à rap p ro cher
de celles des monnaies de Louis le Débonnaire et de Lothaire. Quqnt au
module et au poids des pièces, ils vont en diminuant.
(4) Dannenberg lui-même adopta cette attribution, dans son ouvrage Die
deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiser ¡{eit.
(5) Notice sut' le cabinet monétaire de S. A. le Prince de Ligne. Gand,
i88ovp. 86.
la minorité de ce dernier les deniers anonymes rappelés
plus haut (1).
Bien que, je le répète, Serrure n ’apportât pas d’argument
sérieux à l’appui de ses dires, il est certain qu’il avait
fait faire un grand pas à la solution de la question, en ce
sens que, dès lors et peu à peu, il apparut aux yeux de
tout le monde qu’Albert II devait effectivement avoir
frappé monnaie au même titre que son successeur.
Mais il importait de donner à chacun de ces princes
et peut-être à d’autres, le cas échéant, la part de numéraire
qui leur revenait : car la question en était restée là.
En effet, 1 on peut voir qu’Engel et Serrure déclarent
encore dans leur Traité de numismatique du moyen âge
que les deniers d ’Albert III se distinguent difficilement
de ceux de son père (2).
Or, c’est cette répartition que nous avons essayé d’effectuer,
en étudiant, peut-être d’un peu plus près que nos
devanciers, les monnaies des premiers comtes de Namur,
et en nous aidant des trouvailles ainsi que des dernières
données de la critique historique.
★
* *
II. Les trouvailles. — Il est à remarquer que c’est dans
les pays du nord, en Danemark, en Suède, en Norvège,
en Russie, qu’on découvrit d ’abord et qu’on découvre
(1) L’opinion de C.-P. Serrure fut admise par son fils, R. Serrure, dans son
Dictionnaire géographique de l’histoire monétaire belge, p. 243, et rep ro duite
dans ses différents ouvrages (Voy. La monnaie en Belgique de cet
auteur, p . 29» et son Traité de numismatique du moyen âge, en collaboration
avec A. Engel, t. I, p. 584', avec cette différence qu ’il considère p lutôt les
deniers portant Caput comme la manifestation d ’une première tentative d’in dépendance
monétaire par Albert II.
(2 ) E n g e l et S e r r u r e , op. cit., p . 6 8 4 .