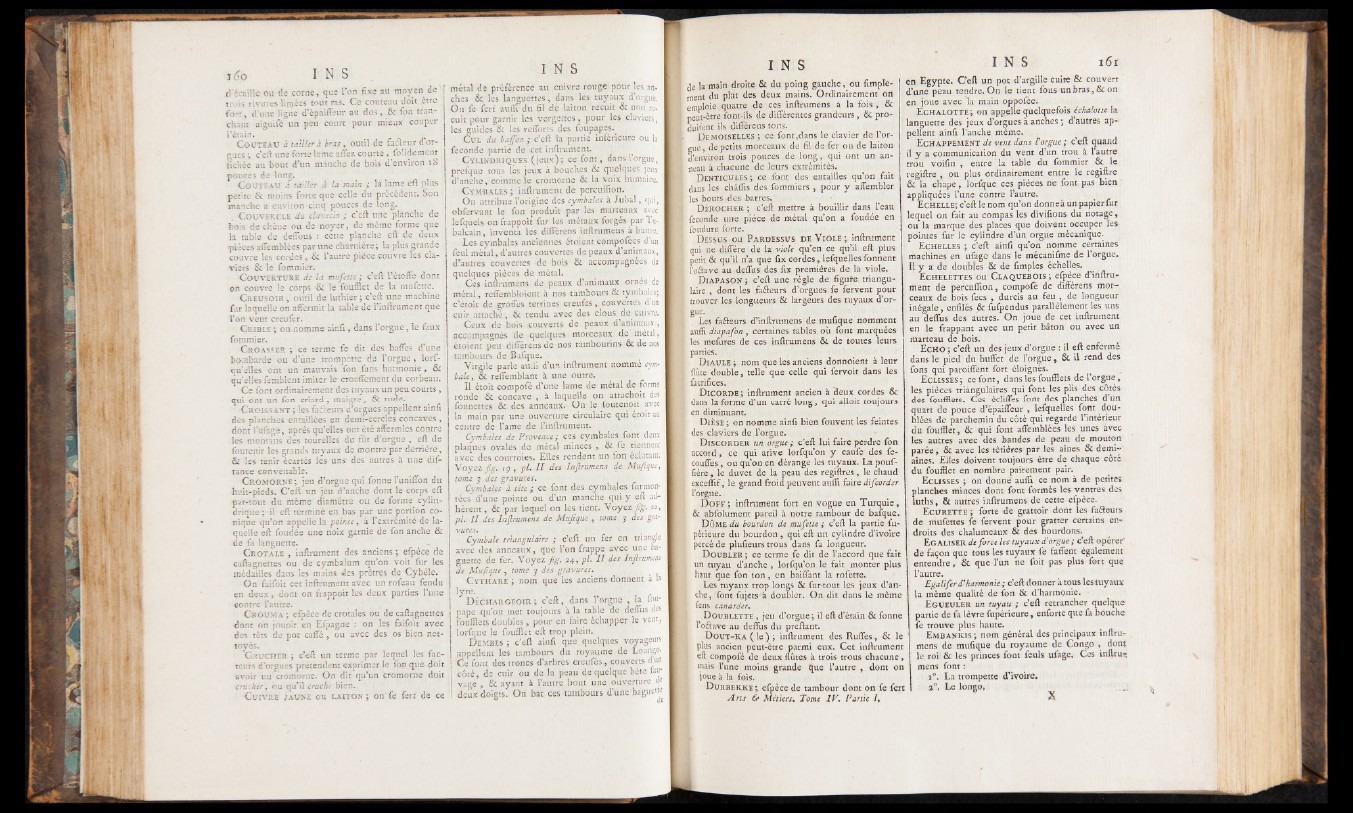
J D O
,cTécaille ou de corne, que l’on fixe aü moyen de
trois rivuves limées tout ras. Ce couteau doit .eu y
fo r t, d'une ligne d’épaifleur au dos fon tranchant
aiguifé un peu court pour mieux couper
l’étain. „
C O U T E A U à taillera bras, outil de fadeur d orgues
; c’eft une forte lame allez courte, foüdenient
fichée au bout d’un manche de bois d’environ 18
pouces de long.
C o u t e a u à tailler à la main ; là lame eft plus
petite & moins forte que celle du précèdent. Son
manche a environ cinq pouces de long.
C o u v e r c l e du clavecin ; c’eft une planche de
Lois de chêne ou de noyer, de même forme que
la table de deffous : cette planche eft de deux
pièces aflemblées par une charnière; la plus grande
couvre les cordes, & l’autre pièce couvre les claviers
& le fommier.
-Couverture de la mufette; c’eft l’étoffe dont
on couvre le corps & le foufflet de la mufette.
C reusoir , outil de luthier ; c’eft une machine
fur laquelle on aftermit la table de l’inftrument que
l’on veut creufer.
C rible ; on .nomme ainfi, dans l’orgue, le faux
fommier.
C roasser. ; ce terme fe dit des baffes d’une
bombarde ou d’une trompette de l’orgue, lorf-
qu’elles ont un mauvais fon fans harmonie, &
qu’elles femblent imiter le croaffement du corbeau.
Ce font ordinairement des tuyaux un peu courts,
qui ont un fon criard, maigre, & rude.
C roissant ; les fadeurs d’orgues appellent ainfi
des planches entaillées en demi-cercles concaves ,
dont i’ufage, après qu’elles ont été affermies contre
les montans des tourelles du fût d’orgue , eft de
foutenir les grands tuyaux de montre par derrière,
& les tenir écartés les uns des autres à une distance
convenable.
C r o m o r n e ; jeu d’orgue qui fonne l’uniffon du
huit-pieds. C ’eft un jeu d’anche dont le corps eft
par-tout du même diamètre ou de forme cylindrique;
il eft terminé en.bas par une portion conique
qu’on appelle la pointe, à l’exîrémite de laquelle
eft foudée une noix garnie de fon anche &
de fa languette.
C r o t a l e , infiniment des anciens ; efpèce de
caftagnettes ou de cymbalum qu’on voit fur les
médailles dans les mains des prêtres de Cybèle.
On faifoit cet infiniment avec un rofeau fendu
en deux, dont on frappoit les deux parties l’une
c-ontre l’autre.
C rouma ; efpèce de crotales ou de cafiagnettes
dont on jouoit en. Efpagne : on les faifoit avec
des têts de pot caffé, ou avec des os bien nettoyés.
Grucher ; c’eft un terme par lequel les facteurs
d’orgues prétendent exprimer le fon que doit
avoir un cromorne. On dit qu’un cromorne doit
crucher, ou qu’il cruche bien.
C u iv r e ja u n e ou l a it o n ; on fe fert de ce
métal de préférence au cuivre rouge pour les anches
& des languettes, dans les tuyaux d’orgue.
Ou fe fert aufii du fil de laiton recuit & non recuit
pour garnir les vergettes , pour les claviers,
les guides & les refforts des foupapes.
C ul du bajfon ; c’eft la partie inférieure ou la
fécondé partie de cet infiniment.
C y l in d r iq u e s ( je u x ) ; ce fo n t, dans l’orgue,
prefque tous les jeux à bouches & quelques jeux
d’a n c h e , com m e le crom orne & la voix humaine.
C y m b a l e s ; in fin im e n t d e pe rçu filon.
On attribue l’origine des cymbales à Jubal, qui,
obfervant le fon produit par les marteaux avec
lefquels on frappoit fur les métaux forges par Tu-
balcain, inventa les différens inftrumens a battre.
Les cymbales antiennes étoient compofées d’un
feul métal, d’autres couvertes de peaux d’animaux,
d’autres couvertes de bois & accompagnées de
quelques piècés de métal.
Ces inftrumens de peaux d’animaux ornés de
métal, reflembloient à nos tambours & tymbales;
c’étoit de groffes terrines creufes, couvertes d’un
cuir attaché, & tendu avec des clous de cuivre.
Ceux de bois couverts de peaux d’animaux,
accompagnés de quelques morceaux de métal,
étoient peu différens de nos tambourins & de nos
tambours de Bafque.
Virgile parle auiii d’un inftrument nommé cymbale,
& reffemblant à une outre.
Il étoit compofé d’une lame de métal de forme
ronde & concave , à laquelle on attachoit des
fonnettes & des anneaux. On le foutenoit avec
la main par une ouverture circulaire qui étoit au
centre de l’ame de l’inftrument.
Cymbales de Provence ; ces cymbales font deux
plaques ovales de métal minces , & fe tiennent
avec des courroies. Elles rendent un fon éclatant.
Voyez fig. ./p , pL I I des Injlrumens de Mujîque,
tome 3 des gravures. •
Cymbales à tête ; ce font des cymbales furmon-
tées d’une pointe ou d’un manche qui y eft adhérent,
& par lequel on les tient. V o y e z 22,
pl. I l des Injlrumens de Mujîque , tome 3 des gravures.
; j L •
Cymbale triangulaire ; c’eft un fer en triangle
avec des anneaux, que l’on frappe avec une baguette
de fer. Voyez fig. 24, pl. U des Injlrumens
de Mujîque, tome 3 des gravures.
C ythare ; nom que les anciens donnent à la
lyre. H 1 1
D é ch arg eoir; c’eft, dans l’orgue , la fou-
pape qu’on met toujours à la table de deflus des
foufflets doubles , pour en faire échapper le vent,
lorfque le foufflet eft trop plein.
D embes ; c’eft ainfi que quelques voyageurs
appellent les tambours du royaume de Loango*
Ce font des troncs d’arbres creufés, couverts dun
côté, de cuir ou de la peau de quelque bête fau-
vage , & ayant à l’autre .bout une ouverture de
I deux doigts. On bat ces tambours d’une baguette
de la main droite & du poing gauche, ou Amplement
du plat des deux mains. Ordinairement on
emploie quatre de ces inftrumens à la fois, &
peut-être font-ils de différentes grandeurs, & produisent
ils différens tons.
D em o ise l l e s ; ce font,dans le clavier jde l’orgue
, de petits morceaux de fil de fer ou de laiton
d'environ trois pouces de long, qui ont un an-
peau à chacune de leurs extrémités.
D e n tic u le s ; ce font des entailles qu’on fait
dans les châfiis des fommiers , pour y affembler
les bouts des barres.
D é r o c h e r ; c’eft m ettre à bouillir dans l’eau
fécondé une pièce de m étal qu’on a foudée en
[ foudure forte.
D essus o u P a r d e s su s d e V io l e ; inftrutnent
qui ne diffère de la viole qu’en ce qu’il eft plus
petit & qu’il n’a que fix c o rd e s, lefquelles fonnent
l’o&ave au deffus des fix prem ières de là viole.
D ia p a s o n ; c’eft u n e règle de figufe, triangulaire
, dont les fadeurs d ’orgues fe fervent p o ur
! trouver les longueurs & largeurs des tuyaux d ’orgue.
• . .
Les fadeurs d’inftrum ens de m ufique nom m ent
aufii diapafon, certaines tables où font m arquées
[ les mefures de ces inftrum ens & de toutes leurs
: parties.
D ia u l e ; nom que les anciens d o nnoient à leur
[ flûte d o u b le, telle que celle qui fervoit dans les
facrifices.
D ic o r d e ; inftrum ent ancien à deux cordes &
I dans la form e d’un carré lo n g , q ui alloit toujours
en dim inuant.
D ièse ; on nomme ainfi bien fouvent les feintes
des claviers de l’orgue.
D is c o r d e r un orgue ; c’eft lui faire perdre fon
accord, ce qui arive lorfqu’on y caufe des fe-
couffes, ou qu’on en dérange les tuyaux. La pouf-
fière, le duvet de la peau des regiftres, le chaud
î exceflif, le grand froid peuvent aufii faire difcorder
[ l’orgue.
D o f f ; inftrument fort en vogue en Turquie,
I & abfolument pareil à notre tambour de bafque.
DÔME du bourdon de mufette ; c’eft la partie fu-
pêrieure du bourdon , qui eft un cylindre d’ivoire
percé de plufieurs trous dans fa longueur.
D o u b l e r ; ce terme fe dit de l’accord que fait
| un tuyau d’anche, lorfqu’on le fait monter plus
[ haut que fon ton, en baiflfant la rofette.
Les tuyaux trop longs & fur-tout les jeux d’an-
I che, font fujets'à doubler. On dit dans le même
I fens canarder.
D o u b l e t t e , jeu d’orgue ; il eft d’étain & fonne
I l’odave au deflus du preftant.
D o u t - k a ( le ) ; inftrum ent des R uffes, & le
I plus ancien peut-être parm i eux. C e t inftrum ent
I eft compofé de deux flûtes à trois trous ch acu n e,
I mais l’une moins grande que l’autre , d o nt on
I joue à la fois.
D u r b e k k e ; efpèce de tam bour d o nt o n fe fert
Arts 6» Métiers. Tome IV. Partie A.
en Egypte. C’eft un pot d’argille cuite & couvert
d’une peau tendre. On le tient fous un bras, & on
en joue avec la main oppofée.
E c h a l o t t e ; on appelle quelquefois échalotte la
languette des jeux d’orgues à anches ; d’autres appellent
ainfi l’anche même.
E c h a p p e m e n t de vent dans l'orgue ; c’eft quand
il y a communication du vent d’un trou à l’autre
trou voifin , entre la table du fommier & le
regiftre , ou plus ordinairement entre le regiftre
& la chape, lorfque ces pièces ne font pas bien
appliquées l’une contre l’autre.
E c h e l l e ; c’eft le nom qu’on donne à ün papier fur
lequel on fait au com pas les divifions du n o ta g e ,
o u la m arque des places que do iv ent occuper les
pointes fur le cylindre d ’un orgue mécanique.
E c h e l l e s ; c’eft ainfi qu’on nomme certaines
machines en ufage dans le mécanifme de l’orgue.
Il y a de doubles & de fimples échelles.
E c h e l e t t e s ou C l a q u e b o is ; efpèce d’inftru-
ment de pereuflion, compofé de différens morceaux
de bois, fecs , durcis au feu , de longueur
inégale, enfilés & fufpendus parallèlement les uns
au deflus des autres. On joue de cet inftrument
en le frappant avec un petit bâton ou avec un
marteau de bois. .
E c h o ; c’eft un des jeux d’orgue : il eft enferme
dans le pied du buffet de l’orgue, & il rend des
fons qui paroiffent fort éloignés.
E c l is s e s ; ce font, dans les foufflets de l’orgue,
les pièces triangulaires qui font les plis des cotes
des foufflets. Ces édifies font des planches d un
quart de pouce d’épaifleur , lefquelles font doublées
de parchemin du côté qui regarde l’interieur
du foufflet, & qui font aflemblées les unes avec
les autres avec des bandes de peau de mouton
parée, & avec les têtières par les aines & demi-
1 aînés. Elles doivent toujours être de chaque côté
du foufflet en nombre pairement pair.
Ec l isse s ; o n d o nn é aufii ce nom à de petites
planches m inces d o n t fo n t form és les v en tres des
lu th s , & autres inftrum ens de cette efpèce.
E c u r e t t e ; forte de grattoir d o nt les fadeurs
d e m ufettes fe fervent p o ur g ratter certains en*»
droits des chalum eàux & des bourdons.
EGALISER de force les tuyaux d’orgue ; c’eft opérer'
de façon que tous les tuyaux fe faffent également
entendre, & que l’un ne foit pas plus fort que
l’autre.
Egaliferdharmonie; c’eft donner à tous les tuyaux
la même qualité de fon & d’harmonie.
E g u e u l e r un tuyau ; c’eft retrancher quelque
partie de fa lèvre fupérieure, enforte que fa bouche
fe trouve plus haute.
E m b a n k is ; nom général des principaux inftrumens
de mufique du royaume de Congo , dont
le roi & les princes font feuls ufage. Ces inftru?,
mens font :
i°. La trompette d’ivoire.
a°. Le longo,