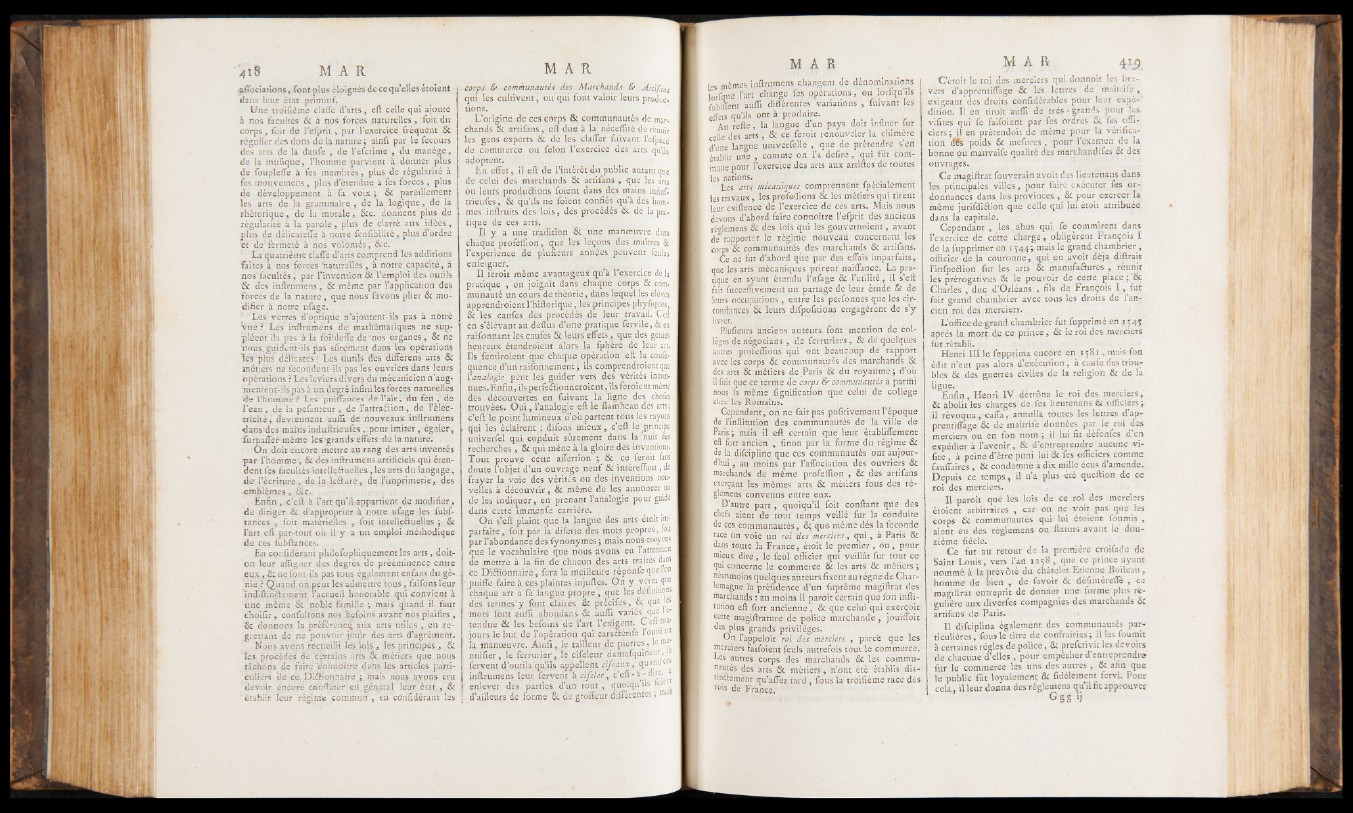
affociarions, font plus éloignés de ce qu’elles étoient
dans leur état primitif.
Une troifième claffe d’a r t s , eft celle qui ajoute
à nos facultés & à nos forces naturelles, foit du
co rp s , foit de l’e fp r it , par l’exercice fréquent &
régulier des dons de la nature ; ainft par le fecours
des arts de la danfe , de l’efcrime , du man ège,
de la mufique,' l’homme parvient à donner plus
de foupleffe à fes membres, plus de régularité à
fes mouvemens, plus d’étendue à fes forces , plus
de développement à fa vo ix ; & pareillement
les arts de la grammaire , de la lo g iq u e , de la
rhé toriqu e, de la morale, & c . donnent plus de
régularité à la p a ro le , plus de clarté aux idées ,
plus de délicatefle à notre fenfibiiité, plus d’ordre
et de fermeté à nos volon tés, & c .
La quatrième claife d’arts comprend les additions
faites à nos forces 'naturelles, à notre capacité, à
nos facultés , par l’invention & l’emploi des outils
& des inftrumens, & même par l’application des
forces de la natu re, que nous favons plier & modifier
à notre ufagè.
Les verres d’optique n’ajoutent-ils pas à notré
v u e ? Les inftrumens de mathématiques ne suppléent
iis pas à la foiblefle de~nos organes, & rie
nous; guident-ils pas sûrement dans les opérations
les plus délicates Les outils des différens arts &
métiers ne fécondent-ils pas les ouvriers dans leurs
opérations ? Les leviers d ivers du mécanicien n’aug-
mentént-ilspas à un degré infini les forces naturelles
de l’homme ? Les pùifiances de l’a i r , du feu , de
l ’eau , de la pefanteur , de l’a ttra d ion , de l’ électricité
j deviennent aufli de nouveaux inftrumens
■ dans des mains induftriéufes, pour imite r, égaler ,
furpaffef même les:’grands effets de la nature.
O n doit encore mettre au rang des arts inventés
•par l’homme, & des inftrumens artificiels qui étendent
fes facultés intelle&uelles, les ans du lan g ag e,
d e l’é c riture, de là .le é lu rê , de; Fimprimerie, des
-em b lèm e s .& c .
Ë n fin , c’e f t à l’art qu’ il appartient de modifier,
de diriger & d’approprier à notre ufage les fubf-
tances , foit matérielles , foit intelleduelles ; &
l ’art eft par-tout où il y a un emploi méthodique
d e ces fubftances.
En confidérant philofophiquement les arts , doit-
on leur affigner des degrés de prééminence entre
eux ne font-ils pas tous également enfans du gén
ie ? Qu and on peut les admettre to u s , faifonsleur
indiftiriftèmerit l’accueil honorable qui convient à
une même & noble famille ; mais quand il faut
ch o ifir , confultons nos befoins avant nos plaifirs ,
& donnons la préférence, aux arts utiles , en regrettant
de ne pouvoir jouir des arts d’agrément.
Nous avons recueilli les lois , les principes , &
les procédés' dé certains arts & 'métiers que nous
tâchons de faire 'conrioître dans les articles particuliers'
de ce Di&on n a ire ;.mais nous ayons cru
devoir encore conftàter en. général léur état , &
établir leur régime commun , en confidérant les
corps & communautés des Marchands & Antifans
qui les cu ltiven t, ou qui font valoir leurs produc.
tions.
L ’origine de ces corps & communautés de marchands
& artifans, eft due à la néceflitè de réunir
les gens experts- & de les claffer fuivant l’efpèce
de commerce ou félon l’exercice des arts qu’ils
adoptent.
En e f fe t , il eft de l’intérêt du public autant que
de celui des marchands & artifans , que les arts
ou leurs produirions foient dans des mains induf-
trieufes, & qu’ils ne foient confiés qu’à des hommes
inftruits des lo is , des procédés de la pratique
de ces arts.
Il y a une tradition & une manoeuvre dans
chaque profêftion, que les leçons des maîtres &
| l’expérience de plufietirs années peuvent feules
enfeigner.’
Il feroit même avantageux qu’à l’exercice de la
pratique , on joignît dans chaque corps & communauté
un cours de théorie, dans lequel les élèves
apprendroientl’hiftorique, les principes phyfiques,
& les caufes des procédés de leur travail. Ceft
én s’élevant au defîus d’une pratique fervile, &en
raifonnant les caufes & leurs effe ts, que des génies
heureux ètendroient alors la fphère de leur art.
Ils fentiroient que chaque opération eft la confé-
quence d’un raisonnement ; ils comprendroient que
Yanalogie peut les guider vers des vérités inconnues.
Enfin, ils perfeéfionneroient, ils fèroient même
dès découvertes en fuivant la ligne des chofes
trouvées. O u i , l’analogie eft le flambeau des arts;
c’eft le point lumineux d’où partent tous les rayons
qui les éclairent : difons m ieu x , c’eft le principe
univerfel qui conduit sûrement dans la nuit des
recherches , & qui mène à la gloire des inventions.
T o u t prouve cette affertion ; & ce feroit fans
doute l’objet d’un ouvrage neu f & intéreffant, de
frayer la vo ie des vérités ou des inventions nouvelles
à d é co u vr ir , & même de les annoncer ou
de les ind iqu er, en prenant l’analogie pour guide
dans cette, Immenfe carrière.
O n s’eft plaint que la langue des arts étoit imparfaite
, foit par la difette des mots propres, foit
par l’abondance des fynonymes ; mais nous croyons
que le vocabulaire que nous avons eu l’attention
de mettre à la fin de chacun-des arts traités dans
ce Diâ ionnairé , fera la meilleure réponfequelon
’ puiffe faire à ces plaintes injuftes. On y verra que
chaque art a fa langue propre, que les définitions
des termes 'y font claires & précifes, & que j f
mots font aufli abondans & aufli variés que Ie"
tendue & les befoins de l’art l’exigent. Ceft toujours
le but de l’opération qui cara&érife l’outil on
la manoeuvre. À in f i, le tailleur de pierres, le
nu ifier, le ferrurîer, le çifeleur damafquineur, e
fervent d’outils ■ qu’ils appellent cifeaux, quand ce*
inftrumens leur fervent à cifeler r è’eft - à ' dùe’ *
enlever des. parties d’un tout , quoiqu’ils *oie
d’ailleurs de forme & de groffeur différentes, ni,a
les mêmes inftrumens changent de dénominations
lorfque l’art change fes opérations, ou lorfqu’ils
fubiffent aufli différentes variations , fuivant les
effets qu’ils ont à produire. .
Au refte , la langue d u n pays doit influer lur
celle des arts , & ce feroit renouveler la chimère
d’une langue univerfelle , que de prétendre s’en
établir une , comme on l’a d e firé, qui fût commune
pour l’exercice des arts aux artiftes de toutes
les nations. , . ,
Les 'arts mécaniques comprennent lpecialement
les travaux, les profeflions & les métiers qui tirent
leur exiftence de l’exercice de ces arts. Mais nous
devons d’abord faire connoître l’efprit des anciens
réglemens & des lois qui les gouvernoient, avant
de rapporter le régime nouveau concernant les
corps & communautés des marchands & artifans.
Ce ne fut d’abord que par des effais imparfaits,
que les arts mécaniques prirent naiffance. La pratique
en ayant étendu l’ufage & l’u tilité, il s’eft
fait fucceflivement un partage de leur étude & de
leurs occupations , entre les perfonnes que les cir-
conftances & leurs difpofitiofls engagèrent de s’y
livrer.
Plufieurs anciens auteurs font mention de collèges
de négocians , de ferruriers, & dé quelques
autres profeflions qui ont beaucoup de rapport
avec les corps & communautés des marchands &
des arts & métiers de Paris & du royaume ; d’où
il fuit que ce terme de corps & communautés a parmi
nous la même fignification que ce lu i.d e collège
chez lès Romains.
Cependant, on ne fait pas pofitivement l’époque
de rinftitution des communautés de la ville de
Paris ; mais il eft certain que leur établiflement
eft fort ancien , finon par la forme du régime &
de la difcipline que ces communautés ont aujourd’hui
, au moins par l’affociation des ouvriers &
marchands de même profêftion , & des artifans
exerçant les mêmes arts & métiers fous des réglemens
convenus entre eux.
D’autre p a r t , quoiqu’ il, foit confiant que des
chefs aient de tout temps veillé fur la conduite
de ces communautés, que- même dès la fécondé
race on voie un roi des merciers, q u i , à Paris &
dans toute la F ran c e, étoit le premier , o u , pour
mieux dire, le feul officiel qui veillât fur tout ce
qui concerne le commerce & les arts & métiers ;
néanmoins quelques auteurs fixent au règne de Charlemagne
la préfidence d’un fuprême magiftrat des
marchands : au moins il paroît certain que fon infti-
tution eft fort ancienne , & que celui qui exerçoit
cette magiftrature de police marchande , jouifloit
des plus grands privilèges.
On l’àppeloit roi des merciers , parce que les
merciers faifoient feul s. autrefois tout le commerce.
Les autres corps dès marchands & les communautés
des arts & métiers, n’ont été établis distinctement
qu’affez ta rd , fous la troifième race des.
rois de France.
C ’étoit le roi des merciers qui donnoit les brevets
d’apprentiflage & les lettres de maitrife ,
exigeant des droits confidérables pour leur expédition.
Il en tiroit aufli de très - grands pour les-
vifites qui fe faifoient par fes ordres & fes officiers
; il en prétendoit de même pour la vérification
d£s poids & mefures, pour l’examen de la
bonne pu mauvaife qualité des mafchandifes & des
ouvrages. .
C e magiftrat fouverain avoit des lieutenans dans,
les principales v ille s , pour faire exécuter fes ordonnances
dans les provinces., & pour exercer la
même jurifdiâion que celle qui lui étoit attribuée
dans la capitale.
Cependant , les abus qui fe commirent dans
l’exercice de cette ch arg e , obligèrent François I
de la fupprimer en 1544? mais grand chambrier,
officier de la couronne, qui en avoit déjà diftrait
l’infpeâion fur les arts & manufactures , réunit
les prérogatives & le pouvoir de cette place ; &
Charles , duc d’Orléans , fils de, François I , fut
fait grand chambrier avec tous les droits de 1 ancien
roi des merciers.
L ’office de grand chambrier fut fupprimé en 1545
après la mort de, c e p r in c e, & le roi des merciers
fut.rétabli. .j.\ t ; '.v-> ■ _
Henri III le fupprima encore en 1 5 8 1 , mais fon
édit n’eut pas alors d’ exécution, à caufe des troubles
& dés guerres civiles de la religion & de la
ligue.
E n fin , Henri IV détrôna le roi des merciers,
& abolit les charges de.fes lieutenans & officiers;
il révoqua ,~caffa, annulla toutes les lettres d’âp-
prentiffage & de maîtrife données par le roi des
merciers ou en fon nom ; il lui fit defenfes d en
expédier à l’a v en ir , & d’entreprendre aucune vi-
f i t e , à peine d’être puni lui & fes officiers comme
fauflaires , & condamné à d ix mille écus d’amende.
Depuis ce temps, il n’a plus été queftion de ce
roi des merciers.
I l paroît que les lois de ce roi des merciers
étoient arbitraires , car on n e -vo it pas que les
corps & communautés qui lui étoient fournis ,
aient eu des réglemens ou liatuts avant le dou-
, zième fiècle.
C e fut au retour de la première croifade de
Saint L ou is, vers l’an 12.58 , que ce prince ayant
nommé à la prévôté du châtelet Etienne B o ile au ,
homme de bien , de favoir & défmtéreffé , ce
magiftrat entreprit de donner une forme plus régulière
aux diverfes compagnies des marchands &
artifans d e Paris.
I l difciplina également des communautés particulières
, fous le titre de cohfrairies ; il les fournit
à certaines règles de p o lic e , & prefcrivit les devoirs
de chacune d’elles , pour empêcher d’ entreprendre
fur le commerce les uns des autres , & afin que
le public fût loyalement & fidèlement fervi. Pour
ce la , il leur donna des réglemens qu’il fit approuver
G g g ij