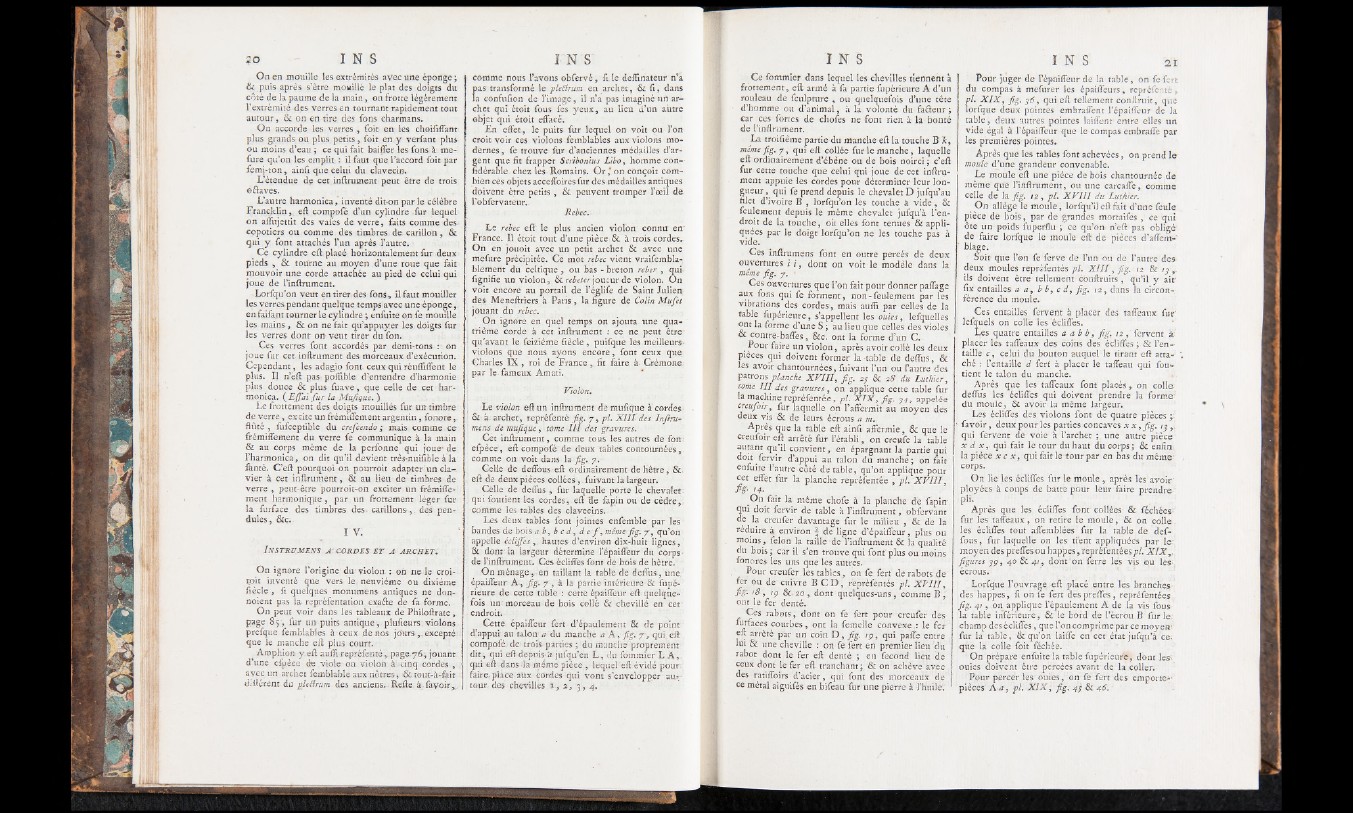
On en mouille les extrémités avec une éponge ;
& puis après s’être mouillé le plat des doigts du
côté de la paume de la main, on frotte légèrement
l’extrémité des verres en tournant rapidement tout
autour, & on en tire des fons charmans.
On accorde les verres , foit en les choififfant
plus grands ou plus petits, foit en y verfant plus
ou moins d’eau ; ce qui fait baiffer les fons à mesure
qu’on les emplit : il faut que l’accord foit par
femi-ton, ainfi que celui du clavecin.
L’étendue de cet inftrument peut être de trois
©ftaves.
L’autre harmonica, inventé dit-on par le célèbre
F ran c jd in e ft compofé d’un cylindre fur lequel
on affujettit des vafes de verre, faits comme descopotiers
ou comme des timbres, de carillon, &
qui y font attachés l’un après l’autre.
Ce cylindre eft. placé horizontalement fur deux
pieds , & tourne au moyen d’une roue que fait
mouvoir une corde attachée au pied de celui qui
joue de l’inftrument.
Lorfqu’on veut en tirer, des fons, il faut mouiller
les verres pendant quelque temps avec une éponge,
en faifant tourner le cylindre ; enfuite on fe mouille
les mains , & on ne fait qu’appuyer les doigts fur
les verres dont- on veut tirer dufon.
Ces verres font accordés par demi-tons :: on
joue fur cet inftrument des morceaux d’exécution.
Cependant, les adagio font, ceux qui réufliffent le
plus. Il n’èft pas- poftible. d’entendre d’harmonie
plus douce & plus fuave, que celle de .cet harmonica.
( EJfai fur la Mufique. )
Le frottement des doigts mouillés fur un timbre
de verre, excite un frémiffement argentin, fonore,
flûte , fufceptible du crefcendo ; mais comme ce
frémiflement du verre fe communique à la main
& au corps même de la perfonne qui joue* de
l’harmonica, on dit qu’il devient très-nuifible a la
ftinté. C ’eft pourquoi on pourroit adapter un cia-,
vier à cet inftrument, & au lieu de timbres de
verre , peut-être pourroit-on exciter un frémiffe-
ment harmonique, par un frottement léger fur
la furface des timbres des carillons-, . des pendules
, &ç.
I V.
I n S TR UM EW S A". C O R D E S E T A A R C H E T i
On ignore l’origine1 du violon : ofi ne le croisait
inventé que vers le; neuvième ou dixième
fiècle , fi quelques monumens' antiques ne don-
noient pas la repréfentation exa&e de fà- forme.
On peut voir dans les tableaux de Philoftrate,
page 85, fur un puits antique-,-plufieurs. violons
prefque femblables à ceux de nos jours ,~excepté
que le manche eft plus court.
Amphion y.eft aufli repréfenté^. page-76-, jouant
d’une efpèee de viole ou violon ; à -cinq cordes ,
avec un archet feinblable aux nôtres i, & tout-à-fait
diftérent- du ple&rum des anciens. Refte. àfavoir*.
comme nous l’avons obfervé, ( lie deffinateur n’à
pas transformé le pleêlrum en archet, & fi, dans
la confufion de l’image, il n’a pas imaginé ub archet
qui étoit fous fes yeux, au lieu d’un autre
objet qui étoit effacé.
En effet, le puits fur lequel on voit ou l’on
croit voir ces violons femblables aux violons modernes
, fe trouve fur d’anciennes médailles d’argent
que fit frapper Scribonius Libo, homme con--
fidérable chez les Romains. Or ,* on conçoit combien
ces objets acceffoires fur des médailles antiques
doivent être petits, &. peuvent tromper l’oeil de
l’obfervatetir..
Rebec.
Le rebec eft' le plus ancien violon connu en'
France. Il étoit tout d’une pièce & à trois cordes.-
On en jouoit avec un petit archet & avec une
mefure précipitée. Ce mot rebec vient vraifembla-
blement du celtique , ou bas - breton reber , qui-
fignifie un violon, ècrebeter joueur de violon. Ôn
voit, encore au portail de l’é.glife de Saint Julien
des Meneftrrers à Paris, la figure de Colin Mufet
jouant du rebec.
On ignore en quel temps on ajouta une quatrième
corde: à cet inftrument : ce ne peut être
qu’avant le. feizième fiècle , puifque les meilleurs'
violons que nous ayons encore, font ceux que
Charles IX , roi de France fit faire, Crémone
par le fameux Amati.
Violon.
Le violon eft un inftrument de mufique à cordes
& à- archet, r-epr.éfenté fig. 7 , pl. XIlEdes Infini-
mens de mufique, tome III des gravures.
Cet inftrument, comme tous les autres de fon:
efpèee, eft compofé de deux tables contournées,,
comme on voit dans la fig. 7.
Celle de deffous eft ordinairement de hêtre, &-
eft de deux pièces collées,. fuivant la largeur.
Celle de deffus , fur laquelle porte le chevalet,
qui foutienc les cordés, eft de fapin ou de cèdre,,
comme les tablés des clavecins.
Les deux tablés font jointes enfemble par les
bandes de bois a b, b c d-, d e f , même fig. 7 , qu’on
appelle éd ifie s , hautes d’environ dix-huit lignes,
& dont la largeur détermine l’épaiffeur du corps
de l’irtftrumpnt. Ces écliffes font de bois de hêtre.
On ménage , : en taillant la table de deffus , une,
épaiffeur A , fig . 7-, à là partie intérieure-& fupé-
rieure de cette table : cette épaiffeur eft quelquefois
un morceau de bois collé & chevillé en cet'
endroitv
Cette épaiffeur fert d’épaulejnent & de point
d’appui au talon- a du manche a A -, fig. 7-, qui eft
compofé. de trois parties ; du manche proprement'
dit, qui eft depuis-a jufqu’en L , du fommier L À , ,
qui eft-dans-la même pièce , lequel eft évidé pour
faire, place aüx cordes qui vont s’envelopper au?
tour, des chevilles 1 , 2, 3 ,4 .
Ce fommier dans lequel les chevilles tiennent à
frottement, eft armé à fa partie fupérieure A d’un
rouleau de fculpture , ou quelquefois d’une tête
d’homme ou d’animal, à la volonté du faâeur ;
car ces fortes de chofes ne font rien à la bonté
de l’inftrument.
La troifième partie du manche eft la touche B 7c,
même fig. y , qui eft collée fur le manche, laquelle
eft ordinairement d’ébène ou de bois noirci ; c’eft
fur cette touche que celui qui joue de cet inftrument
appuie les cordes pour déterminer leur longueur
, qui fe prend depuis le chevalet D jufqu’au
filet d’ivoire B , lorfqu’on les touche à v id e , &
feulement depuis le même chevalet jufqu’à l’endroit
de la touche, où elles font tenues & appliquées
par le doigt lorfqu’on ne les touche pas à
vide.
Ces inftrumens font en outre percés de deux
ouvertures i i , dont on voit le modèle dans la
même fig. 7. 4
Ces ouvertures que l’on fait pour donner paffage
aux fons qui fe forment , non - feulement par les
vibrations des cordes, mais aufli par celles de la
table fupérieure , s’appellent les ouies, lefquelles
ont la forme d’une S ; au lieu que celles dès violes
& contre-baffes, &c. ont la forme d’un C.
Pour faire un violon, après avoir collé les deux
pièces qui doivent former la -table de deffus, &
les avoir chantournées, fuivant l’un ou l’autre des
patrons planche X V I I I , fig. 25 & 28 du Luthier,
tome III des gravures, on applique cette table fur
la machine repréfentée, pl. X IX , fig. 34, appelée
creufioir, fur laquelle on l’affermit au moyen des
deux vis & de leurs écrous a m.-
Après que la table eft ainfi affermie, & que le
creufoir eft arrêté fur l’établi, on creufe la table
autant qu il convient, en épargnant la partie qui
doit fervir d’appui au talon du manche; on fait
enfuite l’autrexôté de table, qu’on applique pour
cet effet fur la planche repréfentée , pl. X V I I I ,
H W.
On fait la même chofe à la planche de fapin*
qui doit fervir de table à l’inftrument, obfervant
de la creufer davantage fur le milieu , & de la
réduire, à environ \ de ligne d’épaiffeur, plus ou
moins, félon la taille de l’inftrument & la qualité
du bois ; car il s’en trouve qui font plus ou moins
fonores-les uns que les autres.
Pour creufer.les tables, on fe fert de rabots de
fer qu de cuivre B C D , repréfentés pl. XVIII
M ' S , ip &. 20 , dont quelques-uns, comme B ,'
ont le fer denté.
Ces rabots, dont on fe fert pour creufer des
furfaces courbes, ont la femelle c o n v e x e le fer 1
eft arrêté par un coin D , fig. ip , qui paffe entre
lui & une cheville : on fe fert en premier lieu du
rabot dont le fer eft denté ; en fécond lieu de
ceux dont le fer eft tranchant ; & on achève avec
des ratiflbirs d’acier, qui font des morceaux de
ce métal aiguifés en bifeau fur une pierre à l’huile'.
Pour juger de l’épaiffeur de la table, on fe fert
du compas à mefurer les épaiffeurs, repréfenté,
pl. X IX , fig. 36, qui eft tellement conftruit, que
lorfque deux pointes embraffent l’épaiffeur de la
table, deux autres pointes laiffent entre elles un
vide égal à l’épaiffeur que le compas embraffe par
les premières pointes.
Après que les tables font achevées, on prend le
moule d’une grandeur convenable.
Le moule eft une pièce de bois chantournée de
même que l’inftrument, ou une carcaffe, comme
celle de la fig. 12, pl. X V I I 1 du Luthier.
On allège le moule, lorfqu’il eft fait d’une feule
pièce de bois, par de grandes mortaifes , ce qui
ôte un poids fuperflu ; ce qifon- n’eft pas obligé
de faire lorfque le moule eft de pièces d’affem-
blage.
Soit que l’on fe ferve de l’un ou de. l’autre des
deux moules repréfentés/?/. X I I I , fig. 12 & ip y
ils doivent être tellement conftruits , qu’il y air
fix entailles a a ,,b b, c d, fig. 12, dans la circon--
fèrénçe du moule.
Ces entailles fervent à placer des taffeaux- fur
: lefquels on colle les écliffes.
Les quatre entailles a a b b , fig. 12 , fervent àf
placer les taffeaux des coins des écliffes ; & l’entaille
c , celui du bouton auquel le tirant eft attaché
: l’entaille d ferf à placer le taffeau qui fon»
tient le talon du planche.
Après que les taffeaux font placés, on coll^
deffus les écliffes qui doivent prendre la forme"
du moule, & avoir la même largeur.
Les écliffes des violons font de quatre pièces ;*.
v favoir, deux pour les parties concaves x x , fig. 9,
qui fervent de voie à l’archet ; une autre pièce-
x d x ,- qui fait le tour du haut du corps ; & enfin,
la pièce x c x , qui fait le tour par en bas du même;
corps.
On lie les écliffes fur le moule, après les avoir
ployées à coups de batte pour leur faire prendre-
pli.A
près que. les écliffes font collées & féchées;
fur les taffeaux, on retire le moule, & on colle
les écliffes tout affemblées fur la table de def-
fous, fur laquelle on les tient appliquées par le'
moyen des preffes ou happes, repréfentéespl. X IX r
figures pp, 40 &C 41, dont' on ferre lés vis ©u les-,
écrous.
Lorfque l’ouvrage^eft placé entre, les branches'
des happes, fi on fe fert des preffes, repréfentées
fig. 41 , .on applique l’épauleinent A de la vis fous-
la table inférieure, & le bord de l’écrou B fur le:
champ des écliffes, que l’on comprime par ce moyen’
fur la table, & qu’on laiffe en cet état jufqu’à ce-
que la colle foit féchée. .
On prépare enfuite la table fupérieure, dont les»
ouies doivent être percées avant de la coller.
Pour percer les" dures, on fe fert des emporte»-
pièces A-a , pl. X IX , fig. 4j & 46.