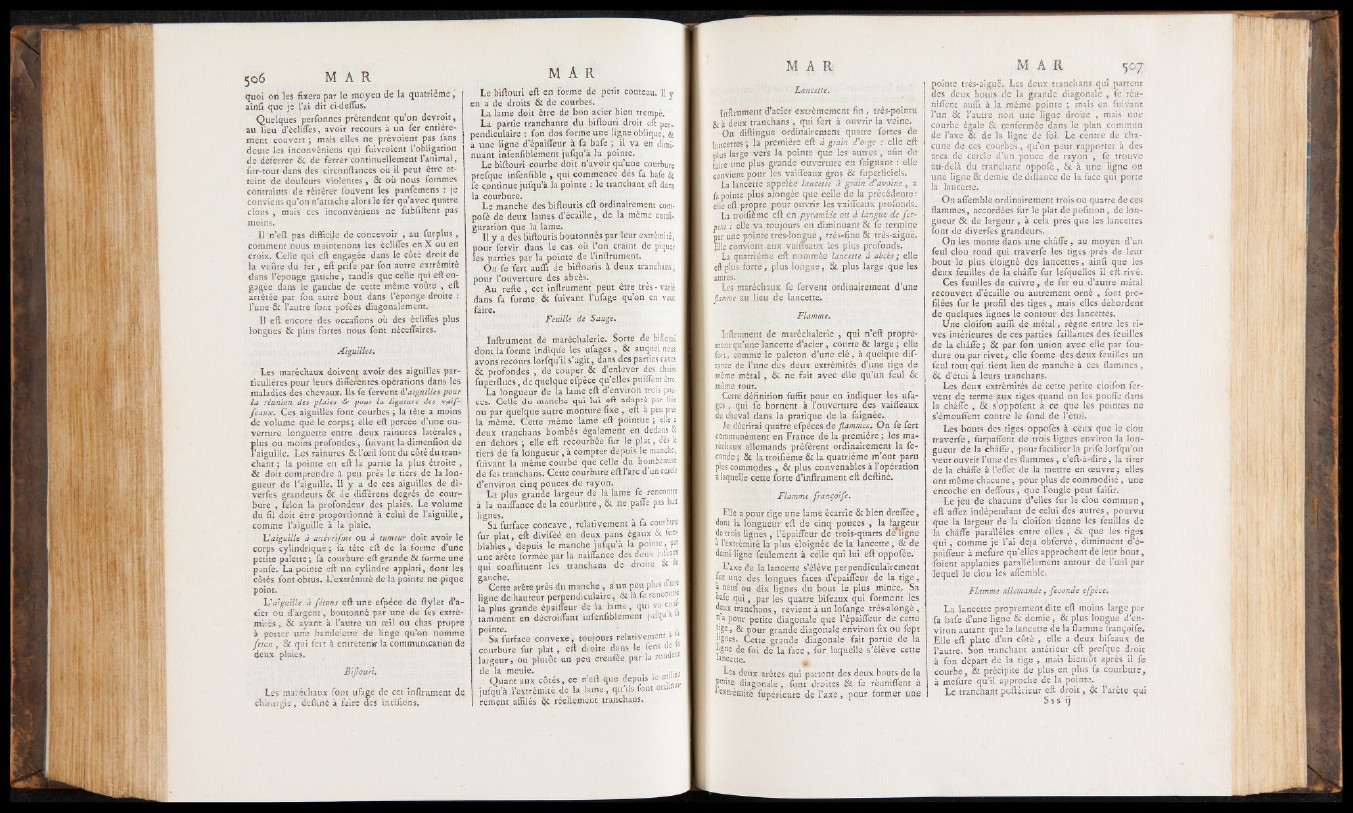
Quoi on les fixera par le moyen de la quatrième,
ainfi que jè l’ai dit ci-deffus.
Quelques perfonnes prétendent qu’on de vro it,
au lieu d’écliffes, avoir recours à un fer entièrement
couvert ; mais' elles ne prévoient pas fans
doute les inconvéniens qui fuivroient l’obligation
de déferrer & de ferrer continuellement l’animal,
fur-tout dans des circonftances où il peut être atteint
de douleurs v io len te s, & où nous fournies
contraints de réitérer fouVent les panfemens : je
conviens qu’on n’attache alors le fer qu’avec quatre
clous , mais ces inconvéniens ne fubfiftent pas
moins.
11 n’eft pas difficile de concevoir , au furplus ,
comment nous maintenons les écliffes en X ou en
croix. Celle qui eft engagée dans le côté droit de
la voûte du f e r , eft prife par fon autre extrémité
dans l’éponge g au ch e , tandis que celle qui eft engagée
dans le gauche de cette même voûte , eft
arrêtée par fon, autre bout dans l’éponge droite :
l’une & l’autre font pofées diagonalement.
11 eft encore des occafions où des écliffes plus
longues & plus- fortes nous font néceffaires.
Aiguilles.
Les maréchaux doivent avoir des aiguilles particulières
pour leurs différentes opérations dans les
maladies des chevaux. Ils fe fervent à?aiguilles pour
la réunion des plaies & pour la ligature des vaif-
feaux. Ces aiguilles font courbes ; la tête a moins
de volume que le corps; elle eft percée d’une ouverture
longuette entre deux rainures latérales,
plus ou moins profondes , fuivant la dimenfion de
l ’aiguille. Les rainures & l’oeil font du côté du tranchant
; la pointe en eft la partie la plus étroite ,
& doit comprendre à peu près le tiers de la longueur
de l’aiguille. Il y a de ces aiguilles de di-
verfes grandeurs & de différens degrés de courbure
, félon la profondeur des plaies. L e volume
du fil doit être proportionné à celui de l’aiguille,
comme l’aiguille à la plaie.
L 'aiguille à anévrifme ou à tumeur doit avoir le
corps cylindrique ; fa tête eft de la forme d’une
petite palette ; là courbure eft grande & forme une
panfe. La pointe eft un cylindre applati, dont les
côtés font obtus. L’extrémité de la pointe ne pique
point.
L 'aiguille à fêtons eft une efpèce de fty le t d’acier
ou d’argent, boutonné par une de fes extrémités
, & ayant à l’autre un oeil ou chas propre
à porter une bandelette de linge qu’on nomme
feton, & qui fert à entretenir la communication de
deux plaies.
Biftouri.
Les maréchaux font ufage de cet inftrument de
chirurgie , deftirié à faire des incifions.
Le biftourî eft en forme de petit couteau. Il y
en a de droits & de courbes.
La lame doit être de bon acier bien trempé.
La partie tranchante du biftouri droit eft perpendiculaire
: fon dos forme une ligne oblique, & i
a une ligne d’épaiffeur à fa bafe ; il va en dimi-
nuant infenfiblement jufqu’à la pointe.
Le biftouri courbe doit n’avoir qu’une courbure ]
prefque infenftble , qui commence dès fa bafe & ;
fe c.ontinue jufqu’à la pointe : le tranchant eft dans ;
la courbure.
L e manche des biftouris eft ordinairement corn-
pofé de deux lames d’ècaille ,x de la même confi.
guration que la lame.
Il y a des biftouris boutonnés par leur extrémité,
pour fervir dans le cas ou l’on craint de piquer I
les parties par la pointe de l’inftrument.
On fe fert auffi de biftouris à deux tranchans,
pour l’ouverture des abcès.
A u refte , cet inftrument peut être très - varié I
dans fa forme & fuivant l’ufage qu’on en veut
faire. ~
Feuille de Sauge.
Inftrument de maréchalerie. Sorte de biftouri I
dont la forme indique les ufages , & auquel nous 1
avons recours lorfqu’il s’a g it , dans des parties caves I
& profondes , de Couper & d enlever des chairs I
fuperflues, de quelque efpèce qu’elles puiffent être.
La longueur de la lame eft d environ trois pou- I
ces. Celle du manche qui lui eft adapté par foie
ou par quelque autre monture fixe , eft a peu près I
la même. Ce tte même lame eft pointue ; elle a
deux tranchans bombés également en dedans & I
en dehors ; elle eft: recourbée fur le p la t , dès le I
tiers de fa lon gueu r, à compter depuis le manche,
fuivant la même courbe que celle du bombement I
de fes tranchans. Cette courbure eft l’arc d’unce/cle
d’environ cinq pouces de rayon.
La plus grande largeur de la lame fe rencontre
à la naiffance de la courbure , & ne paffe pas huit
lignes. H ; .
Sa furface concave , relativement a fa courbure
fur p la t , eft diviféè en deux pans égaux & fem* J
blab les, -depuis le manche juiqu’à la pointe, par !
une arête formée par la naiffance des deux bifeaux
qui conftituent les .tranchans de droite & de
gauche. {;$• >.. ,,
Cette arête près du manche , à un peu plus a un
ligne de hauteur perpendiculaire , & là fe rencontre
la plus grande épaiffeur de la lam e , qui va con£
tamment en décroiffant infenfiblement jufqua
pointe. 1 * " ' , a
Sa furface co n v e x e , toujours relativement a »
courbure fur plat , eft droite dans le fens e
largeur , ou plutôt un peu creufée par la. ronde
de la meule. . . ‘ ;|;eU
Quant aux côtés , ce n’eft que depuis le
jufqu’à . l’extrémité de la lame, qu ils font or *
rement affilés réellement tranchans.
Lancette.
Infiniment d’acier extrêmement f in , très-pointu
& à deux tranchans , qui fert à ouvrir la veine.
On diftingùe ordinairement quatre fortes de
lancettes ; la première eft à grain d'orge : elle eft
plus large vers la pointe que les au tre s, afin de
faire une plus grande ouverture en faignant : elle
convient pour les vaiffeaux gros & fuperficiels.
La lancette appelée lancette à grain dravoine , a .
fa pointe plus alongée que celle de la précédente : j
elle eft propre pour ouvrir les vaiffeaux profonds.
La troifième eft en pyramide ou à la.ngue.de fer- \
pent : elle va toujours en diminuant & fe termine
par une pointe très-longue, très-fine & très-aiguë.
Elle convient aux vaiueaux les plus profonds.
La quatrième eft nommée lancette à abcès ; elle
eft plus for te , plus lo n gu e , & plus large que les
autres.' v; .
Les maréchaux fe fervent ordinairement d ’une
flamme au lieu de lancette.
Flamme.
Inftrument de maréchalerie , qui n’eft proprement
qu’une lancette d’a c ie r , courte & large ; elle
fort, comme le paleton d’une c lé , à quelque distance
de l’une des deux extrémités d’une tige de
même m é ta l, & ne fait avec elle qu’iiii feul &
même tout.
Cette définition fuffit pour en indiquer les ufages
, qui fe bornent à l’ouverture des vaiffeaux
du cheval dans la pratique de la faignée.,
Je décrirai quatre efpèces de flammes. O n fe fert
communément en France de la première ; les maréchaux
allemands préfèrent ordinairement la fécondé
; & la troifième & la quatrième m’ont paru
plus commodes , & plus convenables à l’opération
à laquelle cette forte d’ inftrument eft deftiné.
Flamme françoife.
Elle a pour tige une lame écarrie & bien dreffée,
dont la longueur eft de cinq pouces , la largeur
de trois lignes , l’épaiffeur de trois-quarts de ligne
a l’extrémité la plus éloignée de la lancette, & de
demi-ligne feulement à celle qui lui eft oppofée.
L’axe de la lancette s’élèv e perpendiculairement
fur une des longues faces d’épaiffeur de la t ig e ,
a neuf ou dix lignes du bout le plus mince. Sa
bafe q u i, par les quatre bifeaux qui forment les
deux tranchans, revient à un lofange très-alongé,
®a pour petite diagonale que l’épaiffeur de cette
% , & pour grande diagonale environ fix ou fept
jjgnes. Cette grande diagonale- fait partie de la
ligne de foi de la fa c e , fur laquelle s’élève cette
lancette. '
Les deux arêtes qui partent des deux bouts de la
petite diagonale, font droites & fe réunifient à 1 extrémité fupérieure de l’a x e , pour former une
pointe très-aiguë.- Les deux tranchans qui partent
des deux bouts de la grande diagonale , fe réunifient
auffi à la même pointe ; mais en fuivant
l ’un & l’autre non une ligne droite , mais une
courbe égale & renfermée dans l e plan commun
de l’axe & de la ligne de foi. Le centre de chacune
de ces cou rbes, qu’on peut rapporter à des
arcs de cercle d ’un pouce de rayon , fe trouve
au-delà du tranchant o p p o fé , & à une ligne ou
une ligne & demie de diflance de la face qui porte
la lancette.
O n affemble ordinairement trois ou quatre de ces
flammes, accordées fur le plat de pofition, de longueur
& de largeur , à cela près que les lancettes
font de di ver fes grandeurs.
O n les monte dans une châffe , au moyen d’un
feul clou rond qui traverfe les tiges près de leur
bout le plus éloigné des lancettes, ainfi que les
deux feuilles de la châffe fur lefquelles il eft rivé.
Ce s feuilles de cu iv r e , de fer ou d’autre métal
recouvert d’écaille ou autrement orné , font profilées
fur le profil des tiges , mais elles débordent
de quelques lignes le contour des lancettes.
Une cloifon auffi de métal, règne entre les rives
intérieures de ces parties faillantes des feuilles
de la châffe ; & par fon union avec elle par fou-
dure ou par r iv e t , elle forme des deux feuilles un
feul tout qui tient lieu de manche à ces flammes ,
& d’étui à leurs tranchans.
Les deux extrémités de cette petite cloifon fervent
de terme au x tiges quand on les pouffe dans
la châffe , & s’oppofent à ce que les pointes ne
s’émouffent contre le fond de l’étui.
Les bouts des tiges oppofés à ceux que le clou
tra v e r fe , furpaffent de trois lignes environ la longueur
de la châffe, pour faciliter la prife lorfqu’on
veu t ouvrir l’une des flammes , c’eft-à-dire, la tirer
de la châffe à l’effet de la mettre en oeuvre ; elles
ont même chacune, pour plus de commodité, une
encoche en deffous, que l’ongle peut faifir.
L e jeu de chacune d’elles fur le clou commun,
eft affez indépendant de celui des autres, pourvu
que la largeur de la cloifon tienne les feuilles de
•la châffe parallèles entre elles , & que les tiges
q u i , comme je l’ai déjà o b fe rv é , diminuent d ’épaiffeur
à mefure qu’elles approchent de leur b o u t ,
foient applanies parallèlement autour de l’oeil par
lequel le clou les affemble.
Flamme allemande, fécondé efpèce.
L a lancette proprement dite eft moins large par
fa bafe d’une ligne & demie , & plus longue d’environ
autant que la lancette de la flamme françoife.
Elle eft plate d’un côté , elle a deux bifeaux de
l’autre. Son tranchant antérieur eft prefque droit
à fon départ de la tige , mais bientôt après il fe
courbe., & précipite de plus en plus fa courbure,
à mefure qu’il approche de la pointe.
L e tranchant poftérieur eft d ro it , & l’arête qui
S s s i j