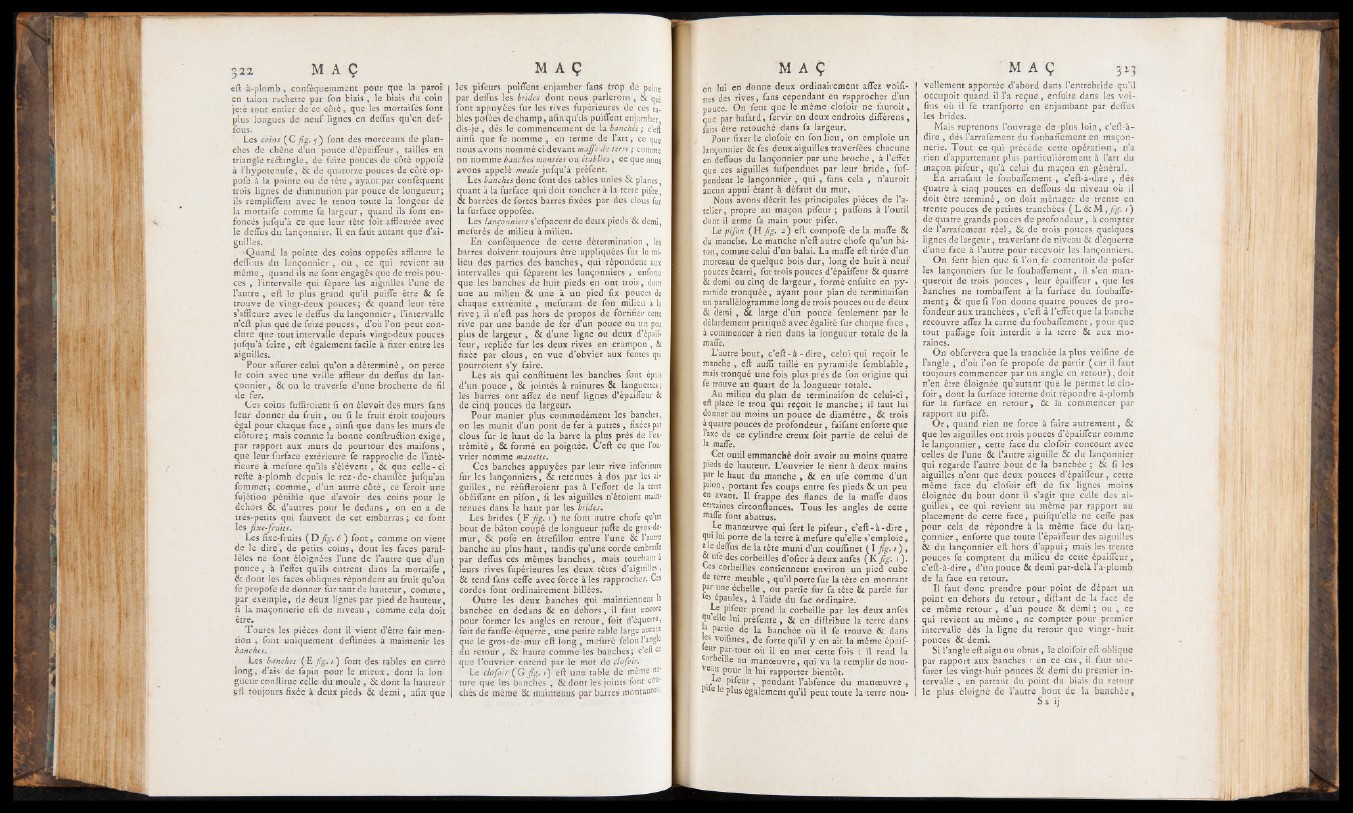
eft à-plomb, -conféquemment pour que la paroi
en talon rachette par fon biais , le biais du coin
jeté tout entier de ce côté, que les mortaifes font
plus longues de- neuf lignes en deffus qu’en def-
fous.
Les coins {G fig. f") font des morceaux de planches
de chêne d’un pouce d’èpaiffeur, taillés en
triangle re&angle, de feize pouces de côté oppofé
à Fhypotenufe, & de quatorze pouces de côté oppofé
à la pointe ou de tête , ayant par conféquent
trois lignes de diminution par pouce de longueur;
ils remplirent avec le tenon toute la longeur de
la mortaife comme fa largeur, quand ils font enfoncés
jufqu’à ce que leur tête foit affleurée avec
le deffus du lançonnier. Il en faut autant que d’aiguilles.
, ' Quand la pointe des coins oppofés affleure le
deffous du lançonnier , ou , ce qui revient au
même , quand ils ne font engagés que de trois pouces
, l’intervalle qui -fépare les aiguilles l’une de
l’autre , efl le plus grand qu’il puiffe être & fe
trouve de vingt-deux pouces ; & quand leur tête
s’affleure avec le deffus du lançonnier, l’intervalle
n’eft plus que de feize pouces, d’où l’on peut conclure
que tout intervalle depuis vingt-deux pouces
jufqu’à feize, eft également facile à fixer entre les
aiguilles.
Pour affurer celui qu’on a déterminé, on perce
le coin avec une vrille affleur du deffus du lançonnier
, & on le traverfe d’une brochette de fil
de fer. |
Ces coins fuffiroient fi on élevoit des murs fans
leur donner du fruit, ou fi le fruit étoit toujours
égal pour chaque face , ainfi que dans les murs de
clôture ; mais comme la bonne conftru&ion exige,
par rapport aux murs de pourtour des maifons ,
que leur furface extérieure fe rapproche de l’intérieure
à mefure qu’ils s’élèvent , & que celle - ci
refte à-plomb depuis le rez-de-chauffée jufqu’au
fommet;-comme, d’un autre côté, ce feroit une
fùjétion pénible que d’avoir des coins pour le
dehors & d’autres pour le dedans , on en a de
très-petits qui fauvent de cet embarras ; ce font
les fixe-fruits.
Les fixe-fruits ( D fig. 6 ) font, comme on vient
de le dire', de petits coins, dont les faces parallèles
ne font éloignées l’une de l’autre que d’un
pouce, à l’effet qu’ils entrent dans la mortaife ,
& dont les faces obliques répondent au fruit qu’on
fe propofe de donner fur tant de hauteur , comme,,
par exemple, de deux lignes par pied de hauteur,
fi la maçonnerie efl de niveau, comme cela doit
être.
Toutes les pièces dont il vient d’être fait mention
, font uniquement deftinées à maintenir les
hanches. .
Les hanches ( E fig. i ) font des tables en carré
long, d’ ais de fapin pour le mieux, dont la longueur
conftitue celle du moule , & dont la hauteur
elt toujours fixée à deux pieds & demi, afin que
les pifeurs pulffent enjamber fans trop de peine
par deffus les brides dont nous parlerons, & qui
font appuyées fur les rives fupérieures de ces tables
polées de champ, afin qu’ils puiffent enjamber,
dis-je , dès le commencement de la banchée ; c’eft
ainfi que fe nomme , en terme de l’art, ce que
nous avons nommé ci-devant majfe de terre ; comme
on nomme hanches montées ou établies, ce que nous
avons appelé moule jufqu’à préfent.
Les hanches donc font des tables unies & planes,
quant à la furface qui doit toucher à la terre pifée,
& barrées de fortes barres fixées par des clous fur
la furface oppofée. .
Les lançonnier s s’ efpacent de deux pieds ’& demi,
mefurés de milieu à milieu.
En conféquence de cette détermination , les
barres doivent toujours être appliquées fur le milieu
des parties des banches, qui répondent aux
intervalles qui fpparent les lançonniers , enforte
que les banches ae huit pieds en ont trois, dont
une au milieu & une à un pied fix pouces de
chaque extrémité , mefurant de fon milieu à la
rive ; il n’eft pas hors de propos de fortifier cette
rive par une bande de fer d’un pouce ou un peu
plus de largeur , & d’une ligne ou deux d’épaif-
feur, repliée fur les deux rives en crampon , &
fixée par clous, en vue d’obvier aux fentes qui
pourraient s’y faire.
Les ais qui conftituent les banches font épais
d’un pouce , & jointés à rainures & languettes;
les barres ont affez de neuf lignes d’épaiffeur &
de cinq pouces de largeur.
Pour manier plus commodément les banches,
on les munit d’un pont de fer à pattes, fixées pat
clous fur le haut de la barre la plus près de l’extrémité
, & formé en poignée. C’eft ce que l’ouvrier
nomme manette.
Ces banches appuyées par leur rive inférieure
fur les lançonniers, & retenues à dos par les
guilles, ne réfifteroient pas à l’effort de la terre
obéiffant en pifon, fi les aiguilles n’étoient maintenues
dans le haut par les brides.
Les brides ( F fig. / ) ne font autre chofe qu’un
bout de bâton coupé de longueur jufte de gros-de-
mur, & pofé en étrefillon entre l’une & l’autre
banche au plus haut, tandis qu’une corde embrafle
par deffus ces mêmes banches, mais touchant a
leurs rives fupérieures les deux têtes d’aiguilles,
& tend fans ceffe avec force à les rapprocher. Ces
cordes font ordinairement billéés.
Outre les deux banches qui maintiennent la
banchée en dedans & en dehors, il faut encore
pour former les angles en retour, foit d’équerre,
foit de fauffe-équerre, une petite table large autant
que le gros-de-mur efl jong , mefuré félon l’angle
du retour, & haute comme les banches; c’eft ce
que t’ouvrier entend par le mot de clofoir.
Le clofoir (G fig. /) eft une table de même na*
j ture que les banches , & dont les joints font cou*
I chés de même & maintenus par barres montantes.
on lui en donne deux ordinairement affez voifi-
nes des rives, fans cependant en rapprocher d’un
pouce. On fent que le même clofoir ne fauroit,
que par hafard, fervir en deux endroits différens,
fans être retouché dans fa largeur.
Pour fixer le clofoir en fon lieu, on emploie un
lançonnier & fes deux aiguilles traverfées chacune
en deffous du lançonnier par une broche, à l’effet
que ces aiguilles fufpendues par leur bride, fuf-
pendent le lançonnier , qui , fans cela , n’auroit
aucun appui étant à défaut du mur.
Nous avons décrit les principales pièces de l’atelier,
propre au maçon pifeur ; paffons à l’outil
dont il arme fa main pour pifer.
Le pifon (H jfig. a ) efl compofé de la malle &
du manche. Le manche n’eft autre chofe qu’un bâton,
comme celui d’un balai. La malle eft tirée d’un
morceau de quelque bois dur, long de huit à neuf
pouces écarri, fur trois pouces d’épaiffeur & quatre
& demi ou cinq de largeur, formé enfuite en pyramide
tronquée, ayant pour plan de terminaifon
un parallélogramme long de trois pouces ou de deux
& demi , & large d’un pouce feulement par le
délardement pratiqué avec égalité fur chaque face ,
à commencer à rien dans la longueur totale de la
maffe.
L’autre bout, c’e ft-à -d ire , celui qui reçoit le
manche, eft auffi taillé en pyramide femblâble,
mais tronqué une fois plus près de fon origine qui
fe trouve au quart de la longueur totale.
Au milieu du plan de terminaifon de celui-ci,
eft placé le trou qui reçoit le manche ; il faut lui
donner au moins un pouce de diamètre, & trois
a quatre pouces de profondeur, faifant enforte que
l’axe de ce cylindre creux foit partie de celui de
la maffe.
vellement apportée d’abord dans l’entrebride qu’il
occupoit quand il l’a reçue, enfuite dans les voi-
fins où il fe tranfporte en enjambant par deffus
les brides.
Mais reprenons l’ouvrage de plus loin, c’eft-à-
dire , dès l’arrafement du foubaffement en maçonnerie.
Tout ce qui précède cette opération, n’a
rien d’appartenant plus particulièrement à l’art du
maçon pifeur, qu’à celui du maçon en général.
En arrafant le foubaffement , c’eft-à-dire , dès
quatre à cinq pouces en deffous du niveau où il
doit être terminé, on doit ménager de trente en
trente pouces de petites tranchées (L & M , fg . /)
de quatre grands pouces de profondeur, à compter
de l’arrafement réel, & de trois pouces quelques
lignes de largeur, traverfant de niveau & d’équerre
d’une face à l’autre pour recevoir les lançonniers.
On fent bien que fi l’on, fe contentoit de pofer
les lançonniers fur le foubaffement, . il s’en manquerait
de trois pouces , leur épaiffeur , que les
banches ne tombaffent à-la furrace du foubaffement
; & que fi l’on donne quatre pouces de profondeur
aux tranchées , c’eft à l’effet que la banche
recouvre affez la carne du foubaffement, pour que
tout paffage foit interdit à la terre & aux moraines.
-
On obfervera que la tranchée la plus voifine de
l’angle , d’où l’on fe propofe de partir (car il faut
toujours commencer par un angle en retour), doit
n’en être éloignée qu’autant que le permet le clofoir
, dont la mrface interne doit répondre à-plomb
fur la furface en retour, & la commencer par
rapport au pifé.
O r , quand rien ne force à faire autrement, &
que les aiguilles ont trois poucès d’épaiffeur comme
le lançonnier, cette face du clofoir concourt avec
celles de l’une & l’autre aiguille & du lançonnier
qui regarde l’autre bout de la banchée ; & fi les
aiguilles n’ont que deux pouces d’épaiffeur, cette
même face du clofoir eft de fix lignes moins
éloignée du bout dont il s’agit que celle des aiguilles
, ce qui revient au même par rapport au
placement de cette face, puifqu’elle ne ceffe pas
pour cela de répondre à la même face du lançonnier
, enforte que toute l’épaiffeur des aiguilles
& du lançonnier eft hors d’appui; mais les trente
pouces fe comptent du milieu de cette épaiffeur,
c’eft-à-dire, d’un pouce & demi par-delà 1'’à-plomb
de la face en retour.
Il faut donc prendre pour point de départ un
point en dehors du retour, diftant de la face de
ce même retour , d’un pouce & demi ; ou , ce
qui revient au même , ne compter pour premier
intervalle dès la ligne du retour que vingt-huit
pouces & demi.
Si l’angle eft aigu ou obtus, le cloifoir eft oblique
par rapport aux banches : en ce cas, il faut me-
furer les vingt-huit pouces & demi du premier intervalle
, en partant du point du biais du retour
le plus - éloigné de l’autre bout de la banchée *
S s ij