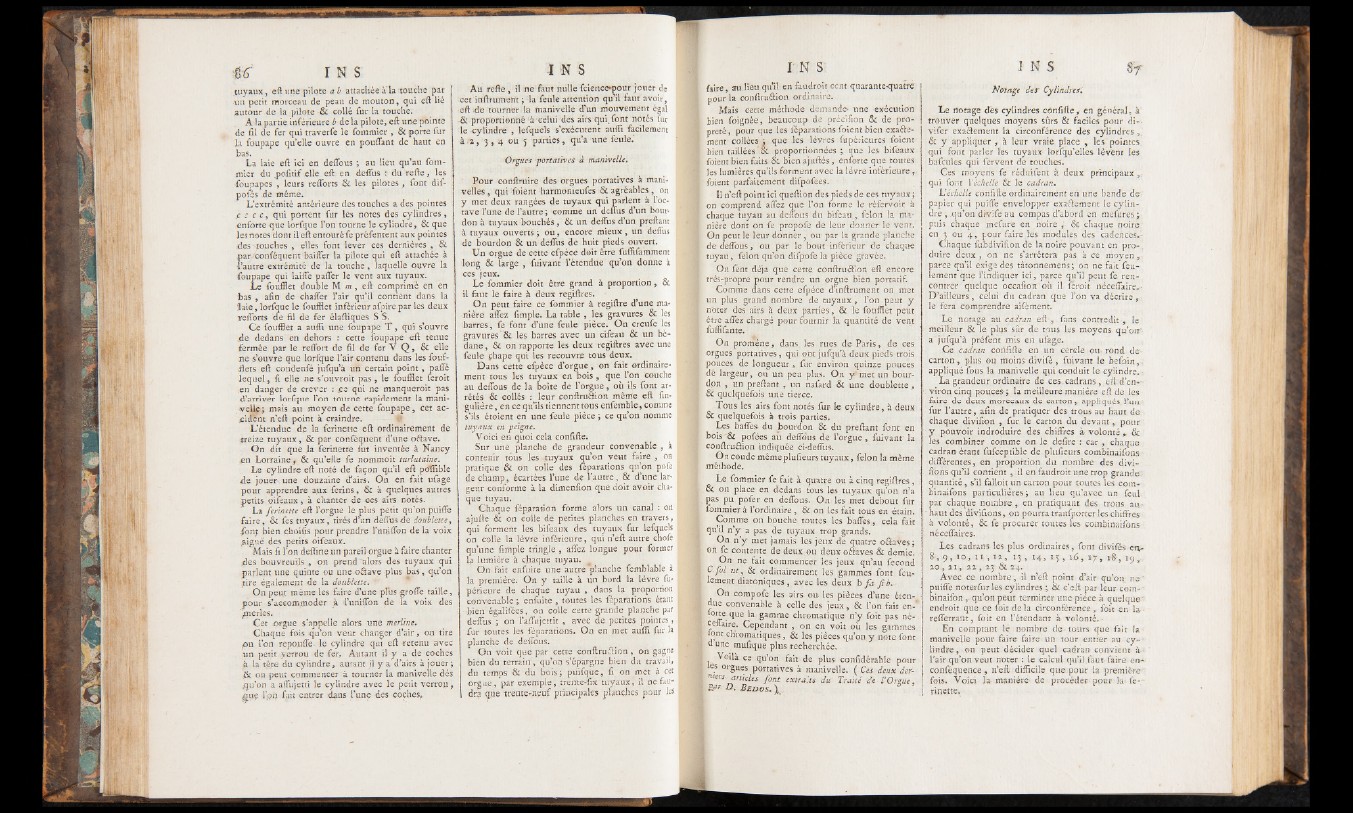
0 r n s
tuyaux, eft une pilote a b attachée à'la touche par
un petit morceau de peau de mouton, qui eft lié
autour de la pilote & collé fur la touche.
A la partie inférieure b de la pilote, eft une pointe
de fil de fer qui traverfe le fommier , & porte fur
la foupape qu’elle ouvre en pouffant de haut en
bas.
La laie eft ici en deffous ; au lieu qu’au fommier
du .pofitif elle eft en deffus : du refte, les
fouoapes , leurs refforts & les pilotes , font dif-
pofes de même.
L’extrémité antérieure des touches a des pointes
£ c c c y qui portent fur les notes des cylindres,
enforte que lorfque l’on tourne le cylindre, & que
les notes dont il eft entouréfe préfentent aux pointes
des 'fouches , elles font lever ces dernières , &
par donféquent baiffer la pilote qui eft attachée à
•l’autre extrémité de la touche, laquelle ouvre la
foupape qui laiffe paffer le vent aux tuyaux.
Le foufflet double M m, eft comprimé en en
bas , afin de chaffer l’air qu’il contient dans la
;laie, lorfque le foufflet inférieur afpire par les deux
refforts de fil de fer élaftiques S S.
Ce foufflet a aufli une foupape T , qui s’ouvre
de dedans en dehors : cette foupape eft tenue
fermée par le reffort de fil de fer V Q , 8c elle
ne s’ouvre que Lorfque l’air contenu dans les fouf-
ilets eft condenfé jufqu’à un certain point, paffé
lequel, fi elle ne s’ouvroit pas, le foufflet feroit
en danger de crever : £e qui ne manqueroit pas
d^arriver lorfque l’on tourne rapidement la mani-
JveMgmais au moyen de cette foupape, cet accident
n’eft point à craindre.
L’étendue de la ferinette eft ordinairement de
•treize tuyaux, & par conféquent d’une oftave.
On dit que ,1a ferinette fut inventée à Nancy
en Lorraine t & qu’elle fe nomrnoit turlutaine.
Le cylindre eft noté de façon qu’il eft pdïiible
de jouer une douzaine d’airs. On en fait ufage
pour apprendre aux ferjns, & à quelques autres
petits oifeaux, à chanter de ces airs notés.
La ferinette eft l’orgue le plus petit qu’on puiffe
faire, & fes tuyaux, tirés d’un de fins de doublette y
fonj: bien choifis pour prendre l’uniffon de la voix
^iguë des petits oifeaux.
Mais fi l’on deftine un pareil orgue à faire chanter
des bouvreuils , ç>n prend'alors des tuyaux qui
parlent une quinte ou une oâave plus bas, qu’on
.tire également de la doublette.
On peut même les faire d’une plus greffe taille,
pour s’accommoder à l ’uniffon de la voix des
perles.
Cet orgue s’appelle alors une merline.
Chaque fois qu’on veut changer d’air, on tire
o u l’on repouffe- le cylindre qui eft retenu avec
un petit verrou de fer. Autant il y a de coches
à la tête du cylindre , autant il y a d’airs à jouer ;
on peut commencer à tourner la manivelle dès
ou’on a affujetti le cylindre avec le petit verrop,
giiç lpn fait entrer dans l'une des coches,
1 m S Au refte, il ne faut nulle fcience*pour jouer de j cet inftrumetft ; la feule attention qu’il faut avoir,
eft de tourner la manivelle d’un mouvement égal
-& proportionné 'à. ‘cëliii des airs quiv font notés fur J
le cylindre , lefquels s’exécutent aufli facilement
à -~2 y 3 , 4 ou 5 parties, qu’à une feule.
Orgues portatives à manivelle.
Pour conftruire des orgues portatives à manivelles,
qui -foient harmonieufes & agréables, on
y met deux rangées de tuyaux qui parlent à l’octave
l’une de l’autre ; comme un deffus d’un bourdon
à tuyaux bouchés , & un deffus d’un preftant
à tuyaux ouverts ; o u , encore mieux, un deffus
de bourdon & un deffus de huit pieds ouvert.
Un orgue de cette efpèce doit être fuffifamment
long & large , fuivant l’étendue qu’on donne à
ces jeux.
Le fommier doit être grand à proportion, & I
il faut le faire à deux regiftres.
On peut faire ce fommier à regiftre d’une manière
affez fimple. La table , les gravures & les
barres, fe font d’une feule pièce. On creufe les
gravures & les barres avec un cifeau & un bédane,
& on rapporte les deux regiftres avec une
feule çhape qui les recouvre tous deux.
Dans cette efpèce d’orgue , on fait ordinairement
tous les tuyaux en bois, que l’on Gouche
au deffous de la boîte de l’orgue, où ils font arrêtés
& collés : leur conftruétion même eft fin-
gulière, en ce qu’ils tiennent tous enfemble, comme
s’ils étoient en une feule pièce ; ce qu’on nomme
tuyaux en peigne.
Voici en quoi cela confifte.
Sur une planche de grandeur convenable , à
contenir tous les -tuyaux qu’on veut faire , on
pratique $c on colle des fèparations qu’on pofe
de champ, écartées l’une de l ’autre , & d’une largeur
conforme à la dimenfion que doit avoir chaque
tuyau.
Chaque fépjaration forme alors un canal : on
ajufte & on colle de petites planches en travers,
qui forment les bifeaux des tuyaux fur lefquels
on colle la lèvre inférieure, qui n’eft autre chofe.
qu’une fimple tringle , affez longue pour former
la lumière à chaque tuyau. ^
On fait enfuite une autre planche femblable à
la première. On y taille à un bord la lèvre fu*
périeure de chaque tuyau , dans la proportion
con v én ab le en fuite to ute s les fèparations étant
•bien-égalifées, on colle cette grande planche par
deffus ; on l’affujettit , avec de petites pointes,
fur toutes les fèparations. On en met aufli fur la
planche de deffous.
On voit que par cette eonftruélion, on gagne
bien du terrain, qu’on s’épargne bien du travail»
du temps & du bois ; pùifque,, fi on met à cet
orgue, par exemple., trente-fix tuyaux, il ne faudra
que trenternçuf principales planches pour -les
r N' s
faire au lieu qu’il: en faudroît cent quarante-quatre'
pour la conftru&ion ordinaire.
Mais cette méthode demande- une exécution
bien foignée, beaucoup de précifion & de propreté,
pour que les fèparations foient bien exactement
collées : que les lèvres fupérieures foient
bien taillées oc proportionnées ; que les bifeaux
foient bien faits & bienajuftés, enforte que toutes
les lumières qu’ils forment avec la lèvre inférieure,
foient parfaitement difpofèes.
Il n’eft point ici queftion des pieds de ces tuyaux ;
on comprend affez que l’on forme le rêfervoir à
chaque tuyau au deffous du b ife au fé lo n la manière
dont on fe propofe de leur donner le vent.
On peut le leur donner, ou par la grande planche
de deffous, ou par le bout inférieur de chaque
tuyau, félon qu’on difpofe la pièce gravée.
On fent déjà que cette conftruétton eft encore
très-propre pour rendre un orgue bien portatif.
Comme dans cette efpèce d’inftrument on met
un plus grand nombre de tuyaux, l’on peut y
noter des airs à deux parties, & le foufflet peut
être affez chargé pour fournir la quantité de vent
fuflifante.
On promène, dans, les rues de Paris, de ces
orgues portatives, qui ont jufqu’à deux pieds trois
pouces de longueur, fur environ quinze pouces
dê largeur, ou un peu plus. On y met un bourdon
, un preftant , un nafard & une doublette,
& quelquefois une tierce.
Tous les airs font notés for- le cylindre, à deux
& quelquefois à trois parties.
Les baffes- du bourdon & du preftant font en
bois"& pofées au defîous de l’orgue, fuivant la
eonftruâion indiquée chdeffus.
On coude mêmeplufieurs tuyaux, félon la même
méthode.
Le fommier fefait à quatre ou à cinq regiftres,
& on place en dedans, tous les tuyaux qu’on n’a
pas pu pofer en deffous. On les met debout fur
fommier à l’ordinaire , & on les fait tous en étain.
Comme on bouche toutes les baffes,, cela fait
qu’il n’y a pas de tuyaux trop grands.
On n’y met jamais les jeux de quatre o&aves ;
on fe contente de deux ou deux oéfaves & demie.
On ne fait commencer les jeux qu’au fécond
C.fol ut y & ordinairement les gammes font feulement
diatoniques , avec les deux b fa f i b.
On compofe les airs ou les pièces d’une étendue
convenable à celle des jeux, & l’on fait en-*
férte. que la. gamme chromatique n’y foit pas né-
ce.ffaire. Cependant , on en voit où les gammes
i font chromatiques, & les pièces qu’on y note font
a une muftque plus recherchée.
Voilà ce qu’on fait de plus confidérable pour
tes orgues portatives à manivelle, ( Ces deux der-
mus' articles font extraits du Traité de T Orgue*
IBP*D. Bedos*)k,
J N S 8r
Notage des' Cylindres
Le itofage des cylindres confifte, en général, à
trouver quelques moyens sûrs & faciles pour di--
vifer exactement la circonférence des cylindres ,,
& y appliquer à leur vraie place , les pointes,
qui font parler les tuyaux- lorfqy’elles lèvênt les
bafcules qui fervent de touches.
Ces moyens fe réduifent à deux principaux,,
qui font l'échelle & le cadran.
L’échelle confifte ordinairement en une bande de -
papier qui puiffe envelopper exactement le cylindre
-, „qu’on di-vife au compas d’abord en mefores y
puis chaque mefure en noire , 8e chaque noire '
en 3 ou 4 , pour faire les modules des caderices.-
Chaque fobdivlfion de la noire pouvant en pro-.
duire deux , on ne s’arrêtera pas à ce moyen ,
parce qu’il exige des tâtonnemens; on ne fait feulement
que l’indiquer ici, parce qu’il peut fe rencontrer
quelque oecafion où il féroit néceffaire.-
D’ailleurs, celui du cadran que l’on va décrire,
le fera comprendre aifément.
Le no.tage au cadran eft>•- fans contredit , le
meilleur & le plus sur de tous les moyens qu’orr-
a jufqu’à préfênt mis en ufage.
.Ce cadran confifte en un cercle ou-rond de-
carton, plus ou moins d ivifé, fuivam le befoin,.
appliqué fous la manivelle qui conduit le cylindre. :
La grandeur ordinaire de ces.cadrans , eft d’en --
vironcinq pouces; la meilleure manière eft de les
faire de deux morceaux de carton, appliqués.l’un
for l ’autre, afin de pratiquer des trous au haut de
chaque divifion , for le carton du devant, pour
y pouvoir indroduire des chiffres à volonté,. &
les combiner comme on le defire : car , chaque
cadran étant fofceptible de plufieurs combinaifons
différentes, en proportion du nombre des divi-
fibns<ju’il contient, il en faudroit une trop grande"
quantité, s’il falloit un carton pour toutes les combinaifons
particulières; au lieu1 qu’avec un feul-
par chaque nombre , en pratiquant des trous au *
haut des divifions, on pourra tranfporter les chiffres
à volonré, & fe procurer toutes les combinaifons
néceffaires.
Les cadrans les plus ordinaires, font divifês eo-
8-, 9 , i o , i i , i 2 , 13 , 1 4 , ï ) , 1 6 , * 7 , i-8 } 19 s...
20., 2 1 , 2 2 , 2 3 & 24.
Avec ce nombre , il n’eft point d’air qu’on ne"
puiffe noterforles cylindres ; & c’eft par leur corn-'
binaifon,- qu’on peut terminer une pièce à quelque-
endroit que.ee foit de la circonférence, foit en la-
refferrant, foit en l’étendant à- volonté.-
En comptant lé nombre de-tours que fait la^
manivelle pour faire faire un tour entier au cy-~
lindi'e, on peut décider quel cadran convient à->
l’air qu’on veut noter : le calcul qu’il.faut-faire en-^
conféquence, n’eft difficile que pour la première '
fois. Voici la- manière de procéder pour la fe--
rinette.