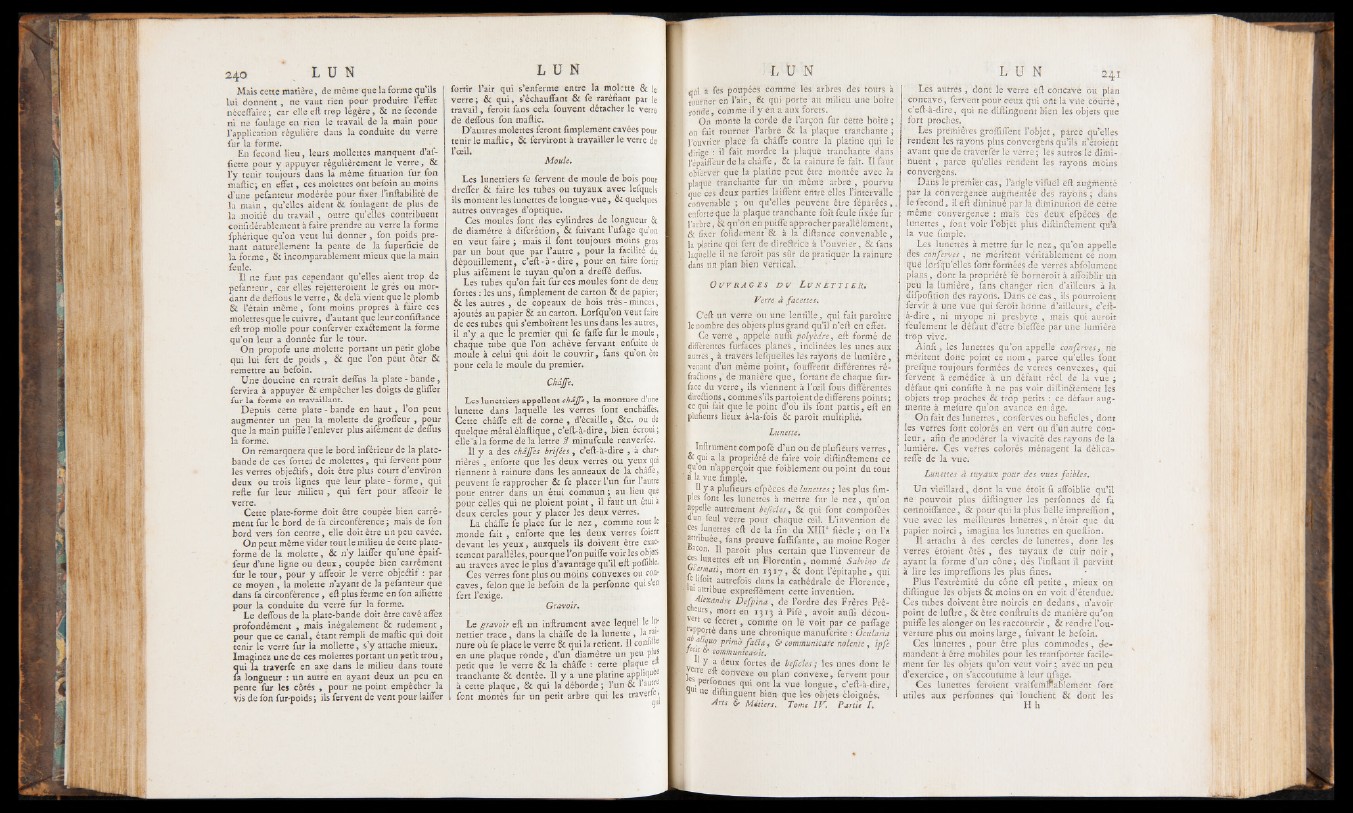
Mais cette matière, de même que la forme qu’ils
lui donnent, ne vaut rien pour produire l’effet
néceffaire ; car elle eft trop légère, & ne fécondé
ni ne foulage en rien le travail de la main pour
Inapplication régulière dans la conduite du verre
fur la forme.
En fécond lieu, leurs mollettes manquent d’af-
fiette pour y appuyer régulièrement le verre, &
l’y tenir toujours dans la même fituation fur fon
maftic; en effet, ces molettes ont befoin au moins
d’une pefanteur modérée pour fixer l’inftabilité de
la main , qu’elles aident & foulagent de plus de
la moitié du travail , outre quelles contribuent
cohfidérablement à faire prendre au verre la forme
fphérique qu’on veut lui donner, fon poids prenant
naturellement la pente de la fuperficie de
la forme, & incomparablement mieux que la main
feule.
Il ne faut pas cependant qu’elles aient trop de
pefanteur, car elles rejetteroient le grès ou mordant
de deffous le verre, & delà vient que le plomb
& l’étain même, font moins propres à faire ces
molettes que le cuivre, d’autant que leur confiftance
eft trop molle pour conferver exa&ement la forme
qu’on leur a donnée fur le tour.
On propofe une molette portant un petit globe
qui lui fert de poids , & que l’on peut ôter &
remettre au befoin.
Une doucine en retrait deftus la plate - bande,
fervira à appuyer & empêcher les doigts de glifler
fur la forme en travaillant.
Depuis cette plate - bande en haut, l’on peut
augmenter un peu la molette de groffeur , pour
que la main puiffe l’enlever plus aifément de deftus
la forme.
On remarquera qûe le bord inférieur de la plate-
bande de ces fortes de molettes, qui fervent pour
les verres objectifs, doit être plus court d’environ
deux ou trois lignes que leur plate - forme, qui
refte fur leur milieu, qui fert pour affeoir le
verre.
Cette plate-forme doit être coupée bien carrément
fur le bord de fa circonférence ; mais de fon
bord vers fon centre, elle doit être un peu cavée.
On peut même vider tout le milieu de cette plateforme
de la molette, & n’y laiffer qu’une épaif-
fcur d’une ligne ou deux, coupée bien carrément
fur le tour, pour y affeoir le verre objeâif : par
ce moyen , la molette n’ayant de la pefanteur que
dans fa circonférence, eft plus ferme en fon afliette
pour la conduite du verre fur la forme.
Le deffous de la plate-bande doit être cavé affez
profondément , mais inégalement & rudement,
pour que ce canal, étant rempli de maftic qui doit
tenir le verre fur la mollette, s’y attache mieux.
Imaginez une de ces molettes portant un petit trou,
qui la traverfe en axe dans le milieu dans toute
la longueur : un autre en ayant deux un peu en
pente fur les côtés , pour ne point empêcher la
vis de fon fur-poids ; ils fervent de vent pour laiffer
forfir l’air qui s’enferme entre la molette & le
verre; & qui, s’échauffant & fe raréfiant par le
travail, feroit fans cela fouvent détacher le verre
de deffous fon maftic.
D’autres molettes feront fimplement cavées pour
tenir le maftic, 8c ferviront à travailler le verre de
l’oeil.
Moule.
Les lunettiers fe fervent de moule de bois pour
dreffer & faire les tubes ou tuyaux avec lefquels
ils montent les lunettes de longue-vue, & quelques
autres ouvrages d’optique.
Ces moules font des cylindres de longueur &
de diamètre à difcrétion, & fuivant l’ufage qu’on
en veut faire ; mais il font toujours moins gros
par un bout que par l’autre , pour la facilité du
dépouillement, c’eft - à - dire, pour en faire fortir
plus aifément le tuyau qu’on a dreffé deftus.
Les tubes qu’on fait fur ces moules font de deux
fortes : les uns, fimplement de carton & de papier;
& les autres , de copeaux de bois très - minces,
ajoutés au papier & au carton. Lorfqu’on veut faire
de ces tubes qui s’emboîtent les uns dans les autres,
il n’y a que le premier qui fe faffe fur le moule,
chaque tube que l’on achève fervant enfuite de
moule à celui qui doit le couvrir, fans qu’on ôte
pour cela le moule du premier.
Châffe.
Les lunettiers appellent chaffe, la monture d’une
lunette dans laquelle les verres font enchâfles.
Cette châffe eft de corne , d’écailïe, &c.^ ou de
quelque métalélaftique, c’eft-à-dire, bien écroui;
elle “a la forme de la lettre 3 minufcule renverfée.
Il y a des châjfes brifées, c’eft-à-dire , à charnières
, enforte que les deux verres ou yeux qui
tiennent à rainure dans les anneaux de la châffe,
peuvent fe rapprocher & fe placer l’un fur l’autre
pour entrer dans un étui commun ; au lieu que
pour celles qui ne ploient point, il faut un etui à
deux cercles pour y placer les deux verres.
La châffe fe place fur le n e z , comme tout le
monde fait , enforte que les deux verres foient
devant les y eu x , auxquels ils doivent être exactement
parallèles, pour que l’on puiffe voir les objets
au travers avec le plus d’avantage qu’il eft poflible.
Ces verres font plus ou moins convexes ou concaves
, félon que le befoin de la perfonne qui s’en
fert l’exige.
Gravoir.
Le gravoir eft un inftrument avec lequel le 1«'
nettier trace , dans la châffe de la lunette , la f«*1-
nure où fe place le verre & qui la retient. Il confine
en une plaque ronde, d’un diamètre un peu plu*
petit que le verre 8c la châffe : cette plaque ett
tranchante 8c dentée. Il y a une platine apphquèe
à cette plaque, 8c qui la déborde ; l’un & 1 autre
font montés fur un petit arbre qui les traverle»
mil à fês poüpéès comme lés arbres des toiifs à
tourner en l’air, & qui porte au milieu une boîte
ronde, fcomme il y èn a aux forets.
On monté là corde de l’arçon fur cette boîte ;
on fait tourner l’arbrè & la plaque tranchante ;
l’ouvrier place fa châffe contre la platine qui le
dirigé : il fait mordre la plaqué tranchante dans
l’épaiffeur de la châffe, & la rainure fe fait. Il faüt
obfervér que la platine petit être montée avec la
plaque tranchante fur un même arbre , pourvu
que ces deux parties lâiffeht entre elles l’intervâile '
convenable ; ou qu’elles peuvent être féparêes, .
enforte que la plaque tranchante foit feule fixée fur
l’arbre, & qu’on en puiffe approcher parallèlement,
& fixer foîidetnent 8c à la diftancé convenable,
la platine qui fert de dire&rice à l’ouvrier, & fans
; laquelle il ne feroit pas sûr de pratiquer la rainure
dans un plan bien vertical.. _
Ouv ra ge s d u Lu n ê t t i e k;
Verre à facettes.
i C’eft un verre ou une lentille , qui fait paroître
le nombre des objets plus grand qu’il n’eft en effet.
[ Ce verre , appelé auffi polyèdre, eft formé de ;
différentes furfaces planes , inclinées, les unes aux
autres, à travers lefquellés lés raÿoris de lumière ,
[venant d’un mêmé point, fouffrent différentes ré-
fraftions, de manière que, fortant de chaque fur-
face du verre, ils viennent à l’oeil fous différentes
direftions, comme s’ils partaient de différens points ;
ce qui fait que le point d’où ils font partis, eft en
[plufieurs lieux à-la-fois & paroît multiplié.
Lunette.
j Inftrument compofé d’un ou de plufieurs verres,
& qui a la propriété dé faire voir diftinâement cé
I qu’on li’apperçoit que foiblement ou point du tout
à la vue fimple.
I II y a plufieurs efpèces de lunettes ; les plus fim-
Iples font les lunettes à mettre fur le nez, qu’on
| appelle autrement beficles, & qui font compofées
P un feul verre pour chaque oeil. L’invention de
ces lunettes eft de la fin du XIIIe fiècle ; on l’a
attribuée, fans preuve fuffifante, au moine Roger
Inacon. Il paroît plus certain que l’inventeur de
Cfl! luiîe«es eft un Florentin, nommé Salvino de
> raort en 1317, & dont l’épitaphe, qui
I é lifoit autrefois dans la cathédrale de Florence,
J ui attribue expreffément cette invention.
I ^ exan^re JDêfpinà , de l’ordre des Frères Prê-
G eurs > mort en 1313 à Pife, avoit auffi décou-
| Vert ce fecret, comme on le voit par ce paffage
^apporte dans une chronique manuferite : Ocularia
■ > ^'Huo prirftà fa El a ,■ 6* cottiriïunicate nolente, ipfe
meut & communicaVk.
■ y y a deux fortes de befidles ; les-unes dont le
|i rre eft convexe ou plan convexe, fervent pour
s perfonnes qui ont la vue longue, e’eft-à-dire,
1" 1 ne diftinguent bien que les objets éloignés.
drts & Métiers. Tome IV. Partie I.
Les autres, dont le verre, eft côricaVè oii plan
• concave, fervent pour ceux cjtli oflt la vite courte,
c’eft-à-dire, qui ne diftinguent bien les objets que
fort proches.
Les premières groftiffent l’objet, parce qu’elles
fendent les rayons plus ebrivergèns qii’ils n’êtoiëht
avant que de tràvef fér le verre ; lés autres le diminue
ht , parce qu’elles rendent les rayons moins
convergéns.
Dans lé premier cas, l’ârfglfe vifüél eft augmenté
par là convergence augmentée des rayons ; dans
le fécond, il eft diminué par là diminution dé cette
même convergence : mais cês deux efpêcés de
lunettes , font voir l’objet pills diftinéte nient qirà
la vue fimple, •
Les lunettes à mettre fur le nez, qu’on appelle
des conferves , ne méritent véritablement cé nom
qué lorfqu’éîles font formées de verrés abfolument
plans, dont la propriété fé borneroit à affoiblir un
peu la lumière, fâns changer rien d’ailleurs à la
difpofition des rayons. Daris ce cas , ils pourroieiit
fervir à une vue qui feroit bonne d’ailleurs, c’eft-
à-dire , ni myope ni presbyte , mais qui auroit
feulement lé défaut d’être bieffée par une lumière
trop yivé.
Ainfi, les lunettes qu’on appelle conferves, ne
méritent donc point ce nom , parce qu’elles font
prefque toujours formées de verres convexes, qui
fervent à remédier à un défaut réel de la vue ;
défaut qui confifte à ne pas voir diffirï&ement les
objets trop proches & trop petits : ce défaut augmente
à mefure qu’on avance en âge.
On fait des lunéttes , conferves ou beficles, dont
les verres font colorés en vert ou d’un autre couleur
, afin de modérer la vivacité des rayons de la
lumière. Ces verres colorés ménagent la délicat
teffe de la vue.
Lunettes à tuyaux pour des vues foibles.
Un vieillard, dont la vue étôit fi affoiblie qu’il
ne poüvoit plus diftinguer les perfonnes de fa
connoiffance, & pour qui la plus belle imprefiion ,
vue avec les meilleures lunettes, n’étoit que du
papier noirci, imagina les lunettes en queftion.
Il attacha à des cercles de lunettes, dont les
verres étaient ôtés , des tuyaux de cuir noir ,
ayant la forme d’un cône; dès l’inftant il parvint
à lire les imprefilons lés plus fines.
Plus l’extrémité du cône eft petite , mieux on
diftingue les objets & moins on en voit d’étendue.
Ces tubes doivent être noircis en dedans, n’avoir
point de luftre, & être conftruits de manière qu’on
puiffe les alonger ou les raccourcir , & rendre l’ouverture
plus ou moins large, fuivant le bèfoiri.
Ces lunettes , pour être plus commodes , demandent
à être mobiles pour les tranfporter facilement
fur les objets qu’on veuf voir ; avec un peu
d’exercice, on s’accoutume à leur ùfage.
Ces lunettes fëroient vraîfemmablemént fort
utiles aux perfonnes qui louchent 8c dont les
H h