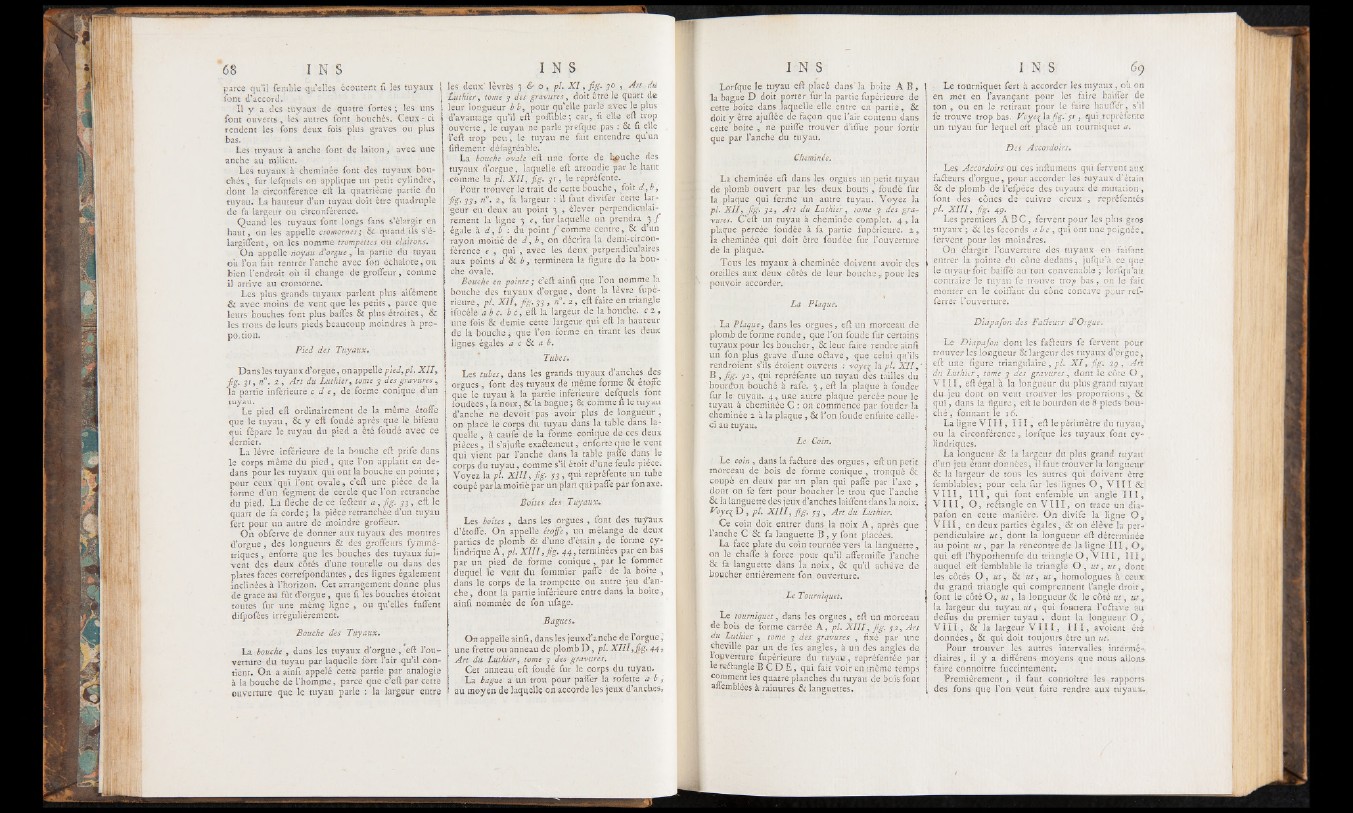
parce qu'il femble qu’elles écoutent fi les tuyaux
font d’accord. ■
Il y a des tuyaux de quatre fortes ; les uns
font ouverts, les autres font bouchés. C eux -ci
rendent les fons deux fois plus graves ou plus
bas.
Les tuyaux à anche font de laiton, avec une
anche au milieu.
Les tuyaux à cheminée font des tuyaux bouchés
; fur lefquels on applique un petit cylindre,
dont la circonférence eft la quatrième partie du
tuyau. La hauteur d’un tuyau doit être quadruple
de fa largeur ou circonférence.
Quand les tuyaux font longs fans s’élargir en
haut, On les appelle cromornes; 8c quand ils s’é-
largiffent, on les nomme trompettes ou clairons, ■ /!
On appelle noyau d’orgue, la partie du tuyau
oii l’on fait rentrer l’anche avec fon échalote, où
bien l'endroit où il change de groffeur, comme
il arrive au cromorne.
Les plus grands tuyaux parlent plus aifément
& avec moins de vent que les petits, parce que
leurs' bouches font plus baffes & plus étroites, &
les trous de leurs pieds beaucoup moindres à proportion.
Pied des Tuyaux.
Dans les tuyaux d’orgue, on appelle pied,pl. X II,
fig. 31, 7i°. 2 , Art du Luthier, tome 3 des gravures,
la partie inférieure c d e , de forme conique d’un
tuyau. . . . ...
Le pied eft ordinairement de la même étoffe
que le tuyau, & y eft foudé après que le bifeau
qui fépare le tuyau du pied a été foudé avec ce
dernier.
La lèvre inférieure de la bouche eft prife dans
le corps même du pied, que l’on applatit en dedans
pour les tuyaux qui ont la bouche en pointe;
pour ceux’ qui l’ont ovale, c’eft une pièce de la
forme d’un fegment de cercle que l’on retranche
du pied. La flèche de ce fe&eur a-,fig- 33 ■> eft le
quart de fa corde; la pièce retranchée d’un tuyau
fert pour un autre de moindre groffeur.
On obferve de donner aux tuyaux des montres
d’orgue, des longueurs & des groffeurs fymmé-
triques, enforte que les bouches des tuyaux Auvent,
des deux côtés d’une tourelle ou dans des
plates faces correfpondantès, des lignes également
inclinées à l’horizon. Cet arrangement donne plus
de grâce au fût d’orgue, que fi les bouches étoient
toutes fur une même ligné , ou qu’elles fuffent
difpofées irrégulièrement.
Bouche des Tuyaux.
La bouche , dans les tuyaux d’o rgue, eft l’ouverture
du tuyau par laquelle fort l’air qu’il contient.
On a ainfi appelé cette partie par analogie
à la bouche de l’homme, parce que c’eft par cette
ouverture que le tuyau parle : la largeur entre
les. deux* lèvres 3 & o , pi. X I , fig. 50 , Art?du
Luthier, tome 3 des gravures, doit être le quart de
leur' longueur b b, pour qu’elle parlé avec le plus
d’avantage qu’il eft polfible ; car, fi elle eft trop
ouverte, le tuyau ne parle przfque pas : & fi elle
l’eft trop peu , le tuyau ne fait entendre qu’un
fifleinçut défagréable.
La bouche ovale eit une forte de hpuche des
tuyaux d’orgue, laquelle eft arrondie par le haut
comme la pl. X I I , fig. 31, le repréfente.
Pour trouver le trait de cette bouche, foit d ,b ,
fig. 33, n°. 2,. fa largeur : il- faut divifer cette largeur
en deux au point 3 , élever perpendiculairement
la ligne 3 e, fur laquelle on prendra 3 f i
égale à d , b : du point ƒ comme centre, 8c d’un
rayon moitié de d, b, on décrira la demi-circonférence
e , qui , avec les deux perpendiculaires
aux points d & b , terminera la figure de la bouche
ovale.
Bouche en pointe3 c’eft ainfi que I on nomme .la.
bouche des tuyaux d’orgue, dont la lèvre fupé-
rieure, pl. X I I , fig, 33, n . 2, eft faite en triangle
ifocèle a b c. b c , eft la largeur de la bouche, c 2 ,
une fois & demie cette largeur qui eft la hauteur
de la bouche $ que l’on forme en tirant les deux
lignes égales a c & a b.
Tubes.
Les tubes, dans les grands tuyaux d’anches des
orgues , font des tuyaux de même forme & étoffe
que le tuyau à la partie inférieure defquels font
foudées , la noix , & la bague ; & comme fi le tuyau
d’anche ne devoit'- pas avoir plus de longueur ,
on place le corps du tuyau dans la table dans laquelle
, à caufe de la forme conique de ces deux
pièces, il s’ajufte exaftemeut, enforte que le vent
qui vient par l’anche dans la table paffe dans le
corps du tuyau, comme s’il étoit d’une feule ptece.
Voyez la pl. X I I I , fig. 53, qui repréfente un tube
coupé par la-moitié par un plan qui paffe par fon axe.
Boîtes des Tuyaux.
Les- boîtes , dans les orgues , font des tuyaux
d’étoffe. On appelle étoffe, un mélange de deux
parties de plomb & d’une d’étain, de forme cylindrique
A , pl. XIII , fig. 44, terminées par en bas
par un pied de forme conique, par le fommet
duquel le vent du fommier paffe de la boîte ,
dans le corps de la trompette ou autre jeu d’anche
, dont la partie inférieure entre dans la boîte,
ainfi nommée de fon ufage.
Bagues,
On appelle ainfi, dans les jeuxd’anche de l’orgue,
une frette ou anneau de plomb D , pl. XIII,fig. 4 4 7
A n du Luthier, tome 3 des gravures.
Cet anneau eft foudé fur le corps du tuyau.
La bague a un trou pour paffer la rofette a b ,
au moyen de laquelle on accorde les jeux d’anches?
Lorfque le tuyau eft placé dans* la boite A B ,
la bague D doit porter fur la partie fupérieure de
cette boîte dans laquelle elle entre en partie, &
doit y être ajuftèe de façon que l’air contenu dans
cette boîte , ne puiffe trouver d’iffue pour fortir
que par l’anche du tuyau.
Cheminée.
La cheminée eft dans les orgues un petit tuyau
de plomb ouvert par les deux bouts , foudé fur
la plaque qui ferme un autre tuyau. Voyez la
pl. X II, fig, 32, Art du Luthier, tome 3 des gravures.
C ’eft un tuyau à cheminée complet. 4 , la
plaque percée foudée à fa partie fupérieure. 2,,
la cheminée qui doit être foudée fur l’ouverture
de la plaqué.
Tous les tuyaux à cheminée doivent avoir des
oreilles aux deux côtés de leur, bouche T pour les
pouvoir accorder.
La Plaqué.
Le tourniquet fert à accorder les tuyaux, où on
en met en l’avançant pour les faire baiffer de
ton , ou en le retiraut pour le faire hauffer, s’il
fe trquve trop bas. Vcye^ la fig. 51’3 qui repréfente
un tuyau fur lequel eft placé un tourniquet a.
Des Accordoirs*
Les Accordoirs ou ces inftumens qui fervent aux
faéleurs d’orgue, pour accorder les tuyaux d’étain
& de plomb de l’efpèce des tuyaux de mutation,
font des cônes de cuivre creux , repréfentés
pl. X I I I , fig. 49-
Les premiers A B C , fervent pour les plus gros
tuyaux ; & les féconds abc , qui ont une poignée,
fervent pour les moindres.
On élargit l’ouverture des. tuyaux en faifant
entrer la pointe du cône dedans, jufqu’à ce que
le tuyau* loit baiffé au ton convenable ; Iorfqu’au
contraire le tuyau fe trouve trop bas , on ie fait
monter en le coiffant du cône concave pour ref-
ferrer l ’ouverture.
La Plaque, dans les orgues , eft un morceau de
plomb de forme ronde, que l’on fonde fur certains
tuyaux pour les boucher, & leur faire rendre ainfi
un fon plus grave d’une oftave, que celui qu’ils
rendroiënt s’ils étoient ouverts ,: voye^ la pl. X I I ,'
B , fig. 32, qui repréfente un tuyau des tailles du
bourdon bouché à rafe. 3 , eft la plaque à fouder
fur le tuyau. 4 , une autre plaque percée pour le
tuyau à cheminée C : on commence par fouder la
cheminée 2 à la plaque , & l’on foude enfuite celle-
ci au tuyau.
Le Coin. '■
Le coin , dans la fa&ure- des orgues, eft un petit
morceau de bois de forme conique , tronqué &
coupé en deux par un plan qui paffe par l’axe ,
dont on fe fert pour boucher le trou que l’anche
& la languette des jeux d’anches laiffent dans la noix.
Voye^ D , pl. X I I I , fig. 53 , Art du Luthier.
Ce coin doit entrer dans la noix A , après que
l’anche C & fa languette B , y font placées.
La face plate du coin tournée vers la languette,
on le chaffe à force pour qu’il affermifîè l’anche
& fa languette dans la noix, & qu’il achève de
boucher entièrement fon, ouverture.
Le Tourniquet.
Le tourniquet, dans les orgues , eft un morceau
de bois de forme carrée A , pl. X I I I , fig. 32, Art
du Luthier , tome 3 des■ gravures , fixé par une
cheville par un de fes angles, à un des angles de
l’ouverture fupérieure du tuyau, repréfentée par
le reftangle B C D E , qui fait voir en même temps
comment les quatre planches du tuyau de bois font
affemblées à rainures & languettes,
Diapafon des Fa fleurs d’Orgue.
Le Diapajçn dont les fa&eurs fe fervent pour
trouver les longueur & largeur des tuyaux d’orgue,
eft line figure triangulaire, pl. X I , fig. 29 , Arî
du Luthier, tome 3 des gravures, dont le côte O ,
V I I I , eft égal à la longueur du plus grand tuyau
du jeu dont on veut trouver les proportions , 8c
qui, dans la figure, eft le bourdon de 8 pieds bouché
, formant le 16.
La ligne V I I I , I I I , eft le périmètre du tuyau,
ou la circonférence, lorfque les tuyaux font cylindriques.
La longueur & la largeur du plus grand tuyau
d’un jeu étant données, il faut trouver la longueur1
& la largeur de tous les autres qui doivent être
femblables; pour cela fur les:lignes O , V I I I &.
V I I I , - I I I , qui font enfemble un angle I I I ,
V I I I , O , reétangle en V I I I , on trace un diapafon
en cette manière. On divife la ligne O ,
V I I I , en deux parties égales, & on élève la perpendiculaire
u t , dont la longueur eft déterminée
au points ut, par la rencontre de la ligne I I I , O ,
qui eft l’hypothenufe du triangle O , V I I I , I I I ,
auquel eft femblable le triangle O , ut, ut, dont
les côtés O , u t, & ut, u t, homologues à ceux
du grand triangle qui comprennent l’angle droit,
font le côté O , ut, la longueur 8c le côté ut, ut,
la largeur du tuyau ut, qui formera l’oftave au
deffus du premier tuyau , dont la longueur O ,
V I I I , & la largeur V I I I , I I I , avoient été
données, & qui doit toujours être un ut.
Pour trouver les autres intervalles intermédiaires
, il y a différens moyens que nous allons
faire connoître fuccintement.
Premièrement , il faut connoître les rapports
des fons que l’on y eut faire rendre aux tuyaux.