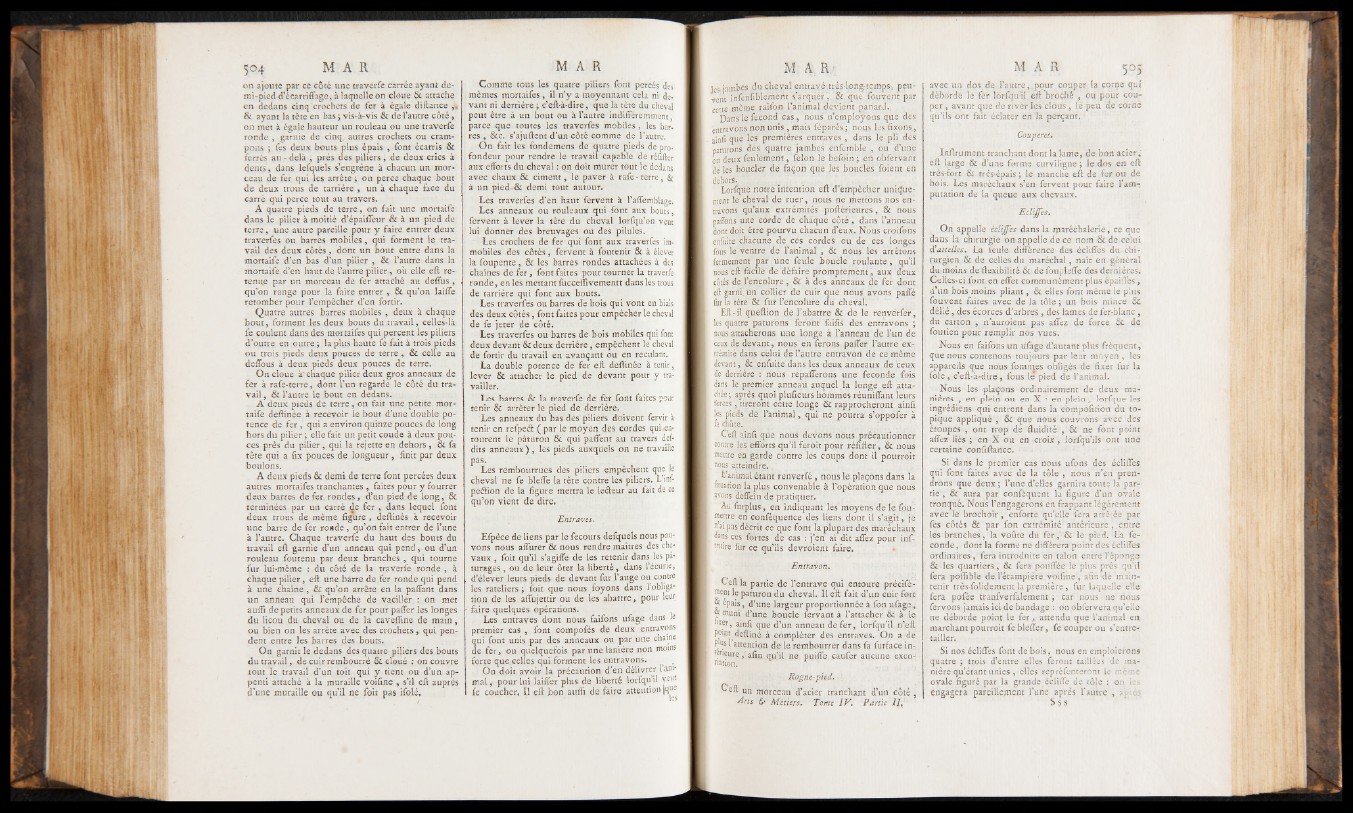
504 M A R
on ajoute par ce côté une traverfe carrée ayant demi
pied d’écarriffage, à laquelle on cloue & attache
en dedans cinq crochets de fer à égale diftance ,
& ayant la tête en bas ; v is-à-vis & de l’autre c ô t é , !
on met à égale hauteur un rouleau ou une traverfe
ronde , garnie de cinq, autres crochets ou cram- j
pons ; fes deux bouts plus épais , font écarris &
ferrés au - delà , près des piliers , de deux crics à
dents, dans lefquels s’engrène à chacun un morceau
de fer qui les arrête ; on perce chaque bout
de deux trous de tarrière , un à chaque face du
carré qui perce tout au travers.
A quatre pieds de te r re , on fait une mortaife
dans le pilier à moitié d’épaiffeur & à un pied de
te r re , une autre pareille pour y faire entrer deux
traverfes ou barres mobiles, qui forment le travail
des deux cô té s , dont un bout entre dans la
mortaife d’en bas d’un pilier , & l’autre dans la
mortaife d’ en haut de l’autre p ilie r, où elle eft retenue
par un morceau de fer attaché au deflùs ,
qu’on range pour la faire entrer , & qu’on laiffe
retomber pour l’empêcher d’en fortir.
Quatre autres barres mobiles , deux à chaque
b o u t , forment les deux bouts du tra v a il, celles-là
fe coulent dans des mortaifes qui percent les piliers
d ’outre en outre ; la plus haute fe fait à trois pieds
ou trois pieds deux pouces de terre , & celle au
deffous à deux pieds deux pouces de terre.
O n cloue à* chaque pilier deux gros anneaux de
fer à rafe-terre, dont l’un regarde le côté du travail
, & l’autre le bout en dedans.
A deux pieds de te r re , on fait une petite mortaife
deftinée à recevoir le bout d’une double potence
de f e r , qui a environ quinze pouces de long
hors du pilier ; elle fait un petit coude à deux pouces
près du p ilie r, qui la rejette en dehors , & fa
tête qui a fix pouces de longueu r, finit par deux
boulons.
A deux pieds & demi de terre font percées deux
autres mortaifes tranchantes , faites pour y fourrer
deux barres de fer, rondes, d’un pied de lo n g , &
terminées par un carré .de fer , dans lequel font
deux trous de même fig u re , deftinés à recevoir
une barre de fer ro n d e , qu’on fait entrer de l’une
à l’autre. Chaque traverfe du haut des bouts du
travail eft garnie d’un anneau qui pen d, ou d’un
rouleau foutenu par deux branches , qui tourne
fur lui-même : du côté de la traverfe ronde , à
chaque p ilie r, eft une barre de fer ronde qui pend
à une ch a în e , & qu’on arrête en la paffant dans
un anneau qui l’empêche de vaciller : on met
auifi de petits anneaux de fer pour paffer les longes
du licou du cheval ou de la caveftine de m a in ,
ou bien on les arrête avec des crochets, qui pendent
entre les barres des bouts.
O n garnit le dedans des quatre piliers des bouts
du tra v a il, de cuir rembourré & cloué : on couvre
tout le travail d’un toît qui y tient ou d’un ap-
penti attaché à la muraille voifine , s’il eft auprès
d’une muraille ou qu’il ne foit pas ifolé.
M A R
Comme tous les quatre piliers font percés des
mêmes mortaifes , il n’y a moyennant cela ni devant
ni derrière ; c’ eft-à-dire, que la tête du cheval
peut être à un bout ou à l’autre indifféremment,
parce que toutes les traverfes mobiles, les barres
, & c . s’ajuftent d’un côté comme de l’autre.
O n fait les fondemens de quatre pieds de profondeur
pour rendre le travail capable de réfifter
aux efforts du cheval : on doit murer tout le dedans
avec chaux & c im en t, le paver à rafe - terre, &
à un pied & demi tout autour.
Les traverfes d’en haut fervent à l’ affemblage.
Les anneaux ou rouleaux qui font aux bouts,
fervent à lever la tête du cheval lorfqu’on veut
lui donner des breuvages ou des pilules.
Les crochets de fer qui font aux traverfes immobiles
des c ô té s , fervent à foutenir & à élever
la fou pente, & les barres rondes attachées à des
chaînes de f e r , font faites pour tourner la traverfe
ronde, en les mettant fucceflivementt dans les trous
de tarrière qui font aux bouts.
Les traverfes ou barres de bois qui vont en biais
des deux c ô té s , font faites pour empêcher le cheval
de fe jeter de côté.
Les traverfes ou barres de bois mobiles qui font
deux devant & deux derrière, empêchent le cheval
de fortir du travail en avançant ou en reculant.
La double potence de fer eft deftinée à tenir,
lever & attacher le pied de devant pour y travailler.
Les barres & la traverfe de fer font faites pour
tenir & arrêter le pied de derrière.
Les anneaux du bas des piliers doivent fervir à
tenir en refpeét, ( par le moyen des cordes qui -entourent
le paturon & qui paffent au travers clef-
dits anneaux ) , les pieds auxquels on ne travaille
pas.
Les rembourrues des piliers empêchent que le
cheval ne fe bleffe la tête contre les piliers. L’inf-
peétion de la figure mettra le le&eur au fait de ce
qu’on vient de dire.
Entraves.
Efpèce de liens par le fecours defquels nous pouvons
nous affurer & nous rendre maîtres des chevaux
, foit qu’il s’agiffe de les retenir dans les pâturages
, ou de leur ôter la lib erté, dans l’écurie,
d’élever leurs pieds de devant fur l’auge ou contre
les râteliers ; foit que nous foyons dans l’obligation
de les affujettir ou de les abattre, pour leur
faire quelques opérations.
Les entraves dont nous faifons ufage dans le
premier cas , font compofés de deux entravons
qui font unis par des anneaux ou par une chaîne
de fe r , ou quelquefois par une lanière non moins
forte que celles qui forment les entravons. ) .
O n doit avoir la précaution d’en délivrer 1 animal
, pour lui laiffer plus de liberté lorfqu’il yeu£
fe coucher. Il eft bon aulfi de faire attention |que
les
M; A R R
je s jambes du cheval en tra v é très-long'tempS', p e u vent
infenftblémerit s’arquer , &. que foùvént par
cette même raifon l’anim al devient panard.
Dans le fécond c a s , nous n’employons que des
entravons non unis , mais féparés; nous les fixons ,
âinfi que les premières entraves , dans le pli dès
paturons des quatre jambes enfemble , ou d’une
ou deux feulement, félon le befoiri ; en obférvant
de les boucler de façon que les boucles foient en
dehors.. '
Lorfque notre intention eft d’empêcher uniquement
le cheval de ru e r , nous ne mettons nos entravons
qu’aux extrémités poftérieures, & nous
paflons une corde de chaque c ô té , dans l’anneau
dont doit être pourvu chacun d’eux. Nous croifons
enfuite chacune de ces cordes ou de ces longes
fous le ventre de l’animal , & nous, lès arrêtons
fermement par une feule boucle roulante, qu’il
nous eft facile de défaire promptement, a u x deux
côtés de l’encolure, & à des anneaux de fer dont
eft garni, un collier de cuir que nous avons pa ffé
fur la tête & fur l’encolure du cheval.
Eft-il queftion de l’abattre & de le renvérfer,
les quatre paturons feront faifis des entravons ;
nous attacherons une longe à l’anneau de l’un de
ceux de devant, nous en ferons paffer l’autre e x trémité
dans celui de l’autre entr&von de ce même
devant, & enfuite dans lès deux anneaux de ceux
de derrière : nous repafferons une fécondé fois
dans le premier anneau auquel la longe eft atta-
, chée; après quoi plufieurs hommes réunifiant leurs
forces, tireront cette longe & rapprocheront ainfi
j les pieds dé l’animal, qui ne pourra s’oppofer à
fa chute., ' • • ' , \ ..T-' '[]'
C’eft ainfi que nous devons nous précautionner
contre les efforts qu’ il feroit pour ré fifte r, & nous
| mettre en garde contre les coups dont il pourroit
1 nous atteindre.
L’animàl étant renverfé , nous le plaçons dans la
foliation la plus convenable à l’opération que nous
avons deffein de pratiquer.
Au furplus, en indiquant les moyens de le fou -
mettre en conféquence des liens dont il s’a g it , je
n ai pas décrit ce que font la plupart des maréchaux
dans ces fortes de cas : j’en ai dit affez pour inf-
[ truire fur ce qu’ils devraient faire.
Entravôn.
C’eft la partie de l’entrave qui entoure préçifé-
nient le paturon du cheval. Il e ft fait d’un cuir fort
•p ePais , d’une largeur proportionnée à fon u fag e,
«muni d’une boucle fervant à l’attacher & à" le;
, r j ainfi que d’un anneau de f e r , lorfqu’il n’eft
point deftiné à compléter des entraves. On a dé
pms 1 attention de le rembourrer dans fa furface in-
terieure ƒ afin qu’il ne puiffe caufer aucune exconation.
:
Rogne-pied.
£ eft un morceau d’acier tranchant d’un côté ,
<drts & Métiers. Tome ÏV. Partie II,
M A 5°î
avec un dos de l’autre, pour couper la corne qui
débordé le fer lorfqu’il eft broché , ou pour couper
, ayant que de river les clous , le peu dé corne
qu’ils ont fait éclater en la perçant.
Couperet,
Infiniment tranchant dont la lame, de bon acier,’
eft large & d’une forme curviligne ; le dos en eft
très-fort & très-épais ; le manche eft de fer ou de
bois. Les maréchaux s’en fervent pour faire l’amputation
de la queue aux chevaux.
Eclijfes.
On appelle èclijfes dans la maréchalerie, ce que
dans la chirurgie On appelle de ce nom & de celui
$ attelles. La feule différence des édifies du ch irurgien
& de celles du maréchal, naît en général
du moins de flexibilité & de foupleffe des dernières.
Celles-ci font en effet communément plus épaiffes,
d’un bois moins p lian t, & elles font même le plus
fouvent faites avec de la tô le ; un bois mince &
d é lié , des écorces d’arbres , des lames de fer-blanc ,
du carton , n’auraient pas affez de force &. de
fou tien pour remplir nos vues.
Nous en faifons un ufage d’autant plus fréquent,
que nous contenons toujours par leur moyen , les
appareils que nous fouîmes obligés de fixer fur la
fo ie , c’eft-à-diré , fous le pied de l’animal.
Nous les plaçons ordinairement de deux manières
, en plein ou en X : en p le in , lorfque les
ingrédiens qui entrent dans la compofition du topique
appliqué ,r & que nous couvrons avec des
étoupes , ont trop de fluidité , & ne font point
affez liés ; en X ou en c ro ix , lorfqu’ils ont une
certaine confiftarice.
Si dans le premier cas nous ufons des édifies
qùi font faites avec de la tôle , nous n’en prendrons
que deux ; l’une d’elles garnira toute la partie
, & aura par conféquent la figure d’un ovale
tronqué. Nous l’engagerons en frappant légèrement
avec lé brochoir , enforte qu’elle fera arrêtée par
fes côtés & par fon extrémité antérieure ,. entre
les branches , la voûte du f e r , & le pied. La fécondé
, dont la forme ne différera point des édifies
ordinaires, fera introduite en talon entre l’éponge
& les quartiers, & fera pouffée le plus près qu’il
fera pofiible de: l’étampière v o ifin e , afin dé maintenir
très-folidement la première, fur laquelle'elle
fera pofée tranfverfalement ; car nous ne nous
fervons jamais ici de bandage : on obfervera qu’elle
ne déborde point le f e r , attendu que l’animal en
marchant pourroit fe b léffer, fe couper ou s’entretailler.
Si nos édifies font de b ois, nous en emploierons
quatre ; trais d’entre elles feront taillées de manière
qu’étant unies , elles repréfenteront le inè
oyale figuré par la grande éd ifie de tôle : on les
engagera pareillement l’une après l’autre , apràs
S s s