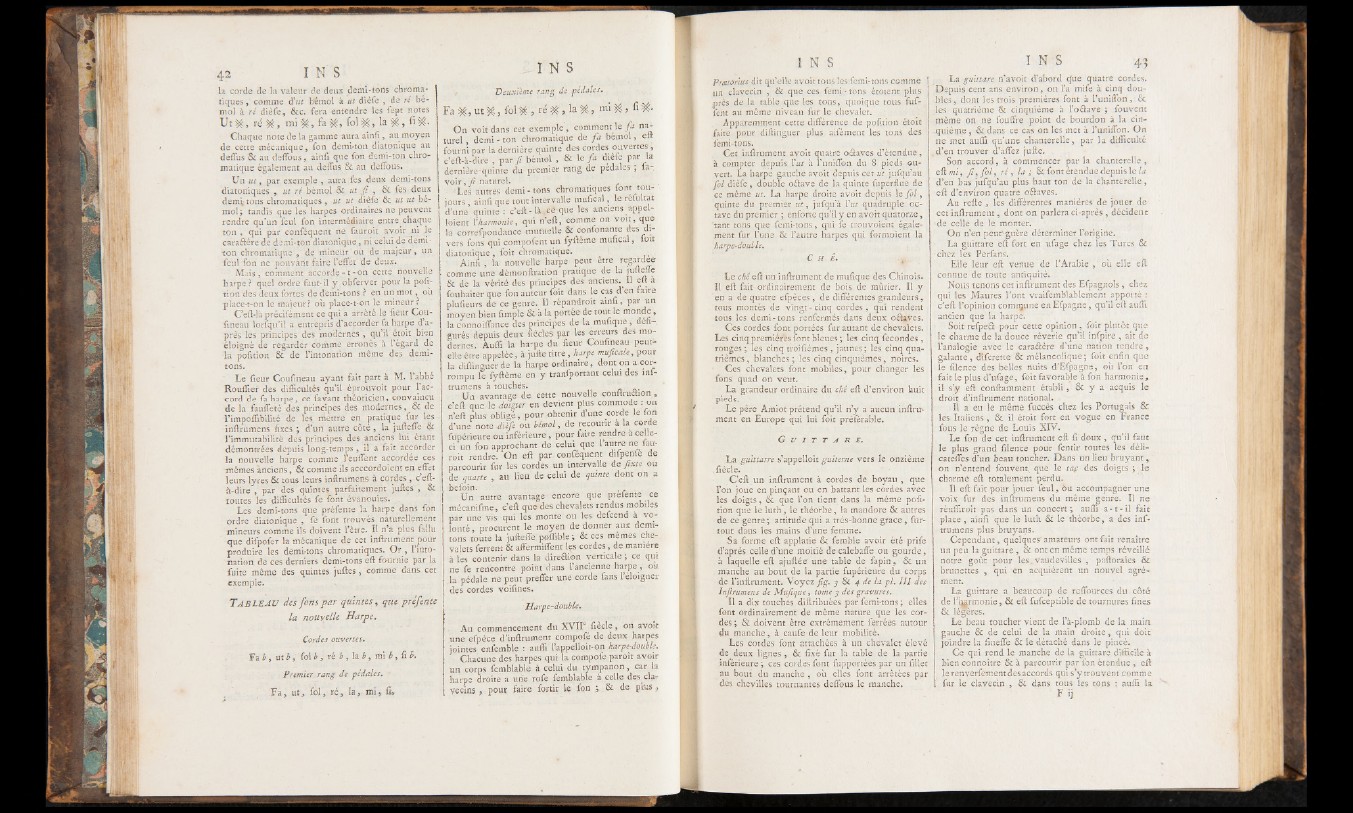
la corde de la valeur de deux demi* tons chromatiques
, comme dfut bémol à ut dièfe , de re bémol
à ré dièfe, &c. fera entendre les fept notes
U t ^ , ré % , mi ^ , fa fol % , la % , fi
Chaque note de la gamme aura ainfi, au moyen
de cette mécanique, fon demi-ton diatonique au
deffus & au deffous, ainfi que fon demi-ton chromatique
également au deffus & au deffous.
Un u t, par exemple , aura fes deux demi-tons
diatoniques , ut ré bémol & ut f i , 8c fes deux
demi- tons chromatiques, ut ut dièfe & ut ut bémol
; tandis que les harpes ordinaires ne peuvent
rendre qu’un feul fon intermédiaire entre chaque
ton , qui par conféquent ne fauroit avoir ni le
caraôère de demi-ton diatonique, ni celui de demi-
ton chromatique , de mineur où de majeur, un
feul fon ne pouvant faire l’effet de deux. , ;
Mais, comment accorde-t-on cette nouvelle
harpe? quel ordre faut-il y obferver pour la pofi-
tion des deux fortes de demi-tons ? en un mot, où
place-t-on le majeur? où place-t-on le'mineur?
C’eft-là précifément ce qui a arrêté le fieur Cou-
fineau lorfqu’ii a entrepris d’accorder fa harpe d a-
près lès principes des modernes , qu’il étoit bien
éloigné de regarder comme erronés à l’egard de
la pofition & de l’intonation même des demi-
tons.
Le fleur Coufineau ayant fait part à M. l’abbe.
Rouffier des difficultés qu’il éprouvoit pour 1 accord
de fa harpe, ce favant théoricien, convaincu
de la fauffeté des principes des modernes, 8c de
l ’impoflibilité de les, mettre en pratique fur les -
inftrùmens fixes ; d’un autre côté, la jufteffe &
l’immutabilité des principes des anciens lui étant
démontrées depuis long-temps , il a fait accorder
la nouvelle harpe comme l’euffent accordée ces
mêmes anciens, 8c comme ils acccordoient en effet
leurs lyres & tous leurs inftrùmens à cordes , c eft-
à-dire , par des quintes parfaitement juftes', &
toutes les difficultés fe font évanouies. .
Les demi-tons que préfente la harpe dans fon
ordre diatonique , fe font trouves naturellement
mineurs comme ils doivent l’être. Il n’a plus fallu
que difpofer la mécanique de cet infiniment pour
produire les demirtons chromatiques. Or , l’intonation
de ces derniers demi-tons eft fournie par la
fuite même des quintes juftes, comme dans cet
exemple.
T a b l e a u des forts par quintes, que préfente
la nouvelle Harpe.
Cordes ouvertes.
Fa b , ut b , fol b , ré b , la b, mi b , fi b.
Premier rang de pédales. •
F a , u t, fo l, ré , la , m i, fi»
Deuxième rang de pédales.
F a * : ,u t* , fo l* , mi* ,
On voit dans cet exemple, comment le fit na-
turel, demi - ton chromatique de fa bémol, elt
fourni par la dernière quinte des cordes ouvertes,
c’eft-à-dire , par f i bémol , 8c le fa diefe par la
dernière-quinte du premier rang de pedales ; lavoir,
7? naturel. ‘ ' ’ '
Les autres demi - tons chromatiques font toujours
, ainfi que tout intervalle mufical, le refultat
d’une quinte : c’eft-là .cë que les anciens appel-
loient Y harmonie, qui n’eft, comme on vo it, que
la correfpondance mutuelle 8c confonante des divers
fons qui compofent un fyftême mufical, loit
diatonique, foit chromatique. ) ;
Ainfi , la nouvelle harpe peut être regardee
comme une démonftration pratique de la jufteffe
& de la vérité des principes des anciens.^ Il eft a
fouhaiter que fon auteur foit dans le cas d en faire
plufieurs de ce genre. Il répandroit ainfi,' par un
moyen bien fimple & à la portée de tout le monde ,
la connoiffance des principes de la mufique , défigurés
depuis deux fiècles par les erreurs des modernes.
Auffi la harpe du fieur Coufineau peut-
elle être appelée, à jufte titre, harpe muficale, pouf
la diftinguer de la harpe ordinaire, dont on a.cor-
rompu le fyftême en y tranfportant celui des inftrumens
à touchés. a et-
Un avantage de cette nouvelle conltruction ,
c’eft que le doigta en devient plus commode : on
n’eft plus obligé, pour obtenir d’une corde le fon
d’une note d'ùfe ou bémol, de recourir à la corde
fupèrieure ou inférieure , pour faire rendre à celle-
ci un fon approchant de celui que l ’autre ne fauroit
rendre. On eft par-conféquent difpenfè de
parcourir fur les cordes un intervalle de fixte ou
de quarte , au lieu de celui de quinte dont on a
befoin.
Un autre avantage encore que preiente ce
mécanifme, c’eft qùe>des chevalets rendus mobiles
par une vis qui les monte ou les defeend à vo lonté,
procurent le moyen de donner aux demi-
tons toute la jufteffe. poffible ; 8c ces mêmes chevalets
ferrent & affermiffent les cordes, de manière
à lés contenir dans la direftion verticale ; ce qui
ne fe rencontre point dans l’ancienne harpe , où
.la pédale ne peut preffer une corde fans l’éloigner
des cordes voifines.
Harpe-double.
Au commencement du XVIIe fiecle, 011 avok
une efpèce d’inftrument compofe de deux harpes
jointes enfemble : auffi l’appel loir-on karpe-doubk.
Chacune des harpes qui la compofe, paroît avoir
un corps femblable à celui du tympanon, car la
harpe droite a une rofe femblable à celle des clar
vecins, pour faire fortir le fon ; 8c de plus ?
Preetorius dit qu’elle avoit tous les-femi-tons comme
un clavecin , 8c que ces femi-tons étoient plus
près de la table que les tons, quoique tous fuf-
fent au même niveau fur le chevalet.
Apparemment cette différence de pofition étoit
faite pour diftinguer plus aifément les tons des
femi-tons.
Cet inftrument avoit quatre oâaves d’étendue,
à compter depuis Y ut à ï’uniffon du 8 pieds ouvert.
La harpe gauche avoit depuis cet ut jufqu’au
fo l dièfe, double oélave de la quinte fuperflue de
ce même ut. La harpe droite avoit depuis le f o l ,
quinte du premier u t, jufqu’à Y ut quadruple octave
du premier ; enforte qu’il y en avoit quatorze,
tant tons que femi-tons, qui fe trou voient égale-
ment fur l’une & l’autre harpes qui formoient la
harpe-double.
C H Ê.
Le chê eft un inftrument de mufique des Chinois.
Il eft fait ordinairement de bois de mûrier. Il y
en a de quatre efpèces , de différentes grandeurs,
tous montés de vingt-cinq cordes, qui rendent
tous.les. demirtons renfermés dans deux oétaves.
Ces cordes font portées fur autant de chevalets.
Les cinq premières font bleues ; les cinq fécondés ,
rouges; les cinq troifièmes, jaunes; les cinq quatrièmes,
blanches ; les cinq cinquièmes, noires.
Ces chevalets font mobiles, pour changer les
fons quad on veut.
La grandeur ordinaire du chê eft d’environ huit
pieds.
Le père Amiot prétend qu’il n’y a aucun inftrm-
ment en Europe qui lui foit préférable.
G U I T T A R E .
La guittarre s’appelloit guiterne vers le onzième
fiècle.
C’eft un inftrument à cordes de boyau, que
l’on joue en pinçant ou en battant les cordes avec
les doigts, 8c que l’on tient dans la même pofition
que le luth, le théorbe, la mandore & autres
de ce genre ; attitude qui a très-bonne grâce, fur-
tout dans les mains d’une femme.
Sa forme eft applatie & femble avoir été prife
d’après celle d’une moitié de çalebaffe ou gourde,
à laquelle eft ajuftée une table de fapin, 8c un
manche au bout de la partie fupèrieure du corps
de l’inftrument. Voyez fig. 3 8c 4 de la pl. 111 des
Infirumens de Mufique, tome 3 des gravures.
Il a dix touches diftribuées par femi-tons ; elles
font ordinairement de même nature que les cordes
; & doivent être extrêmement ferrées autour
du manche, à caufe de leur mobilité.
Les cordes font attachées à un chevalet élevé
de deux lignes , 8c fixé fur la table de la partie
inférieure ; ces cordes font fupportées par un fillet
au bout du manche , où elles font arrêtées par
des chevilles tournantes deffous le manche.
La guiitare n’avoit d’abord que quatre cordes.
Depuis cent ans environ, on l’a mife à cinq doublés,
dont les trois premières font à l’uniffon,: &
les quatrième 8c cinquième à l’oélave ; fouvent
même on ne fouffre point de bourdon à la cinquième
, & dans ce cas on les met à l’uniffon. On
ne met auffi qu’une chanterelle, par la difficulté
d’en trouver d’affez jufte.
Sotl accord, à commencer par la chanterelle ,
eft mi, f i , fo l, ré, la ; 8c font étendue depuis le la
d’en bas jufqu’au plus haut ton de la chanterelle,
eft d’environ quatre oélaves.
Au refte, les différentes manières de jouer .de
cet inftrument, dont on parlera ci-après , déciden t
de celle de le monter.
On n’en peut'guère déterminer l’origine.
La guittare eft fort en ufage chez les Turcs 8c
chez les Perfans. ~
Elle leur eft venue de l’Arabie , où elle eft
connue de toute antiquité. ..
Nous tenons cet inftrument des Efpagnols, chez
qui les Maures l’ont vraifembiablement apporté :
c’eft l’opinion commune en Efpagne, qu’il eft auffi
ancien que la harpe.
Soit refpeâ pour cette opinion , foit plutôt que
le charme de la douce rêverie qu’il infpire , ait de
l’analogie avec le caraéfère d’une nation tendre,
galante, dlfcrette & mélancolique ; foit enfin que
le filence des belles nuits d’Efpagne, où l’on en
fait le plus d’ufage, foit favorable à fon harmonie,
il s’,y eft conftamment établi, & y a acquis le
droit d’inftrument national.
. Il a eu le même fuccès chez les Portugais &
les Italiens, & il étoit fort en vogue en France
fous le règne de Louis XIV.
Le fon de cet inftrument eft fi doux , qu’il faut
le plus grand filence pour fentir toutes les déli-
cateffes d’un beau toucher. Dans un lieu bruyant,
on n’entend foüventv que le top des doigts ; le
charmé eft totalement perdu.
Il eft fait poùr jouer feul, ou accompagner une
voix fur des inftrùmens du même genre. Il ne
réuffiroit pas dans un concert ; auffi a - 1 - il fait
place , ainfi que le luth 8c le théorbe, a des inf*
trumens plus bruyans.
Cependant, quelques' amateurs ont fait renaître
un peu la guittare, 8c ont en même temps réveillé
notre goût pour les,vaudevilles , paftorales 8c
brunettes , qui en acquièrent un nouvel agrément.
La guittare a beaucoup de reffources du côté
de l’harmonie, 8c eft fufceptible de tournures fines
8c légères.
Le beau toucher vient de l’à-plomb de la main
gauche 8c de celui de la main droite, qui doit
joindre la fineffe 8c le détaché dans le pincé.
Ce qui rend le manche de la guittare difficile à
bien connoître 8c à parcourir par fon étendue , eft
le renverfement des accords qui s’y trouvent comme
fur le clavecin , 8c dans tous les tons ; auffi la
F ij