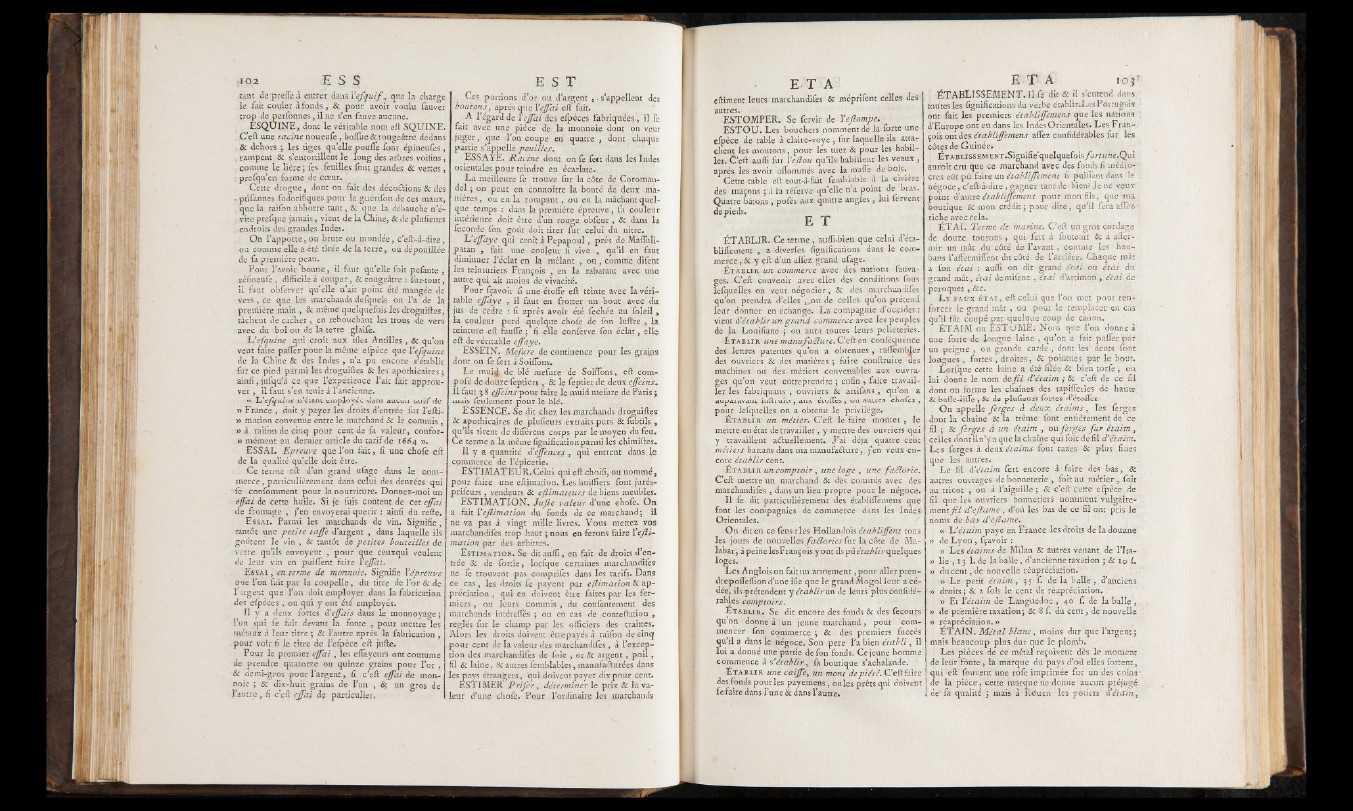
[ica E S S
tant depreffe à entrer dans Y e fq u if., que la charge
le fait couler à fonds, & pour avoir voulu fauver
trop de perfonnes, il ne s’en fauve aucune.
E SQ Û IN E , dont le véritable nom eft SQ UIN E .
. C ’eft une racine noueufe , boffue & rougeâtre dedans
& dehors ; les tiges qu’elle pouffe font épineufes,
; rampent & s’entortillent le ‘ long des arbres voifins,
comme le lière y fes feuilles {ont grandes & vertes ,
prefqu’en forme de coeur.
Cette drogue, dont on fait des décoctions & des
. ptifannes fudorifîques pour la guérifon de ces maux,
que la raifon abhorre tant, & que la débauche n’évite
p refaite jamais, vient de la Chine, & de plusieurs
endroits des grandes Indes.
On l’apporte, ou brute ou mondée, c’eft-à-dire,
ou comme elle a été tirée de la terre, o» dépouillée
de la première peau.
Pour l’avoir bonne, il faut qu’elle Toit pelante ,
réfineufe., difficile à couper, & rougeâtre : fur-tout,
il faut obferver qu’ elle n’ait point été mangée de
v e r s , ce que les marchands defquels on l’a de la
première main , & même quelquefois Jes droguiftes,
tâchent de cacher , en rebouchant les trous de vers
avec du bol ou de la terre glaifè.
Uefquine qui croît aux ifles Antilles , & qu’on
veut faire p.afïèr pour la même elpèce que Yefquine
de la Chine & des Indes , n’a pu encore s’établir
fur ee pied pàrmi les droguiftes & les apothicaires ;
ainfi, jufqu’i ce que l’expérience l’ait mit approuver
, il faut s’en tenir â l’ancienne.
« Uefquine n’étant employée dans aucun tarif de
» France , doit y payer les droits d’entrée fur l’efti-
» mation convenue entre le marchand 8c le commis,
» à raifon de cinq pour cent de fa valeur, confor-
» mément au dernier article du tarif de 1664 ».
ESSAI. Epreuve que l’on la it , fi une choie çft
de la qualité qu’elle doit être.
C e terme eft d’un grand ulàge dans le commerce
, particulièrement dans celui des denrées qui
•iè confomment pour la nourriture. Donnez-moi un
ejfai de cette huile. Si je luis content de cet ejfai
de fromage , j’en envoyerai quérir : ainfi du refte.
E s s a i . Parmi les marchands de vin. Signifie,
tantôt une p e tite tajfe d’argent , dans laquelle ils
goûtent le vin , & tantôt de p etites bouteilles de
verre qu’ils envoyent , pour que çeuxqui veulent
de leur vin en puiffent faire Y ejfai.
E s s a i , en.terme de monnoie. Signifie Y épreuve
que Ton fait par la coupelle, du titre dé l ’or & de
l ’argent que l’on doit employer dans la fabrication
des efpèces , ou qui y ont été employés.
Il y a deux fortes d’ejfais dans le monnoyage;
l ’un qui le fait devant la fonte , paur mettre les
métaux à leur titre ; & l’autre après la fabrication ,
- pour voir fi le titre de l’efoèce eft jufte.
Pour le premier ejfai. , les efîàyeur's ont coutume
de prendre quatorze ou quinze grains pour l’or ,
& demi-gros pour l’argent, fi . c’eft ejfai de monnoie
; & dix-huit grains dé l ’un , & gros de
l ’autre, fi c’eft ejfai de particulier,
E S T
Ces portions d’or ou d’argent s’appellent des
boutons, après que Y ejfai eft fait.
A l ’égard de Y ejfai des efpèces fabriquées., il fe
fait avec une pièce de la monnoie dont on veut
ju ger, que l ’on coupe eu quatre , dont chaque
partie s’appelle peuilles .
E S SA YE . R a ine dont on fe fèct dans les Indes
orientales pour teindre en écarlate.
L a meilleure fe trouve fur la côte , de Coromandel
; on peut en connoître la bonté de deux maniérés
, ou en la rompant , ou en la mâchant quelque
temps : dans la première épreuve, fa couleur
intérieure doit être d’un rouge obfçur, & dans la
fécondé fon goût doit tirer fur celui du nitre.
Uetfaye qui croît 4 Pepapoul, près de Mafluli-
patan , fait une coujçur fi vive , qu’il en faut
diminuer l’éclat en la mêlant , o u , comme difent
les teinturiers François , en la rabatant avec une
autre qui ait moins de vivacité.
Pour fçavoir fi une étoffe eft teinte avec la véritable
ejfaye , il faut en frotter' un bout avec du
jus de cedre : fi après avoir été fechée au foleil ,
la couleur perd quelque chofe de fon luftre , la
teinture eft faufïe ; fi elle conferve fon é c la t, elle
eft de véritable ejfaye.
ESSEIN. Mejure de continence pour les grains
dont 011 fe fert â Soiflons.
L e tatiïidb de blé njefure de Soiflons, eft com-.
pofé de douze feptiers , & le feptier de deux ejfeins. 11 faut 3 8 çjfeins pour faire le muid mefure de Paris 3
mais feulement pour le blé.
E S SEN C E . Se dit chez les marchands droguiftes
& apothicaires de plufieurs extraits purs & fubtils ,
qu’ils tirent de différens corps par le moyen du feu.
Ce terme a la même lignification parmi les chimiftes.
Il y a quantité d’ejfencej;, qui entrent dans. fe
commerce de l’épicerie.
E ST IM A T EU R .C e lu i qui eft choifi, ou nommé,
pour faire une eftimation. Les huiffiers font jurés-
prifeurs, vendeurs & e(limâteurs de biens meubles.
E S T IM A T IO N . Jujle valeur d’une chofe. Ôn
a fait Yejlimation du fonds de ce marchand j il
ne va pas â vingt mille livres. Vous mettez vos
marchandifes trop haut ; nous en ferons faire Yejlimation
par des arbitres.
E s t im a t io n . Se ditauffi, en fait de droits d’ entrée
8c. de fortie, lorfque certaines marchandifes
ne fe trouvent pas comprifes dans les tarifs. Dans
ce cas 3 les droits fe payent par eftimation 8c appréciation
, qui en doivent être faites par les fermiers
, ou leurs commis, du confèntement des
marchands intérefles ; ou en cas de conteftation ,
réglés fur le champ par les officiers des traittes.
Alors les droits doivent être payés à raifon de cinq
pour cent de la valeur des marchandifes , à l’exception
des marchandifes de foie , or & argent, p o i l ,
fil & laine, & autres femblables, manufacturées dans
les pays étrangers,, qui doivent payer dix pour cent.
ESTIMER P ri f e r , déterminer le prix & la valeur
d’upç chofe, Pour l’ordinaire les marchands
e t A
eftiment leurs marchandifes 8c méprifent celles des
autres.
•ESTOMPER. Se fervir de YeJlompe._
E S T O U . Les bouchers nomment de la forte une
elpèce de table à claire-voye, fur laquelle ils atca-r
chent les moutons, pour les tuer & pour les habiller.
C’eft auffi fur Yéflou qu’ils habillent les veaux ,
après, les avoir affommés avec la mafle de bois. *
Cette table eft tout-à-fait femblable a la civiere
des maçons ; â la réferve qu’elle n’a point de bras.
Quatre bâtons , pofés aux quatre angles, lui fervent
de pieds.
E T
É T A B L IR . Ce terme , auffi-bien que celui d’éta-
bliffement , a îdiverfes lignifications dans le commerce.,
8c y eft d’un allez grand ufage.
É t a b l ir un commerce avec des nations fauva-
ges. Ç’eft convenir avec elles des conditions fous
lefquelles on veut négocier, 8c des marchandifes
qu’on prendra d’elles ^ u de celles qu’on prétend
leur donner en échange. L a compagnie d’occident
vient Üétablir un grand commerce avec les peuples
de la Louifiane ; on aura toutes leurs pelleteries.
É t a b l ir une manufacture. C ’eft en conféquence
des lettres patentes qu%n a obtenues, raffembler
des ouvriers 8c des matières ; faire conftruire des
machines ou des métièrs convenables aux ouvrages
qu’on veut entreprendre ; enfin 3 faire travailler
les fabriquans , ouvriers & artifans, qu’on a
auparavant instruits, aux étoffes, ou autres ehofes ,
pour lefquelles on a obtenu le privilège.
É t a b l ir un métier. C ’eft le faire monter, le
mettre en état de travailler, y mettre des ouvriers qui
y travaillent actuellement. J’ai déjà quatre cent
métiers battans dans ma manufacture , j’en veux encore
établir cent.
É t a b l ir un comptoir, une loge , une fa c lo n é .
C’ eft mettre un marchand & dés commis avec des
marchandifes , dans un lieu propre pour le négoce.
Il fe dit particulièrement des établiffèmens que
font les compagnies de commerce dans les Indes
Orientales.
On dit en ce feus : les Hollandois établiffent tous
les jours de nouvelles fa d o rie s fur 1^ côte de Malabar,
à peine lesFrançois y ont ils pu établir quelques
loges.
X es Anglois on fait un armement, pour aller prendre
poffeffion d’une ifle que le grand Mogolleur a cédée,
ils-prétendent y établir un de leurs plus confidé-
rables comptoirs.
É t a b l ir . Se dit encore des fonds & des fecours
quon donne à un jeune marchand, pour commencer
fon commerce ; & des premiers fuccès
qu’il 3. dans le négoce. Son.pere l’a bièn établi , il
lui a donné une partie de fon fonds. Ce jeune homme
commence à s’ établir, fa boutique s’achalande.
É t a b l ir une caiffe, un mont de piété. C ’eft faire
des fonds pour les payemens, ouïes prêts qui doivent
fe faire dans Tune & dans l’autre.
E T A ftty)
É T A B L IS SEM E N T . I l i e dit & i l s’entend dans jj
toutes les lignifications du verbe établir.Les P or tu gais •
ont fait les premiers établijfemëns que les nations
d’Europe ont eu dans les Indes Orientales. Les François
ont des établijfemens affez confidérables fur les
côtes de Guinée.
ÉTABLisSEMENT.Signifie* quelquefois fortuhe.Qui
auro it cru qu e c e marchand av e c des-fonds fi médiô^ •
ères eût pu fa ire un établijfemefit ; fi pniffant dans le
n é g o c e , c ’eft-à-dire, g a gn e r tant de bien? J e né v eu x
po int d’autre ézabïijfement p o u r mon fils , qu e -m a
boutique & mon crédit : p ou r d ir e , qu’i l fera affez •
riche av e c c e la .
É T A ï . Terme de marine. C ’eft un gros cordage
de douze tourons , qui fert à foutenir 8c à affermir
un mât du côté de l ’avant, comme les haubans
l’affermiffent du côté de l’arrière. Chaque mât
a fon étai : auffi on dit grand é tai ou éta i du
grand mât, étai demifene , étai d’artimon , étai de
peroqu et, Sic. L e f a u x é t a i , eft c e lu i qu e l’on met p o u r ren fo
r c e r le grand mât , ou po u r le remplacer en cas
qu’i l fût cou p é pa r qu e lq u e cou p de canon.
É T A IM on E S TUM È . Nom que Ton donne à
une forte de longue laine , qu’ôn a fait pafïer par
un peigne , ou grande carde , dont les dénts font
longues, fortes , droites, & pointues par le bout.
Lorfque cette laine a été filée 8c bien torfe, on
lui donne le nom de f i l d ’étaim ; & c’eft de ce fil
dont on forme les chaînes des tapifféries de haute
& bafïe-liffe , & de plufieurs fortes d’étoffes.
On appelle ferge s à deux^étaims, les fergçs
dont la chaîne 8c la trême font entièrement dé ce
fil ; 8c ferge s à un étaim , ou ferge s fu r étaim ,
celles dont iln’y a que la chaîne qui foit de fil d’étaim.
Les ferges à deux étaims font razes & plus fines
que les autres.
L e fil â’étaim fert encore à faire des bas, &
autres ouvrages de bonneterie , foit au métier , fb.it
au tricot , ou â l’aiguille ; 8c c’eft cette elpèce de
fil que les ouvriers bonnetiers nomment vulgaire- ''
ment f i l d* ejlame , d’od les bas de ce fil ont pris le
noms de bas d ’ejlame. -
« U étaim paye en France les droits de la douane
» de Lyon , fçavoir :
» Ees étaims de Milan & autres venant de l’Ita-
» lie , 13 1. de la baille, d’ancienne taxation 5 & 10 f.
» du cent, de nouvelle réaprëciation.
» L e petit étaim., 35 f. de la balle , d’anciens
» droits; & z fols, le cent -de réaprëciation.
» Èt Y étaim de Languedoc, 40 f. de la balle , .
» de première taxation; 8c 8 f. du cent, de nouvelle
» réaprëciation. »
É T A IN . M é ta l blanc, moins dur que l ’argent;
mais beaucoup plus dur que le plomb.
Les pièces de ce métal reçoivent dès le moment
de leur fonte, la marque du pays d’oû elles fortent,
qui eft fouvent une rofe imprimée fur un des coins-
de la piè ce , cette marque ne donne aucun préjugé
I de fa qualité 5 mais à Rduen les potiers a étain ,