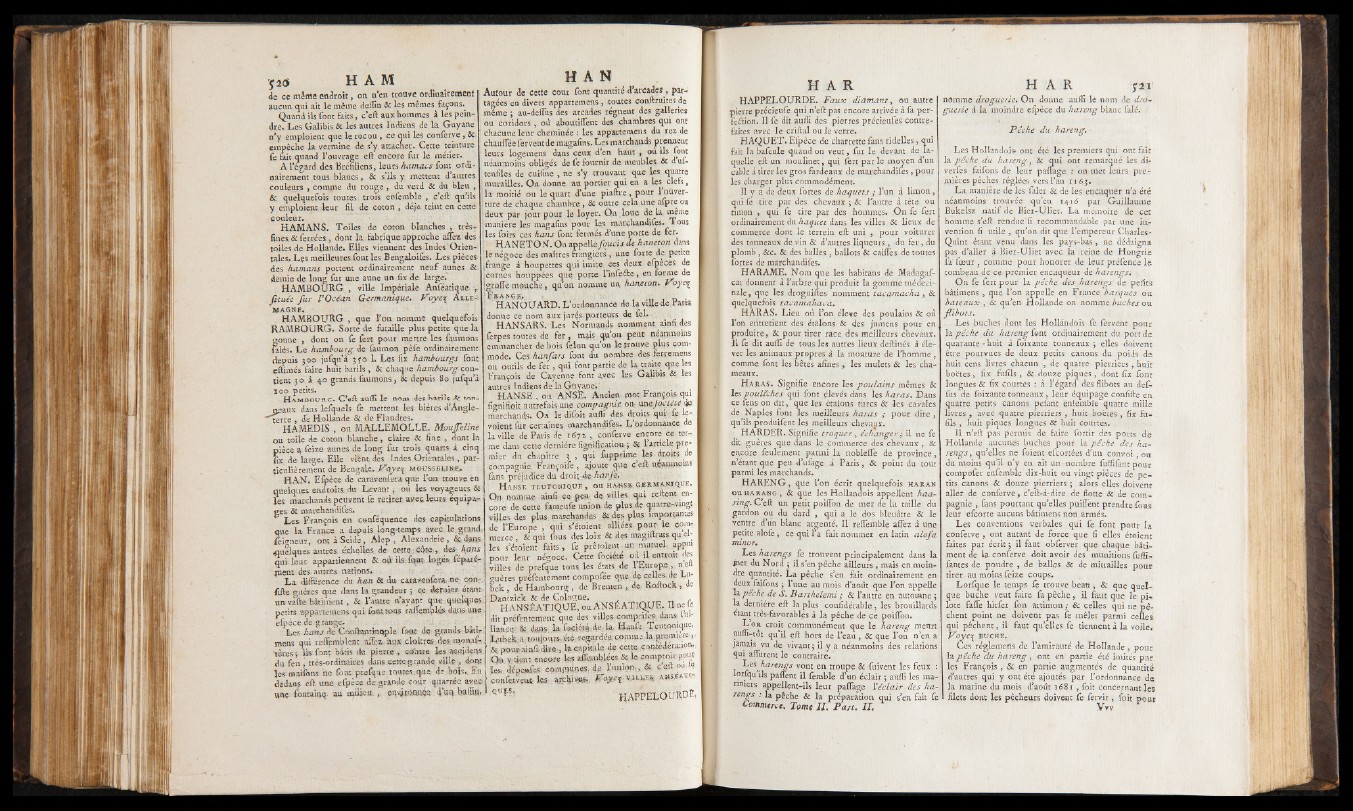
S2<s H A M
de ce même endroit, on n’en trouve ordinairement
aucun, qui ait le même deffin Sc les memcsfaçons.^
Quand ils font faits, c’eft aux hommes à les peindre.
Les GalibisL& les autres Indiens de la Guyane
n’y emploient que le rocou , ce qui les conferve , 8c
empêche la vermine de s’y attacher. Cette teinture
fe fait quand l'ouvrage eft encore fur le métier.
A l’egard des Bréhliens, leurshamac* font ordinairement
tous .blancs, Sc s’ils y mettent d’autres
couleurs , comme du rouge , du verd & du bleu ,
& quelquefois toutes trois enfemble , c’eft qu’ils
y emploient leur fil de coton , déjà, teint en cette
. couleur.
H AM AN S , Toiles de coton blanches.,, très-j-
fines, & ferrées, dont la fabrique approche affez des
toiles de Hollande. Elles viennent des Indes Orientales,
L ç s rueilleures.font les Bengaloifes. Les pièces
des hamans portent ordinairement neuf aunes &.
demie de long fur une aune un fîx de large.
H AM B O U R G , ville Impériale Anféatique ,-
Jîtue'e fu r r Océan Germanique. Voye^ A lle-j
m a g n e ,
H AM B O U R G , que l’on nomme quelquefois
R AM BQ U R G . Sorte de futaille plus petite que la
gonne , dont on fe ferç pour mettre- les faumons
{aies. L e Hambourg de faumon pèfe ordinairement,
depuis 500 jufqu’à 350 1. Les fîx hambourgs font
eftimés faire huit barils , & chaque Hambourg- contient
30 à 40 grands faumons, & depuis 80.jufqu’à
100 petits.
H a m b o u r g . C*eft auffi le nom dés barils & tonneaux
dans lefquels fe mettent, les bières d’Angleterre
j de Hollande 8c de Flandres.
HAMEDIS , ou M A L L EM O L L E . M&ujfeline
au toile de coton blanche, claire & fine , dont la
pièce U fèize aunes de long- fur trois quarts a cinq
fix de large. Elle vfênt des Indes Orientales , particulièrement
de Bengale. FQye% mousseline,.
H A N . Efpèce de caravenfera que l’a» trouve en
quelques endroits du Le van t, où k s voyageurs. 8c
les marchands peuvent fe retirer: avec leurs éq-uipar-
ges & marehandifes. - , . :
** L e * François en conféquence des capitulations
qviP la, France a. depuis long-temps avec,le:grand
feicmeur, ont à Seide, Alep , Alexandrie , Sfedans
quelques autres échelles, de cette: Coco;, des- Hans
qui. leur appartiennent & où' ils.font-,logési feparéj-
pient de?'autres nat|ons. u. . . np
L a différence du Han &-du> QWr
fifte guères que dans la grandeur j çe dernier- étant
un vafte‘bâtiment, Se l’autre n-ayant que ,quelques
petits appartement qui. tons raffembk8' dans-une
efpèce.de. grange. ' i . ;
à Les h ans. de Cônftantinciple font de "grands'; bâtir !
mens qui reffémblent. affé^ âpg-ckitrQS.des,
'tèresj i k fonç bâtis de. pie««* ,, contre
du feu ^ très-ordinaires willfc, dont
les mai fous ne font prefqù e rtautes. que de bols,. En
dôdaaf eftr une efpèce.de granik cour q.uarrée avec
une- fontainq- au milieu , d’Ùq bafTiq».
H A N
Autour de cette cour font quantité d’arcades > partagées
en divers appartemens , toutes conftruites de
même ; au-deffés des arcades régnent des galleries
ou coridors où aboucifTent des chambres qui ont
chacune leur cheminée : les appartemens du rez de
chauffée fervent de raagafins. Les marchands prennent
leurs logemens dans ceux d’en haut , ou ils font
J néanmoins obligés de fe fournir de meubles & d uf*
, tenfiles de cuifine , ne s’y trouvant que les quatre
! murailles. On donne au portier qui en a les^ clefs,
’ la moitié ou le quart d’une piaftre, pour loûver-
Iture de chaque chambre, & outre cela.une afpre ou
’deux par jour pour le loyer. O n ,lou e de la même
jmanière les magafîns pour les marehandifes. Tous
lies foirs ces Hans font fermés d’une porte de fer.
i H A N E T O N . On appelle foucU de haneton dans
'le négoce des maîtres rrangiers, une force de petite
jfrange à'houpettes qui imite ces deux efpeces de
jcornes houppées que porte l’infeéle, en forme de
Igrplfé mouche, quon nomme un haneton• Foye^
j H A N O U A R D . L ’ordonnance de la ville de Paris
donne ce nom a u x jurés-porteurs de fel. - ,
H AN SAR S. Les Normands nomment ajnfi des
ferpes toutes de f e r , m^is qu’on peut neanmoins
emmancher de bois félon qu’on le trouve plus commode.
Çes hanfars font du nombre des rer-remens
ou outils de fer , qui font partie de la-traite que les
François de Cayenne font avec les G alibis & les
autres Indiens de la G u y a n e , ,
H A N SE , où AN SE. Ancien mot Françpi* qui
fignifioit autrefois unp compagnie, ou; unefociete dC'
marchands. On le difoit auflf des. droits qup. fi*, le*
voient, fur. certaines marehandifes. L ’ordonnance de
la ville de Paris de 1671 , cortferve encore ce^ter*.
me dans cette dernière lignification.$ &£ 1 article pre*
mier du chapitre 3 , qui fùpprimie les droits de
compagnie Françoifé, ajoute que c’eft ué^mroins
fans préjudice du droi.t -de heinfù.
H a n s e t e u t o n i q u e , o u h ma s e . g e r m a n -ï q u e .
On nomme, ainfi- ce peu-, de villes, qui reftent encore
de cette fameufe union de plus.de quatre-vingt
vijlcs-des plus roa^hanefés & dçp plus importantes
de l'Europe , qui 's ’étoienc alliées pour- le c-ojf
merce, & qui fous des loix 8ç des magifkats qu el*
les s’étoient faits , fe prêtolent - un mutuel, agPlM
pour leur négoce, Cette fôpiété ou il entrait des
villes de prefque tous les états.-de l’Europe , n e,t
guères préfentement compofée que dp celles, de Lu*
b e k , de Hambourg, de Bremen , de- Roftock , “e
Dantzick & de Cologne. r
1 H A N S É A T IQ U E , ou A N S É A T IQ U E . I l ne Ce
Idit préfentement que des vill.es comp.i'ifeS's dans lai
liante.. Se dans-; kifoçiétérde- la, HaaCe.-
a-toujours, étérr-e^rdép, commc.-la^rnm^re^;
pouc- aiaÆdl^é , la capitale de cette canféderation.
Qn.y:tient: encore aflômblées.& le comptoir'Hf^
les*, dépegjfesi cumjnHUesi de: l’union:, & c eft pu. %
conlprvenfe lfefc ^-kïiv^î. ri •
UAPPEliOURiDE.
H A R
H A PPELO URD E . F a u x d iam an t , ou autre
pierre précieufe qui n’eft pas encore arrivée à fa perfection.
Il fe dit aufii des pierres précieufes contrefaites
avec le criftal ou le verre.
H A Q U E T . Efpèce de charrette fans ridelles, qui
fait la bafcule quand on veu t, fur le devant de laquelle
eft un moulinet, qui fert par le moyen d’un
cable à tirer les gros fardeaux de marehandifes, pour
les charger plus commodément.
Il y a de deux fortes de haquets ; l’un â limon,
qui fe tire par des chevaux j 8c l’autre à tète ou
timon , qui fe tire par des hommes. On fe fert
ordinairement du haquet dans les villes & lieux de
commerce dont le terrein eft uni , pour voiturer
des tonneaux de vin & d’autres liqueurs , du fe r , du
plomb, Sec. Se des balles , ballots & caiffés de toutes
fortes de marehandifes.
HARAME. Nom que les habitans de Madagaf-
car donnent à l’arbre qui produit la gomme médeci-
nale, que les droguiftes nomment tacamacha, &
quelquefois tacamahaca.
HARAS. Lieu où l’on éleve des poulains & où.
l’on entretient des étalons & des jumens pour en;
produire, & pour cirer race, des meilleurs chevaux.
Il fe dit aufii de tous les autres lieux deftinés à élever
les animaux propres à la mouture de l’homme ,
comme font les bêtes afînes , les mulets & les chameaux.
H a r a s . Signifie encore les p oulain s mêmes &
les poulfches qui font élevés dans les haras. Dans
ce lens on dit, .que les étalons turcs & -les cavales
de Naples font les meilleurs haras ; pour dire ,
qu’ils produifent les meilleurs chevaux.
HARDER. Signifie troquer, échanger il ne fe I
dit guères que dans le commerce des chevaux, &
encore feulement parmi la nobleffé de province,
n’étant que peu d’ufage à Paris , & point du tout
parmi les marchands.
H A R E N G , que l’on écrit quelquefois haran
o u h a r a n g , & que les Hollanaois appellent haa-
ring. C’eft un petit poifïon de mer de la taille du
gardon ou du dard , qui a le dos bleuâtre & le
ventre d’un blanc argenté. I l reffémble allez â une
petite alofè, ce qui 1 a fait nommer en latin alofa
minor.
Les harengs fe trouvent principalement dans la
mer du Nord $ il s’en pêche ailleurs, mais en moindre
quantité. L a pêche s’en fait ordinairement en
deux faifons j l’une au mois d’août que l’on appelle
la peche de S . Barthelemi ; & l’autre en automne j
la dernière eft la plus confîdérable. les brouillards
étant tres-favorables â la pêche de cé. poifïon.
L on croit communément que le hareng meurt
aufli-tôt qu il eft hors de l ’eau , & que l’on n’en a
jamais vu de vivant j il y a néanmoins des relations
qui afférent le contraire.
Les^ harengs vont en troupe & fuivent les feux :
lorfqu ils panent il femble d’un éclair j auffi les mariniers
appellent-ils leur paffége Yéclair des harengs
: la pêche & la préparation qui s’en fait fe
Commerce, Terne U . P a r t . IJ .
H A R p 1
nomme droguerie. On donne auffi le nom de droguerie
à la moindre efpèce du hareng blanc falé.
Pê che du hareng. •
Les Hollandois« ont été les premiers qui ont fait
la pêche du hareng, & qui ont remarqué les di-
verfes faifons de leur paflage : 011 met leurs premières
pêches réglées vers l’ail 1163.
L a manière de les faler. & dé les encaqiier n’a été
néanmoins trouvée qu’en 1416 par ' Guillaume
Bukelsz natif de Bier-Uliet. L a mémoire de cet
homme s’eft rendue'fi recommandable par une invention
fi utile , qu’on dit que l ’empereur Charles-
Quint étant venu dans les pays-bas , ne dédaigna
pas d’aller à Bier-Uliet avec la reine de Hongrie
fa' feeur 3 comme pour honorer de leur préfence le
tombeau de ce premier encaqueur de harengs; .
On fe fert pour la pêche des harengs de petite
bâtimens , que l’on appelle en France barques ou
bateaux , 8c qu’en Hollande on nomme bûches ou
j flib o ts .
Les bûches dont les Hollandois fè fervent pour
la pêche du hareng font ordinairement du port de
quarante - huit â foixante tonneaux $ elles doivent
être pourvues de deux petits canons du poids de
huit cens livres chacun , de quatre pierriers, huit
boétes, fix fufils , & douze piques, dont fix font
longues & fix courtes : à l’égard des flibots au deft
fus de foixante tonneaux, leur équipage confîfte en
quatre petits canons pefant enfémble quatre mille
livres , avec quatre pierriers , huit boétes , fix fufils
, huit piques longues & huit courtes.
Il n’eft pas permis de faire ' fortir des ports de
Hollande aucunes bûches pour la pêche des harengs
, qu’elles ne fôient efeortées d’un convoi , 011
du moins qu’il n’y en ait un-nombre fuffifant pour
compdfer enfemble dix-huit ou vingt pièces de petits
canons & douze pierriers 5 alors elles doivent
aller de conferve, c’eft-i-dire de flotte & de compagnie
, fans pourtant qu’elles puiflent prendre fous
leur efeorte aucuns bâtimens non armés.
Les conventions verbales qui fe font pour la
conferve , ont autant de force que fi elles étoient
faites par écrit ; il faut obferver que chaque bâtiment
de la conferve doit avoir des munitions fuffi-
fantes de poudre , de balles & de mitrailles pour
tirer au moins feize coups.
Lorfque le temps Ce trouve b eau , & que quelque
bûche veut faire fa pêch e, il faut que le pilote
faffé hirfer fon artimon ; & celles qui ne pêchent
point ne doivent pas fe mêler parmi celles
qui pêchent, il faut qu’elles fe tiennent â la voile.
F o y e ^ b û c h e .
Ces réglemens de l’amirauté de Hollande, pour
la pêche du hareng, ont en partie été imités par
les François , & en partie augmentés de quantité
d’autres qui y ont été ajoutés par l’ordonnance de
la marine du mois d’août 1681 , foit concefnant les
filets dont les pêcheurs doivent fe fervir , foit pour