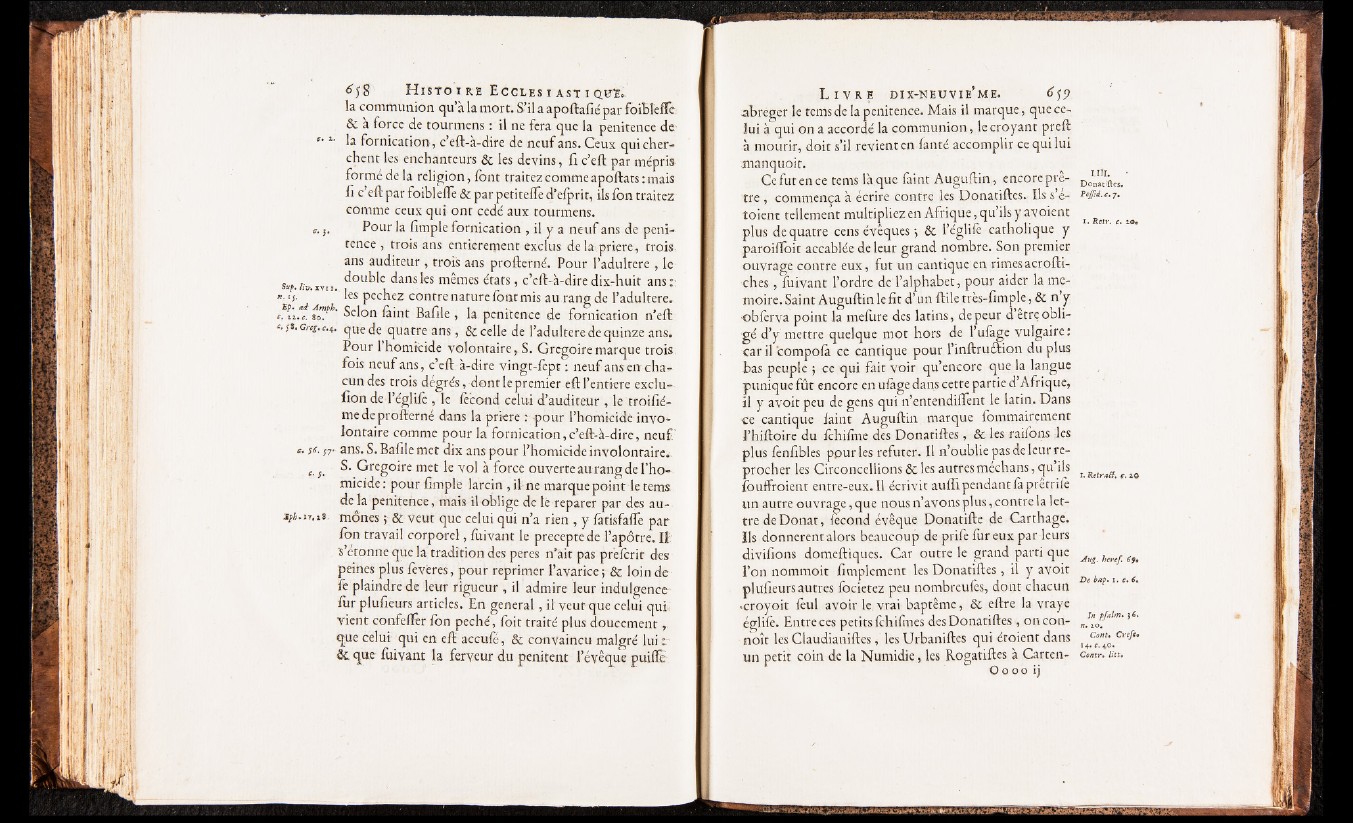
6J 8 H l S T O I RE E c o l e s I A S T I Q.ü 'ïè
la communion qu’à la mort. S’il a apoftafié par foiblefTe
& à force de tourmens : il ne fera que la penitence de
* • la fornication , c’eft-à-dire de neuf ans. Ceux qui cherchent
les enchanteurs & les devins, fi c’eft par mépris
formé de la religion, font trairez comme apoftats : mais
fi c’eft par foiblelïè & par petitelïè d’efprir, ils fon traitez
comme ceux qui ont cédé aux tourmens.
e. 3. Pour la fimple fornication , il y a neuf ans de penitence
, trois ans entièrement exclus dela priere, trois
ans auditeur , trois ans profterné. Pour l’adulrere , le
r double dans les mêmes états , c’eft-à-dire dix-huit ansr Sttp, / t t fe x v ix , 1 ! r
n. jj. les pechez contre nature font mis au rang de l’adultere.
t. ïi.*d ta?1’' Selon faint Bafile , la penitence de fornication n’eft
c. ¡t.Grcg.c.t. quede quatre ans, & celle de l’adultere de quinze ans.
Pour l’homicide volontaire,. S. Grégoire marque trois;
fois neuf ans, c’eft à-dire vingt-fèpt : neuf ans en chacun
des trois dégrés, dont le premier eft l’entiere exclu-
fion de Téglifè , le fécond celui d’auditeur , le troifiéme
de profterné dans la prkre : -pour l’homicidè involontaire
comme pour la fornication,c’eft-à-dire, neuf’
c. fi. 37* ans. S. Bafile met dix ans pour l’homicide involontaire.
e . f . ^ Grégoire, met le vol à force ouverte aurang de l’homicide
: pour fimple larcin , il ne marque point le tems
de la penitence, mais il oblige de lé reparer par des au-
S { b .IV.»8. moines ; & veut que celui qui n’a rien , y fatisfafle par
fon travail corporel, iuivant le preceptede l’apôtre. I l
s’étonne que la tradition des peres n’àit pas preferir des
peines plus fevères, pour reprimer l’avarice; & loin de
fe plaindre de leur rigueur , il admire leur indulgence
for plufieurs articles. En général, il veut que celui qui:
vient confefFer fon péché, foit traité plus doucement,
que celui qui en eft accule, & convaincu malgré lui r
&. que fuiyant la ferveur du penitent l’évêque puifTe
L i v r e d i x -n e u v i e ’ m e . é j ?
abréger le tems de la penitence. Mais il marque, que celui
à qui on a accordé la communion, le croyant preft
à mourir, doit s’il revienten fanté accomplir ce qui lui
ananquoit.
Ce fut en ce tems là que faint Auguftin, encore pre-
tre , commença à écrire contre les Donatiftes. Ils s’é-
toient tellement multipliez en Afrique, qu’ils y avoient
plus de quatre cens évêques ; & l’églifè catholique y
paroifïoit accablée de leur grand nombre. Son premier
ouvrage contre eux, fut un cantique en rimes acrofti-
ches , fuivant l’ordre de l’alphabet, pour aider la mémoire.
Saint Auguftin le fît d’un ftile très-fimple, & n’y
•obfêrva point la mefîire des latins, de peur d’être obligé
d’y mettre quelque mot hors de l’ufage vulgaire :
car il compofà ce cantique pour l’inftruétion du plus
bas peuplé ; ce qui fait voir qu’encore que la langue
punique fût encore en ufàge dans cette partie d Afrique,
il y avoit peu de gens qui n’entendiftent le latin. Dans
ce cantique faint Auguftin marque fommairement
l ’hiftoire du ichifme des Donatiftes, & les raifons les
plus fênfibles ppurles réfuter. Il 11’oublie pas de leur reprocher
les Circoncellions 8c les autres méchans, qu’ils
fbuffroient entre-eux. Il écrivit auffi pendantfàprêtrife
un autre ouvrage, que nous n’avons plus »contre la lettre
de Donar, fécond évêque Donatifte de Carthage.
Ils donnerentalors beaucoup de prife fur eux par leurs
divifions domeftiques. Car outre le grand parti que
l ’on nommoit fimplement les Donatiftes, il y avoir
plufieurs autres focietez peu nombreufès, dont chacun
.croyoit feul avoir le. vrai baptême, 8c eftre la vraye
églifê. Entre ces petits fchifmes des Donatiftes, oncon-
noît les Claudianiftes, lès Urbaniftes qui étoient dans
un petit coin de la Numidie, les Rogatiftes à Carten-
O o o o ij
lu i . ■
Donatiftes*
1. Retr. cê toe
I. R e tra tf, c . 2.0
Aug. heref. 69»
De bap• 1. c. 6.
In pfalm.
n. lo .
Con t. Crefc*
14. c. 40.
Contr. litt»