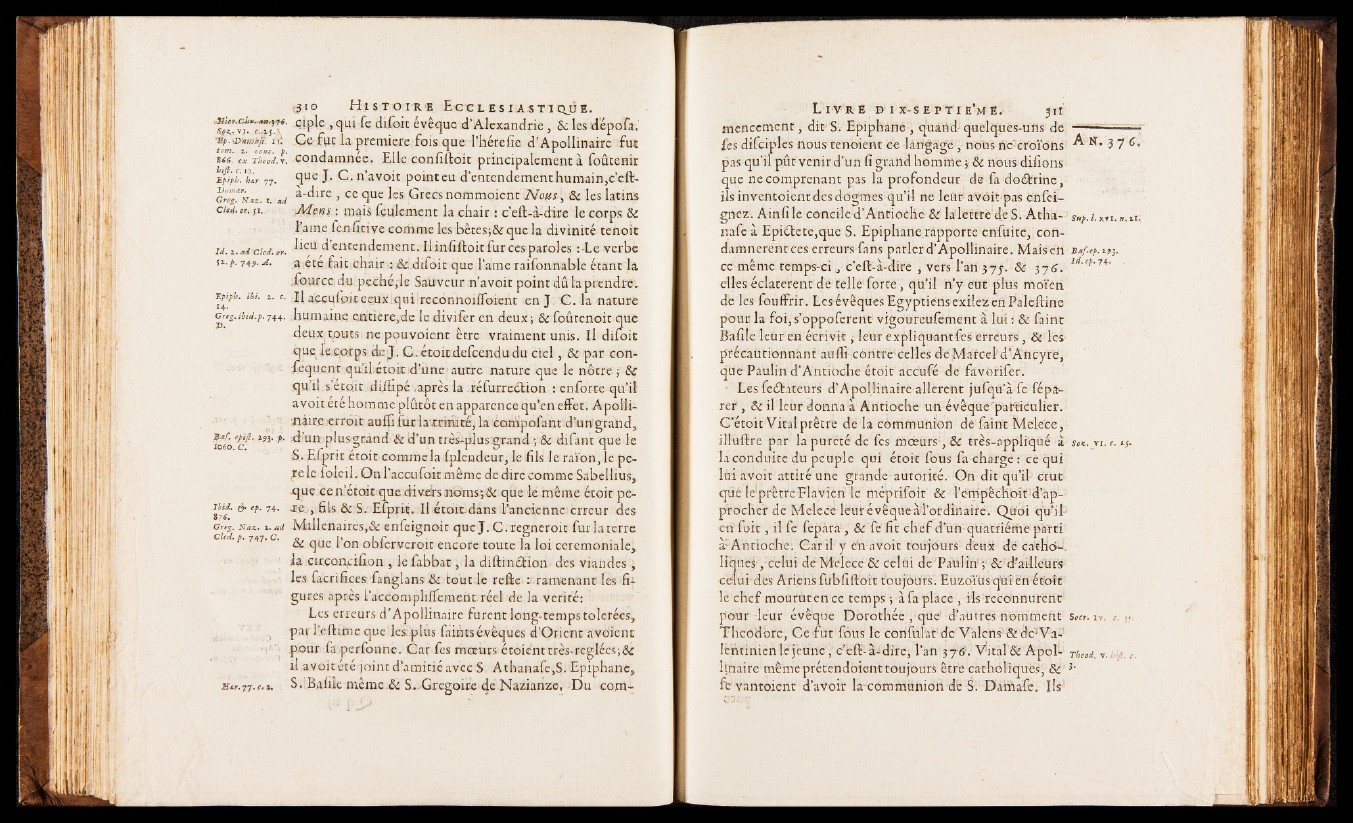
)Ji i e r . c h r . a » .^76.
S'gZf. v i . c.ri^..\
"Ep.lDatnkfi'. i i .
totn. z. conc.
SCC. ç x Theod. Y. ibi/î. c. io.
Epiph. h&r 77.
iJem&r.
Greg. N a z . I. ad
Cled.
Id . z . ad Cled. or.
S*, p. 749.
Epiph. ihi. z . c.
14.
Greg. ibid.p, 744 . D.
E a f epifl. 19.}. p.
ÎO éO . C. ;;
ep. 74 .
Ifg
Greg. N i x . z.
Cled. p. 7 4 7 . C*
H4r. 7 7 . r# z.
-310 H i s t o i r e E c t î l e s i a s t i q j j e .
çiple , qui fe difoic évêque d’Alexandrie, & les dépofa,
,Çe fur 1$ première fois que l’hérefie d’Apollinaire fut
condamnée. Elle confiftoit principalement à foûtenir
que J. C .n ’avoit pointeu d’entendement humain,c’eft-
a-dire , ce que les Grecs nommoicnt Nous^ & les latins
Mens : mais feulement la chair : c’eft-à-dire le corps &i
I ame fenfitive comme les bêtes;& que la divinité tenoit
lieu d’entendement. Ilinfiftoitfurcesparoles :-Le verbe
a etc fait chair : & d ifo it que l’ame raifonnable étant la
.fource du péché, le Sauveur n’avoit point dû la prendre:
II aeeufpit ceuxsqHi reconnoiffoient en J . C . la nature
humaine enciere,de ledivifer en deux; & foûtenoic que
deux tputs ne pouvoicnt être vraiment unis. Il difoic
que le corps de J. C . étoicxlefcendudu c ie l , & par confie
que nt qu’ilé to it d!une autre nature que le nôtre ; &
qu’il s’eto.it diiiipé .après la réfurretlion : enfort-e qu’il
avoit été homme plûcôt en apparence qu’en effet. Apollinaire
errôit auffi fur laxrinicé, la compofant d’un'grand,
d un plusgtand &c d’un nès-plus grand ; & difant que le
S. Efprit étoit comme la fplendcur, le fils le raïon, le pe-
7e le foleil. On l’accufoit même de dire comme Sabèllius,
.que cernerait queffivdrs noms;,&: que le même étoit pe-
•re.;, fils & S. Efprit. Il étoit dans l’ancienne erreur des
Millénaires,& enfeignoit que J. C . regneroit fur la terre
& que Fon obfierveroit encore toute la loi ceremoniale,.
la circoryùfion , le fiabbat, la diftinéJion des viandes >
les (acrifices fanglans A: tout le reffe ¡. ramenant les fi:
gures après l’accompliiTemerit réel de la vérité:
Les erreurs d’Apollinaire furent long-temps tolérées,
par l’elhmc que les plus faines évêques d’Orient avoient
pour la perfonne. Car fes moeurs étoient rrès-reglées;&
il avoit été joint d’amitié avec S. Athanafe,S. Epiphane,
S. Bafile même & S.,Grcgorre de Nazianze, Du com-
L IV R E D I X-S E P T I e’m E. 5il
mencement, dit'S. Epiphane , quand quelques-uns de —— ■............>
fies difciples nous tenaient ce langage , nous fie'érôians1 -A--N. 3 7
pas qu’il pût venir d’un fi grand homme ;• & nous difions
que ne comprenant pas la profondeur dé fa doétrine,
ils inventoientdes dogmes qu’il ne leur avoit pas enfei-
gnez. Ainfi le concile d’Antioehe & Mettre'de S. A th a - ; sup. 1.S ». u;
nafe à Epi6tete,que S. Epiphaneràpporte enfuite, condamnèrent
ces erreurs fans parler d’Apollinaire. Maisen b*/.<?. mj.
ce même tem p s - c ic ’eft-à-dire , vers l’an 3 75. Si 37 6 . U' e{' 74‘
elles éclatèrent de telle fo rte , qu’il n’y eut plus moïen
de les fouffrir, Lesévêques Egyptiens exilez en Paleftine
pour la foi, s’oppoferenr vigoureufement à lui : & faint
Bafile leur en écrivit ; leur cxpliquantlcs erreurs, & les
piécautionnànt auili contre'celles de Matcel'd’Ancyré,
qUe-Paulin d’Antioche étoit accufé de fàvOïifer.
■ Les feètateurs d’Apollinaire allèrent jufqù’à fe féparer
, & il leur donna à Antioche un évêqueparticulier.
G ’étoit Vital prêtre de la communion de faint Mele'ee,
illuiïre pat la pur et e de les moeurs, Sc très—appliqué a so&. vi. c. .ij*
la conduite du peuple qui étoit fous fa charge: ce qui
lûi avoir attiré une grande-autorité. On dit qu’il crut
que léprêtre Flavién le méprifoit & l’ëmpêchbtt‘d'approcher
de Meleeé leur évêque à l’ordinaire. Quoi qu’ib
en f o i t , il fe fepara , & fie fit chef d’un quatrième parti
Antioche. Car il y eû avoit toujours deux de catholiques
, celui de Melete & celui de Paulin1 ; & d-’ailleürs
celui des Ariens fubfiftoit toujours'. Euzoïüs qtii en étoit
le chef mourutence temps ; à fa place , ils reconnurent
pour leur évêque Dorothée , que' d’antres nomment s»w. iv. t. 3j,
Théodore, Ce fu t fous le confulat de Valens'&: delVa-
lcntinienlejeune, cxit-à* dire, l’an yfë.- Vital & A poli.- Theod y ^ c
îinaire mêmeprétendoient toujours être catholiques, & 3\
fevancoient d’avoir la-communion dè Sv Damafie. Ils