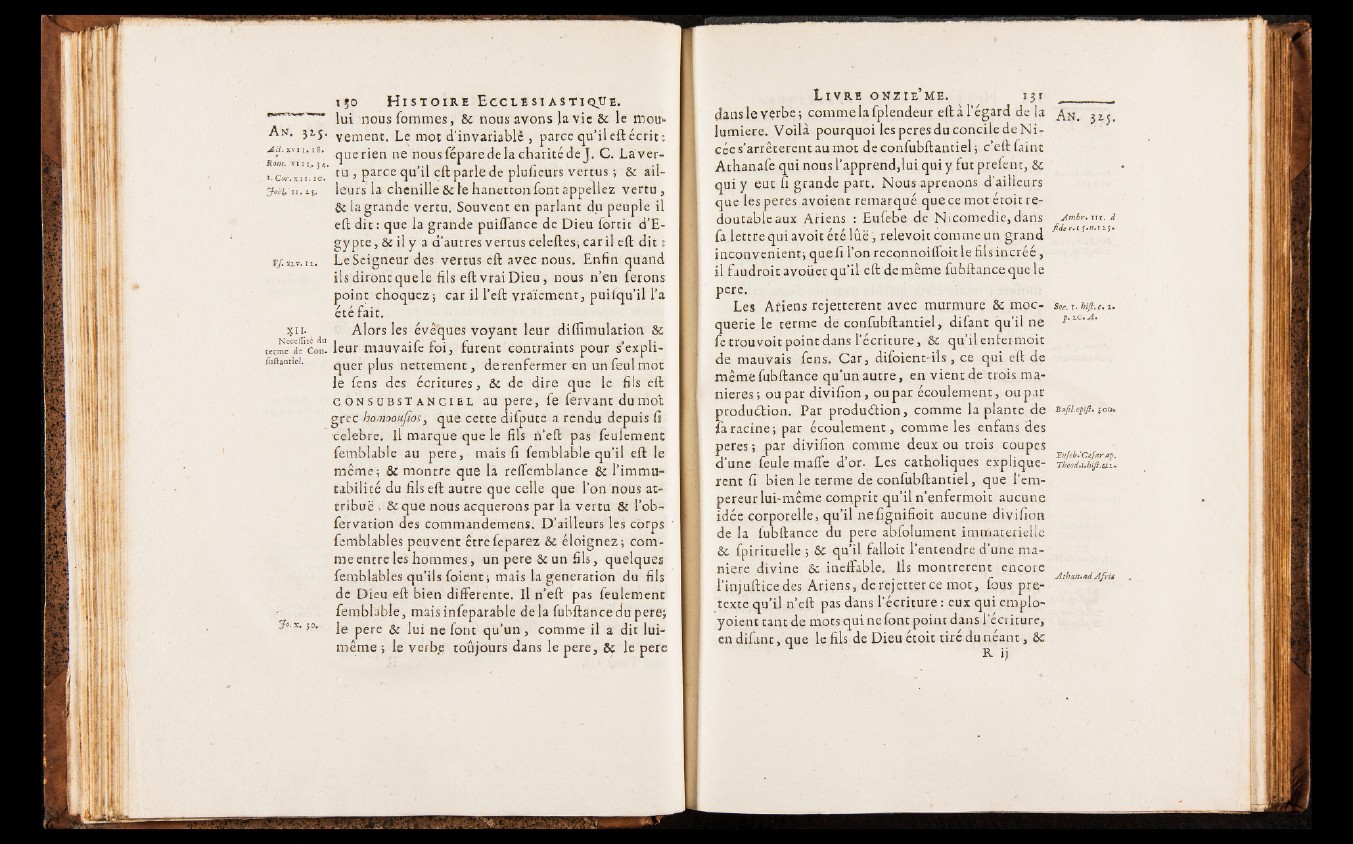
A c t. x v i l , i
Rom. v i i i , . 34
î. Cor. x i i . 10»
Jo ë l.' i i . 2 y..
Vf» XL Y. 12*
X I I .
Neceilicé du
terme de Con-
fuftanci'el.
i ;o H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
lui nous fommes, 8c nous avons la vie 8c le mou*
A n. 315. vement. Le mot d'invariable , parce qu’ il eft écrit ;
que rien ne nous fépare de la charité de J . C. La vertu
, parce qu’il eft parle de plufieurs vertus ; 8c ailleurs
la chenille 8c le hanetton font appeliez vertu ,
& la grande vertu. Souvent en parlant du peuple il
eft dit : que la grande puiffance de Dieu fortit d’Egypte
, 8c il y a d’autres vertus celeftes; car il eft dit :
Le Seigneur des vertus eft avec nous. Enfin quand
ils diront que le fils eft vrai D ieu, nous n’en ferons
point choquez; car il l’eft vraïement, puilqu’il l’a
été fait.
Alors les évêques voyant leur diffimulation 8c
leur mauvaife fo i, furent contraints pour s’expliquer
plus nettement, de renfermer en un feul mot
le fens des écritures, 8c de dire que le fils eft
c ô n s u b s t a n c i e l au pere, fe fervant du mot
grec homooufîos, que cette difpute a rendu depuis fi
Célébré. Il marque que le fils n’eft pas feulement
femblable au pere, mais fi femblable qu’il eft le
même; Se montre que la reffemblance 8e l’immutabilité
du fils eft autre que celle que l’on nous attribue
. 8e que nous acquérons par la vertu & l’ob-
fervation des commandemens. D’ailleurs les corps
femblables peuvent êtrefeparez 8e éloignez; comme
entre les hommes, un pere & un fils, quelques
femblables qu’ils foient; mais la génération du fils
de Dieu eft bien différente. Il n’eft pas feulement
femblable, mais infeparable delà fubftancedu pere;
le pere & lui ne font qu’u n , comme il a dit lui-
même ; le verb.e toujours dans le pere, 8ç le pere
L i v r e o n z i e ’ me . 131
dans le verbe; comme la fplendeur eft à l’égard de la
lumière. Voilà pourquoi les peres du concile de N i-
cée s’arrêtèrent au mot de confubftantiel ; c’eft faint
Athanafe qui nous l’apprend,lui quiy fut prefenc, 8c
qui y eut fi grande part. Nous aprenons d’ailleurs
que les peres avoient remarqué que ce mot etoit redoutable
aux Ariens : Eufebe de Nicomedie, dans
fa lettre qui avoir été lûë , relevoit comme un grand
inconvénient; quel! l’on reconnoiifoit le filsincréé,
il faudrait avouer qu’il eft de même fubftance que le
pere., ;
Les Ariens rejetterent avec murmure 8c moc-
querie le terme dé confubftantiel, difant qu'il ne
fetrouvoit point dans l’écriture, 8c qu’il enfermoit
de mauvais fens. C ar, difoient-ils, ce qui eft de
même fubftance qu’un autre, en vient de trois maniérés
; ou par divifion, ou par écoulement, ou par
production. Par production, comme la plante de
la racine; par écoulement, comme les enfans des
peres ; par divifion comme deux ou trois coupes
d’une feule mafle d’or. Les catholiques expliquèrent
fi bien le terme de confubftantiel, que l’empereur
lui-même comprit qu’il n’çnfermoit aucune
idée corporelle, qu’il nefignifioit aucune divifion
de la fubftance du pere abfolument immatérielle
8c fpirituelle ; 8c qu’il falloic l'entendre d’une maniéré
divine 8c ineffable, ils montrèrent encore
l’injufticedes Ariens, derejetterce mot, fous prétexte
qu’il n’eft pas dans l’écriture : eux qui emplo-
yoient tant de mots qui ne font point dans l’écriture,
en difant, que le fils de Dieu étoit tiré du néant, 8c
R ij
A n. 315.
Ambr. m . d
fidec,i$»n»\x$m
Soc. 1 • bifi, c« 2»
jp. 20. A»
Bajïl.epijl. 300«.
EuJeb.'C&far ap.
Theod.i.hift.eii.
Athan.etd A frit