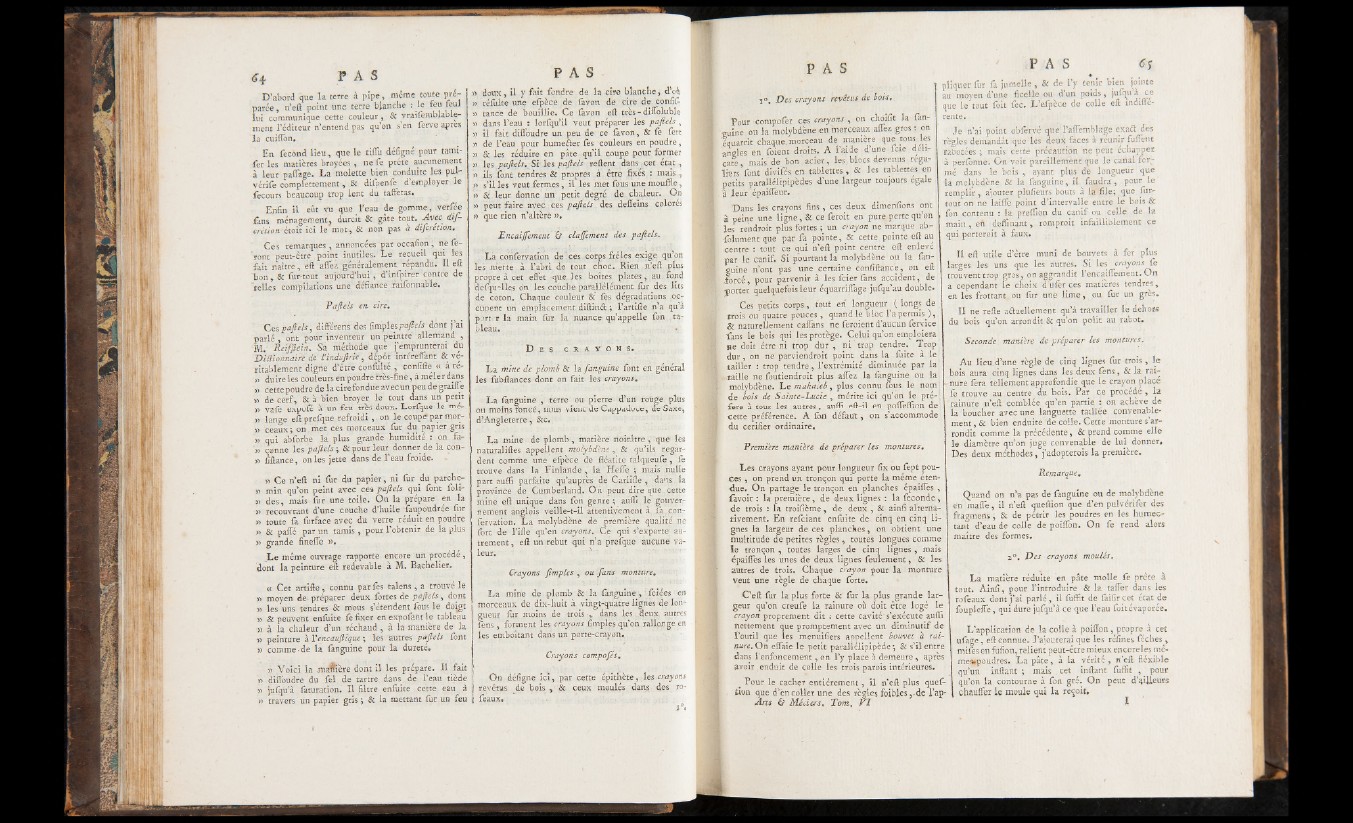
D ’abord que la terre à pipe, même toute pré- '
parée, n’eft point une terre blanche : le feu feul
lui communique cette couleur , 8ç vraifemblable-
ment l ’éditeur n’entend pas qu’on s en ferve apres
la cuiffon.
En fécond lieu, que le tifïit défigné pour tami-
fer les matières broyées , ne fe prête aucunement
à leur paflage. La molette bien conduite les pul-
vérife complettement, & difpenfe. d’employer le
fecours beaucoup trop lent du taffetas.
Enfin il eût Vu que l’eau <le gomme, verfee
iâns ménagement? durcit & gâte tout. Avec dif-
ciition ktoit ici le mot, & non pas a discrétion.
Ces remarques , annoncées par occafîon, ne feront
peut-être point inutiles. Le recueil qui les
fait naître, eft affez généralement, répandu. Il eft
bon, & fur-tout aujourd’hui’, d’infpirer contre de
telles compilations une défiance .raifbnnable.
Pafiels en cire.
Ces pafiels, différent des pafiels font j’ai
parlé, ont pour inventeur un peintre allemand ,
M. Reifftein. Sa méthode que j’emprunterai du
Dictionnaire de Ü indu fin e , dépôt intcrefTant & véritablement
digne d’etrè confiilte , confifte «. a re-
» duire les couleurs en poudre très-fine, à mêler dans
» cette poudre de la cire fondue avecun peu dë graille
» de cerf , & à bien broyer le tout dans un petit
» vafe expofé à un feu très-doux. Lorfque le mé-
» lange eftprefque refroidi ,. on le coupé par mor-
» ceaux ; on met ces morceaux fur du papier gris
» qui abforbe la plus grande humidité : on fa-
» c®nne les pafiels ; &pour leur donner de la con-
» fiftance, on les jette dans dé l’eau froide.
» Ce n’eft ni fur du papier, ni fur du parche-
» min qu’on peint avec cé» pafiels qui font foli-
■» des, mais fur une toile. On la préparé en la
» recouvrant d’une couche d’huile ~fàupoudree fur
» toute fa furface avec du verre réduit en poudre
» & pafîé par un tamis , pour l’obtenir de la plus
» grande fineffe ». .
L e même ouvrage rapporte encore un procédé,
dont la peinture eft redevable à M. Bachelier.
« Cet artifte, connu parles talens, a trouvé le
» moyen de-préparer deux fortes de pafiels, dont
» les uns tendres & mous s’étendent fous le doigt
» & peuvent enfuite le fixer en èxpofant le tableau
» à la chaleur d’un réchaud , à la manière de la
» peinture à. Vencaufiique t, les autres pafiels font
» comme de la fanguine pour la dureté,
» Voici la matière dont il les prépare. Il fait
» difloudre du fel de tartre dans de. l’eau tiède
» jufqu’à faturation. Il filtre enfuite cette eau à
» travers un papier gris ; & la mettant lur. un feu
» doux, il y fait fondre de la cire blanche, d’où
» rélulte une efpèce de favon de cire de confif
» tance de bouillie. Ce lavon eft très - difîoluble
» dans l ’eau : iorfqu’il veut préparer les pafiels ,
» il fait difloudre un peu de ce' lavon, & le fert
» de l’eau pour humeéter les couleurs en poudre,
» & les réduire en pâte qu’il coupe pour former
» les pafiels.-Si pafiels relient dans -, cet état ,
» ils font tendres & propres à être fixés : mais ,
» s’il les veut fermes, il les met fous une moume,
» & leur donne un petit degré de . chaleur. On
» peut faire avec : ces pafiels| des defteins colorés
» que rien n’altèrè »,
Encaijfement & clajjement des pafiels.
Là confervation de "çes corps frêles exige qu’on
les mette à l’abri de tout choc. Rien n’eft plus
propre à cet effet que. les boîtes plates , au. fond
defquelles on les couche parallélément lûr des lits
de coton. Chaque couleur & les dégradations .occupent
un emplacement diftind ; l’artifte n’a qu’à
port r la main fur la nuance qu’appelle fon . tableau,
. I , * . j - i - J ; • : . •
D e s c r a y o n s .
La mine de plomb & la fanguine font en généra!
les iubftances dont on fait les crayons.
La fanguine , terre ou pierre d’un rouge plus
ou moins foncé, nous vient de Cappadoce, de Saxe,
d’Angleterre, &c,.
La mine de plomb, matière noirâtr-e-, que les
naturaliftes appellent molybdène ,> & qu’ils regardent
comme une elpèce de ftéatite talqueufe, le
trouve dans la Finlande , la Hefle ; mais nulle
part aulïi parfaite qu’auprès de Carlifle , dans la
province de Cumberland. On peut dire que, cette
mine eft unique dans Ion genre ; aulïi le gouvernement
anglois veille-t-il attentivement à. fa .confervation.
La molybdène de première qualité .ne
lort de Fille qu’en crayons. Ce qui s’exporte? autrement,
eft un rebut qui n’a prefque aucune valeur.
Crayons [impies , ou fans monture.
La mine de plomb & la languine , fciées en
morceaux de dix-huit à vingt-quatre lignes de longueur
lur moins de trois > dans les t deux autres
fens, forment les crayons fimplgs qu’on rallonge en
les emboîtant dans un porte-craydn, ;
Crayons compofés.
On défîgne ici, par cette épithète, les crayons
revêtus de bois , & ceux moulés dans des ro-
feaux,
......i 0«
i ° . Des crayons revêtus de bois.
Pour -compolêr ces crayons , on choifît la lân-
guine ou la molybdène en morceaux .affez gros : on
fquarrit chaque, morceau de manière que tous les
angles en foient droits. A l’aide d’une fcie délicate
mais.'de bon acier, les,blocs devenus réguliers’
font diviles en tablettes, & les tablettes en
petits parallélipipèdes d’une largeur toujours égale
a leur épaiffeur.
Dans les crayons fins, ces deux dimenfîons ont
à peine une ligne, & ce feroit en pure perte qu’on
les rendroit plus fortes ; un crayon ne marque absolument
que par fa pointe, Sc cette pointe eft au
xentre : tout ce qui n’eft point centre eft enleve. i
par le canif. Si pourtant la molybdène ou la fàn-
guine n’ont pas une certaine eonfiftance, on eft
.forcé, pour parvenir à les feier fans accident, de
porter quelquefois leur équarriffage jufqu’au double.
Ces petits corps, tout en longueur (■ longs de
trois ou quatre pouces , quand le bloc l’a permis),
& naturellement caftans ne feroient d’aucun fervice
fans le bois qui les protège. Celui qu’on emploiera
«e doit être ni trop dur , ni trop tendre. Trop
dur, on ne parviendroit point dans la fuite à le
tailler : trop tendre, l ’extrémité diminuée par la
.taille ne foutiendroit plus affez la fanguine ou la
molybdène. Le mahaleb, plus connu fous le nom
de bois de Sainte-Lucie , mérite ici qu’on le préféré
à tous les autres, aufïi eft-il en poffefïïon de
cette préférence. A fbii défaut, on s’accommode
du cerifîer ordinaire.
Première manière de préparer les montures.
Les crayons ayant pour longueur fîx ou fèpt pouces
, on prend un tronçon qui porte la même étendue.
On partage le tronçon en planches épaiftès ,
fâvoir : la première, de deux lignes : la féconde ,
de trois : la troifième, de deux , & ainfi alternativement.
En refeiant enfuite de- cinq en cinq lignes
la largeur de ces planches, on obtient une
multitude de petites règles , toutes longues comme
le tronçon , toutes larges de cinq lignes , mais
épaiffes les unes de deux lignes feulement, & les
autres de trois. Chaque crayon pour la monture
veut une règle de chaque forte.
C ’eft fur la'plus forte & fur la plus grande largeur
qu’on creufe la rainure où doit être logé le
crayon proprement dit : cette cavité .s’exécute aufïi
nettement que promptement avec un diminutif de
ï ’outil que les menuifiers appellent bouvet a rainure.
On effaie le petit parallélipipède ; & s’il entre
dans l ’enfoncement, on l ’y place à demeure, après
avoir enduit de colle les trois parois intérieures.
Pour le cacher entièrement, il n’eft plus quef-
tion que d’èn coller une des règles foibles r de i ’ap-
Arts & Méciers, Tom, r i
pHquer fur fa jumelle, & de l’y tenir bien jointe
au moyen d’une ficelle ou d’un poids, jufqua^ ce
que le tout foit fec. L ’eipece de colle eft indifférente.
Je n’ai point obfervé que l’affembla^e exaél des
règles demandât que les deux faces a réunir fuflent
rabotées ; mais cette précaution ne péut échapper
à perfonne; On voit pareillement que le canal formé
dans le bois , ayant plus de longueur que
la molybdène & la fanguine, il faudra, pour le
remplir, ajouter plufîeurs bouts à la file; que fur-
tout on ne laifle point d’intervalle entre le bois &
fon contenu : la preffibn du canif ou celle de la
main, eft deffmant, romproit infailliblement ce
qui porteroit à faux.
Il eft utile d’être muni de bouvets à fer plus
larges les uns que les autrés. Si les crâyons fe
trouvent trop gros, on aggrandit l’encaiflement. On
a cependant le choix d’ufer ces matières tendres,
en les frottant, ou fur une lime, ou fur un grès.
Il ne relie actuellement qu’à travailler le dehor-s
du bois qu’on arrondit & qu’on polit au rabot.
Seconde manière de préparer les montures.
Au lieu, d’une règle de cinq lignes fur trois , le
bois aura cinq lignes dans les deux fens, & la rai-
-nure fera tellement approfondie que le crayon place
fe trouve au centre du bois. Par ce procédé , la
rainure n’eft comblée qu’en partie : on achève de
la boucher avec une languette taillée convenablement
, & bien enduite de colle. Cette monture s arrondit
comme la précédente, & prend comme elle
le diamètre qu’on juge convenable de lui donner.
Des deux méthodes, j’adopterois la première.
Remarque.
Quand on n’a pas de fanguine ou de molybdène
en rnafle, il n’eft queftion que d’en pulvérifer des
fragmens, & de pétrir les poudres en les humectant
d’eau de colle de poiflon. On fe rend alors
maître des formes.
i ° . Des crayons moulés.
La matière réduite en pâte molle fe prête à
tout. Ainfi, pour l’introduire & la tafier dans les
roféaux dont j’ai parlé, il fuffit de faifir cet état de
foupleffe, qui dure jufqu’à ce que l’eau foit évaporée.
L ’application de la colle à poiflon, propre à cet
ufage, eft connue. J’ajouterai que les réfines féches ,
mifes en fufion, relient peut-être mieux encore les mê-
mestpoudres. L a pâte, à la vérité , n’eft fléxible
qu’un inftant ; mais . cet in fiant fuffit , pour
qu’on la contourne à fon gré. On peut d’ailleurs
chauffer le moule qui la reçoit.