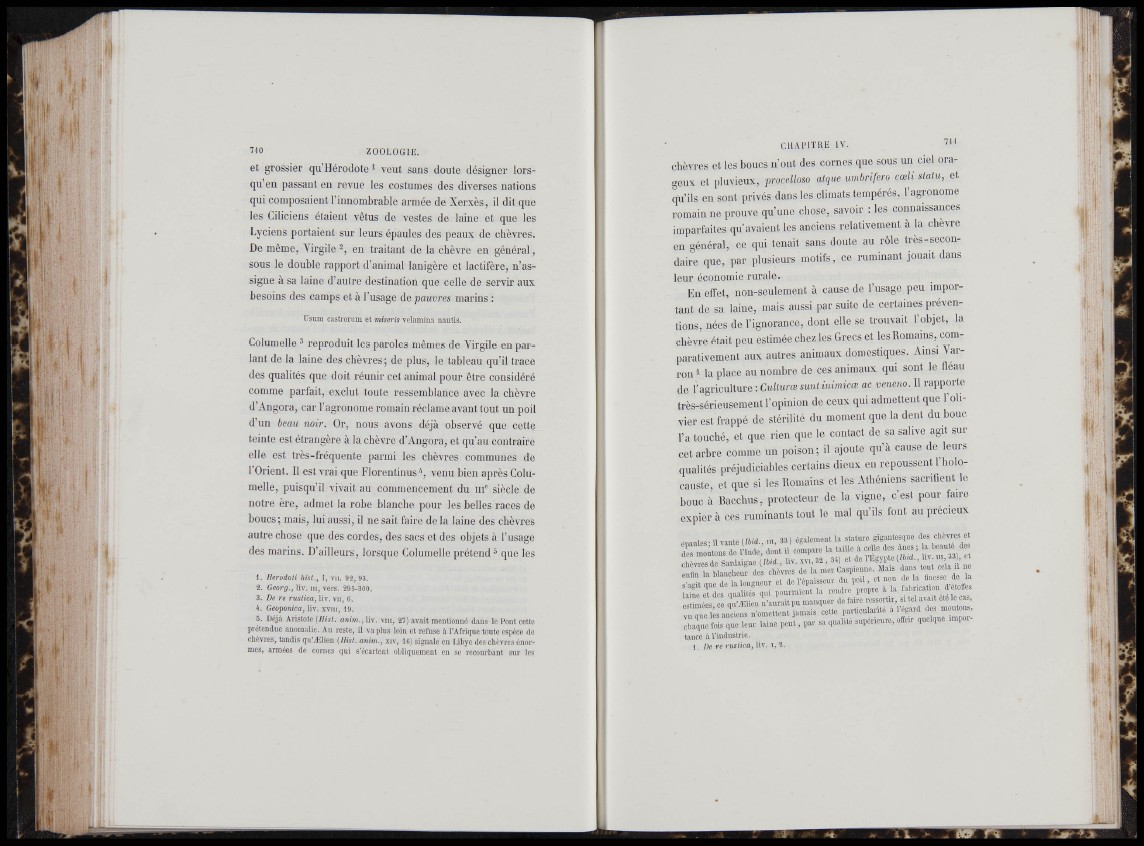
'Jh
I t
710 ZOOLOGIE,
et grossier qu'Hérodote » veut sans cloute tlésiguer lorsqu'eu
passaut en revue les costumes des diverses iiatious
qui composaieut l'innomlirable armée de Xerxès, il dit que
les Ciliciens étaient vêtus de vestes de laiue et que les
Lyciens portaient sur leurs épaules des peaux de chèvres.
De même, Virgile -, on traitant de la chèvre en général,
sous le double rapport d'animal lanigère et lactifère, n'assigne
à sa laine d'autre destination que celle de servir aux
besoins des camps et à l'usage de pauvres marins :
Usum castronim et miseris velamina nantis.
Columelle ' reproduit les paroles mêmes de Virgile en parlant
de la laine des clièvres; de plus, le tableau qu'il trace
des qualités que doit réunir cet animal pour être considéré
comme parfait, exclut toute ressemblance avec la chèvi'e
d'Angora, car l'agronome romain réclame avant tout un poil
d ' u n beau noir. Or, nous avons déjà observé que cette
teinte est étrangère à la chèvre d'Angora, et qu'au contraire
elle est très-fréquente parmi les chèvres communes de
l'Orient. Il est vrai que Florentinus venu bien après Columelle,
puisqu'il vivait au conmiencement du m' siècle de
notre ère, admet la robe blanche pour les belles races de
boucs ; mais, lui aussi, il ne sait faire de la laiue des chèvres
autre chose que des cordes, des sacs et des objets à l'usage
des marins. D'ailleurs, lorsque Columelle prétend ^ que les
1. Ilerodoti hist., I, vu, 32, 93.
2. Georg., Hv. m , vers. 295-300.
3. De re rustica, liv. vti, 0.
4. Geojjûwic«, liv. xvrii, 19.
5. Déji Arislole {llisl. anim., liv. vu., n] avait mentionné dans le Pont cette
p r é t e n d n c anomalie. .An reste, il va plus loin et refnse à l'Afrii|ne tont e espicc de
chèvres, tandis qu'Jï l ien [Hisl. anim., siv, 1(1) s igna l e en Libye des clièvres énormes,
armées de cornes qui s'écartent obliquement en se recourbant sur les
r
k
CIlAfirilE IV.
chèvres et les boucs n'ont des cornes que sous un ciel orageux
et pluvieux, p,-ocello.io aique umbrífero coeli slatu, et
qu'ils en sont privés dans les climats tempérés, l'agronome
romain ne prouve qu'une chose, savoir : les connaissances
imparfaites qu'avaient les anciens relativement à la chèvre
en général, ce qui tenait sans doute au rôle très-secondaire
que, par plusieurs motifs, ce ruminant jouait dans
leur économie rurale.
En effet, non-seulement à cause de l'usage peu important
de sa laine, mais aussi par suite de certaines préventions,
nées de l'ignorance, dont elle se trouvait l'objet, la
chèvre était peu estimée chez les Grecs et les Romains, comparativement
aux autres animaux domestiques. Ainsi Varrou
1 la place au nombr e de ces animaux qui sont le lléau
de l'agriculture : Cultural sunt inimicoe ac veneno. 11 rappor t e
très-sérieusement l'opinion de ceux qui admettent que l'olivier
est frappé de stérilité du moment que la dent du bouc
l'a touché, et que rien que le contact de sa salive agit sur
cet arbre comme un poison; il ajoute qu'à cause de leurs
qualités préjudiciables certains dieux en repoussent I holocauste,
et que si les Romaius et les Athéniens sacrifient le
bouc à lîacchus, protecteur de la vigne, c'est pour faire
expier à ces ruminants tout le mal qu'ils font au précieux
mmmmm^
e ü a q u e fois que leur laine p eut , par sa qualité supérieure, o ï n r quelque mipoitance
à 1. De lr' ien druussiitcrai,e . l iv. i, t .
i; it;
;
!
• H t .
.-• i
i.
îi
m Má