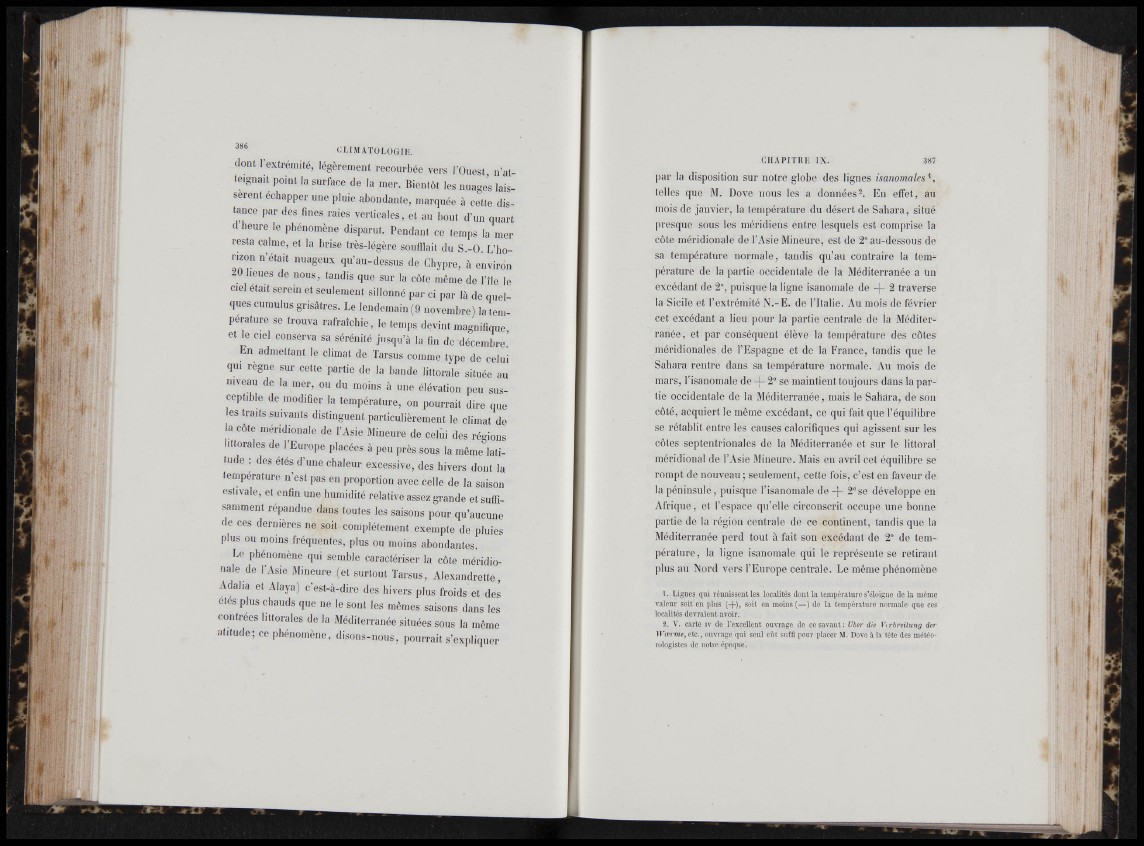
i f ' ^
• .i 1
' i l I
r r
CLIMATULOGIIi.
doni lextré,„i,é, légère,„em recourbée vers l'Ouest „'alleigna.
t point la surface de la nier. Bientôt les nua-es laissèrent
échapper une pluie abondante, marquée à cette dislance
par des fines raies verticales, et au l.out d'un quart
d iieure le phénomène disparut. Pendant ce temps la mer
resta calme, et la brise très-légère souillait du S.-O I.'hom
o n n'ela.t nuageux qu'au-dessus de Chypre, à environ
20 l.eues de uous, tandis que sur la c<Mc mime de l'ile le
ciel était serein et seulement sillonné par ci par là de quelques
cumulus grisâtres. Le lendemain (9 novembre) la temperature
se trouva rafraîchie, le temps devint maguinque
et le ciel conserva sa sérénité jusqu'à la lin de décembre'
En admettant le climat de Tarsus comme type de celui
qui règne sur cette partie de la bande littorale située au
niveau de la mer, ou du moins à une élévation peu susceptible
de modifier la température, on pourrait dire nue
les traits suivants distinguent particulièrement le climat de
la côte méridionale de l'Asie Mineure de celui des région,
imorales de l'Europe placées à peu près sous la même lati^
lude : des étés d'une chaleur excessive, des hivers dont la
temperature n est pas en proportion avec celle de la saison
estivale, et enfin une humidité relative assez g rande et suffisamment
répandue dans toutes les saisons pour qu'aucune
de ces dernières ne soit complètement exempte de pluies
plus ou moins fréquentes, plus ou moins abondantes.
Le phénomène qui semble caractériser la côte méridionale
de l'Asie Mineure (et surtout Tarsus, Alexandrette,
Adalia et Alaya) c'est-à-dire des hivers plus froids et des
êtes plus chauds que ne le sont les mômes saisons dans les
contrées littorales de la Méditerranée situées sous la même
alitude; ce phénomène, disons-nons, pourrait s'expliquer
C t l A P I T U l ; IX. .)87
|)ar la disposition sur notre globe des lignes isanomaks^,
telles que M. Dove nous les a données-. En effet, an
mois de janvier, la température du désert de Sahara, situé
presque sous les méridiens entre lesquels est comprise la
côte méridionale de l'Asie Mineure, est de 2° au-des sous de
sa température normale, tandis qu'au contraire la température
de la partie occidentale de la Méditerranée a tin
excédant de 2°, puisque la ligne isanomale de -j- 2 traverse
la Sicile et l'extiémilé N.-E. de l'Italie. Au mois de février
cet excédant a lieu |iour la partie centrale de la Méditerranée,
et par conséquent élève la température des côtes
méridionales de l'Espagne et de la France, tandis que le
Sahara rentre dans sa température normale. Au mois de
mars, l'isanomale de 2° se maint ient toujour s dans la partie
occidentale do la Méditerranée, mais le Sahara, de son
côté, acquiert le même excédant, ce qui fait que l'équilibre
se rétablit entre les causes calorifiques qui agissent sur les
côtes septentrionales de la Méditerranée et sur le littoral
méridional de l'Asie Mineure. Mais en avril cet équilibre se
rompt de nouveau : seulement , cette fois, c'est en faveur de
la péninsule, puisque l'isanomale de -f- 2° se développe en
A f r i q u e, et l'espace qu'elle circonscrit occupe une bonne
partie de la région centrale de ce continent, tandis que la
Méditerranée perd tout à fait son excédant de 2° de temp
é r a t u r e , la ligne isanomale qui le représente se retirant
plus au Nord vers l'Europe centrale. Le même pliénomène
1. Lignes qui réunissent les localités dont la température s'éloigne de la même
valem- soit CE plus {-{-), soit en moins (—) de la température normale que ces
localités devraient avoir.
2. V. carte iv de l'cxcellent ouvrage de ce savant : Uber Aie V<rbreUuiig der
H'iprme, etc., ouvr.age qiri seul eût sum pour placer M, Dove à la tète des météoriilogistes
dé notre époque.
ii.,
•I
" l ì ;
S i : ! '