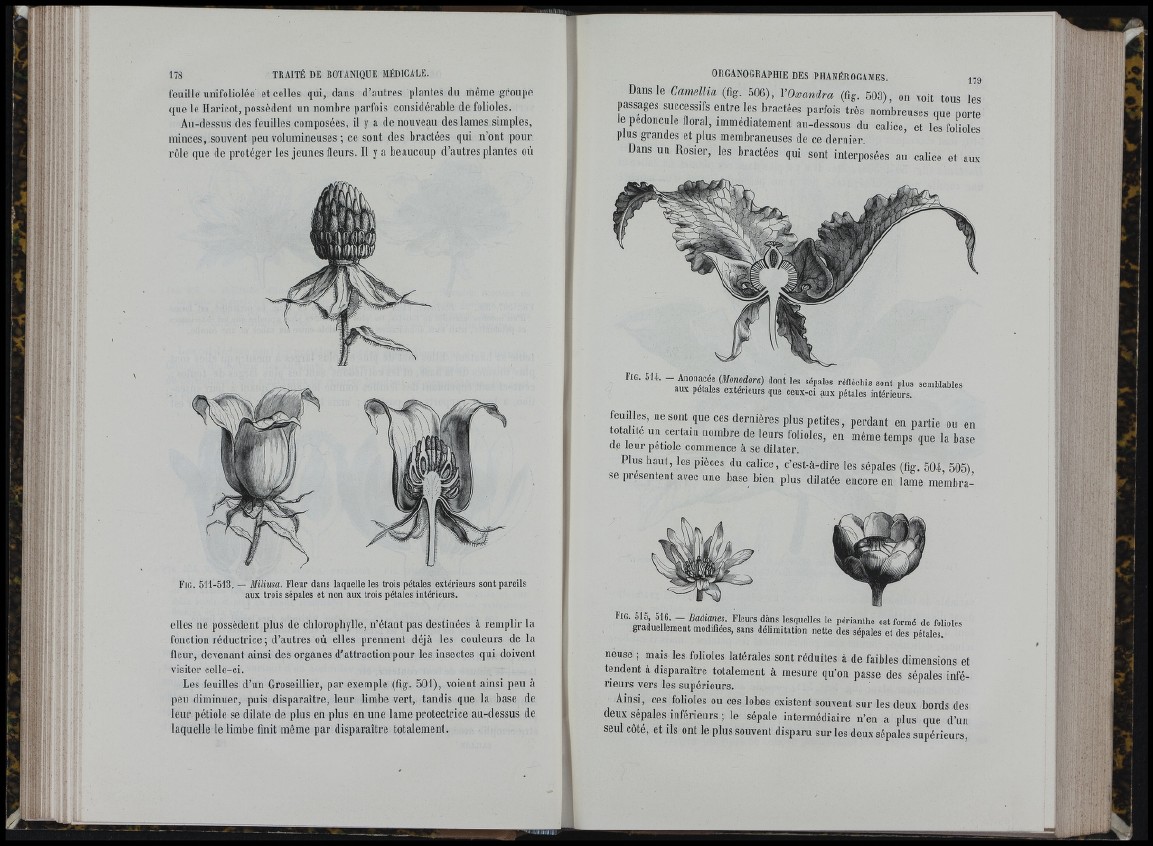
Y)
.. I 'Mff'
Ici
i - ' i l
. . . lE
x p ' x ë [, 11
r M *1
li.
r? ■ ■ 'U
Pf- U ' ‘ 'ï! ■ 'p :
•kf J -'
■ . kl;
s.,
• ••'* '■ "i ÿ' ■ ,
/t«: ; ■“
■N ' l t x r,ÎtN
" ■ %} v'.-''i" : if}f--
• "-/ '. ^ ,rf .i'- .
.-,:;iit Ik
feuille unifoliolée et celles qui, dans d’autres plantes du même groupe
que le Haricot, possèdent un nombre parfois considérable de folioles.
Au-dessus des feuilles composées, il y a de nouveau des lames simples,
minces, souvent peu volumineuses ; ce sont des bractées qui n’ont pour
rôle que de protéger les jeunes fleurs. Il y a beaucoup d’autres plantes où
Fjg. 511-513. — Miliusa. F le u r dans laquelle les trois pétales extérieurs sont pareils
aux trois sépales et non aux trois pétales intérieurs.
elles ne possèdent plus de cbloropbylle, n’étant pas destinées à remplir la
fonction réductrice ; d’autres où elles prennent déjà les couleurs de la
fleur, devenant ainsi des organes d'attraction pour les insectes qui doivent
visiter celle-ci.
Les feuilles d’un Groseillier, par exemple (fig. 501), voient ainsi peu à
peu diminuer, puis disparaître, leur limbe vert, tandis que la base de
leur pétiole se dilate de plus en plus en une lame protectrice au-dessus de
laquelle le limbe finit même par disparaître totalement.
Dans le Camellia (fig. 506), VOxandra (fig. 503), on voit tous Z
passages successifs entre les bractées parfois très nombreuses que porte
le pedoucule floral, immédiatement au-dessous du calice, et les folioles
plus grandes et plus membraneuses de ce dernier.
Dans un Rosier, les bractées qui sont interposées au calice et aux
ne. 511. - rén»his sont pu,s semblables
aux petales exteneurs que ceux-ci aux pétales intérieurs.
feuilles, ne sont que ces dernières plus petites, perdant en partie ou en
totalité un certain nombre de leurs folioles, en même temps que la base
de leur petiole commence à se dilater.
Plus haut, les pièces du calice, c’est-à-dire les sépales (fig. 504 505)
se présentent avec une base bien plus dilatée encore en lame me’mbra-
Fleurs dans lesquelles le pêrianthe est formé de folioles
graduellement modifiées, sans délimitation nette des sépales et des pétales.
néuse ; mais les folioles latérales sont réduites à de faibles dimensions et
tendent à disparaître totalement à mesure qu’on passe des sépales inférieurs
vers les supérieurs.
Ainsi, ces folioles ou ces lobes existent souvent sur les deux bords des
deux sépales inférieurs ; le sépale intermédiaire n’en a plus que d’un
seul côté, et ils ont le plus souvent disparu sur les deux sépales supérieurs,