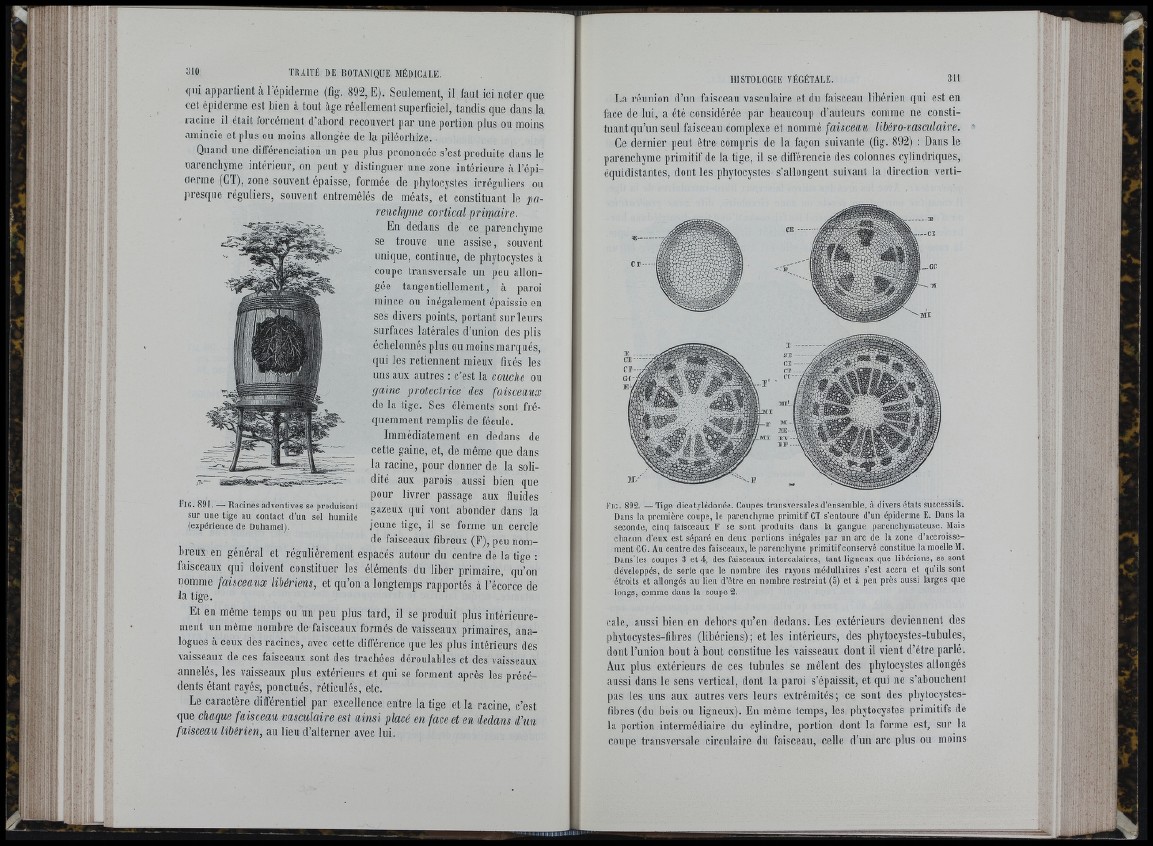
ii :
■f -T
^ÎO TUAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.
qui appartient à l ’épiderme (fig. 892, E). Seulement, il faut ici noter que
cet épiderme est bien cà tout âge réellement superficiel, tiindis que dans la
racine il était forcément d’abord recouvert par une portion plus ou moins
amincie et plus ou moins allongée de la piléorhize. .
Quand une différenciation un peu plus prononcée s’est produite dans le
Diirencbyme intérieur, on peut y distinguer une zone intérieure â l’épi-
Oerme (Cl), zone souvent épaisse, formée de pbytocystes irréguliers ou
presque réguliers, souvent entremêlés de méats, et constituant le parenchyme
cortical primaire.
En dedans de ce parenchyme
se trouve une ass ise, souvent
unique, continue, de pbytocystes â
coupe transversale un peu allongée
tangentiellement, â paroi
mince ou inégalement épaissie en
ses divers points, portant sur leurs
surfaces latérales d’union des plis
échelonnés plus ou moins miirqués,
qui les retiennent mieux fixés les
uns aux autres : c’est la couche ou
gaine protectrice des faisceaux
de la tige. Ses éléments sont fréquemment
remplis de fécule.
Immédiatement en dediins de
cette gaine, et, de même que dans
la racine, pour donner de la solidité
aux parois aussi bien que
pour livrer pcTssfige aux fluides
gazeux qui vont abonder dans la
jeune tige, il se forme un cercle
de faisceaux fibreux (F), peu nombreux
A—
Eig. 891. — Racines adventives se produisant
sur une tige au contact d’un sol humide
(expérience de Duhamel).
en général et régulièrement espacés autour du centre de la tige :
faisceaux qui doivent constituer les éléments du liber primaire, qu’on
nomme faisceaux libériens, et qu’on a longtemps rapportés â l’écorce de
la tige.
Et en même temps on un peu plus tard, il se produit plus intérieurement
un même nombre de faisceaux formés de vaisseaux primaires, analogues
â ceux des racines, avec cette différence que les plus intérieurs des
vaisseaux de ces faisceaux sont des trachées déroulables et des vaisseaux
annelés, les vaisseaux plus extérieurs et qui se forment après les précédents
étant rayés, ponctués, réticulés, etc.
Le caractère différentiel par excellence entre la tige et la racine, c’est
que chaque faisceau vasculaire est ains i placé en face et en dedans d’un
faisceau libérien, au lieu d’alterner avec lui.
La réunion d’nn faisceau vasculaire et du faisceau libérien qui est en
face de lui, a été considérée par beaucoup d’auteurs comme ne constituant
qu’un seul faisceau complexe et nommé faisceau libéro-vasculaire.
Ce dernier peut être compris de la façon suivante (fig. 892) : Dans le
parenchyme primitif de la tige, il se différencie des colonnes cylindriques,
équidistantes, dont les phytocystes s’allongent suivant la direction verti-
Eig. 892. — Tige dicotylédonée. Coupes transversales d’ensemble, à divers états successifs.
Dans la première coupe, le parenchyme primitif CT s’entoure d’un épiderme E. Dans la
seconde, cinq faisceaux F se sont produits dans la gangue parenchymateuse. Mais
chacun d’eux est séparé en deux portions inégales par un arc de la zone d’accroissement
CG. Au centre des faisceaux, le parenchyme primitif conservé constitue la moelle M.
Dans'les coupes 3 et 4, des faisceaux intercalaires, tant ligneux que libériens, se sont
développés, de sorte que le nombre des rayons médullaires s’est accru et qu’ils sont
étroits et allongés au lieu d’ctre en nombre restreint (5) et à peu près aussi larges que
longs, comme dans la coupe 2.
cale, aussi bien en dehors qu’en dedans. Les extérieurs deviennent des
phytocystes-fibres (libériens); et les intérieurs, des phytocystes-tubules,
dont l’union bout â bout constitue les vaisseaux dont il vient d’être parlé.
Aux plus extérieurs de ces tubules se mêlent des phytocystes allongés
aussi dans le sens vertical, dont la paroi s’épaissit, et qui ne s’abouchent
pas les uns aux autres vers leurs extrémités ; ce sont des phytocystes-
fibres (dn bois ou ligneux). En même temps, les phytocystes primitifs de
la portion intermédiaire du cylindre, portion dont la forme est, sur la
coupe transversale circulaire du faisceau, celle d’nn arc plus on moins