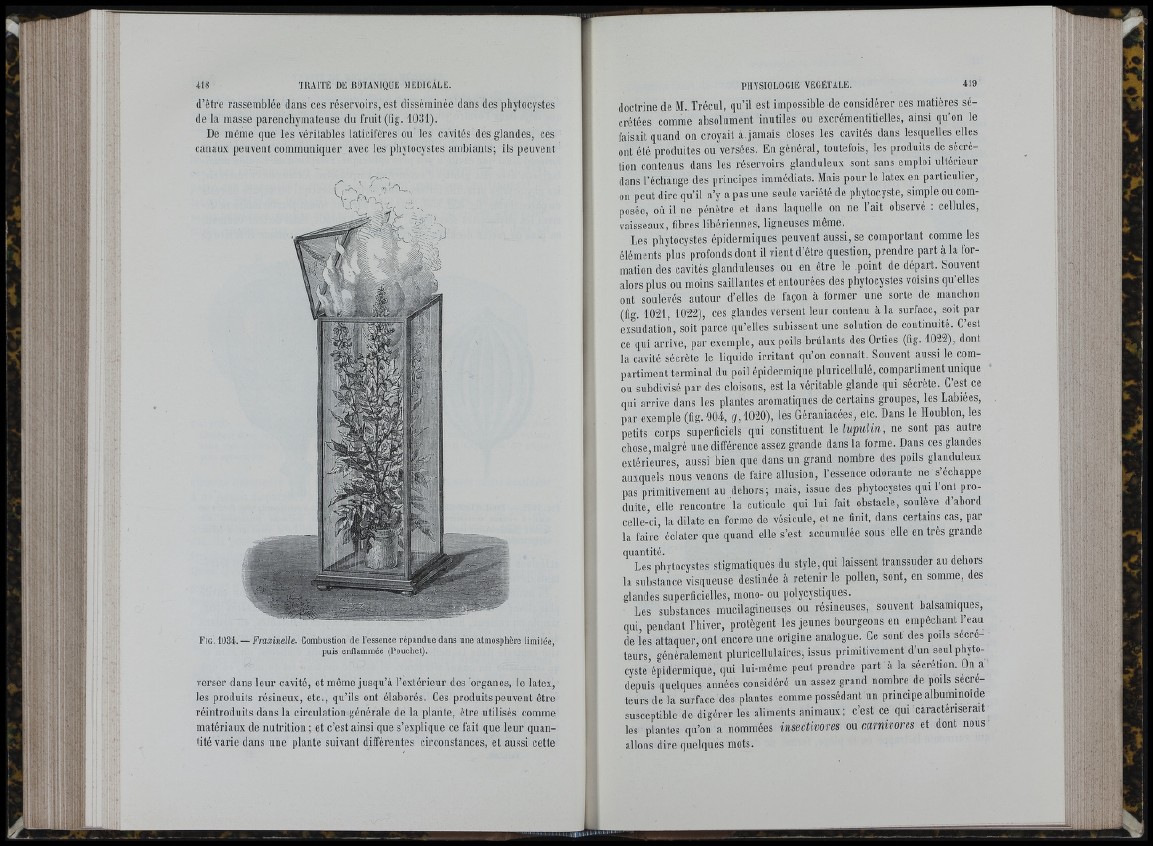
418 TIlzUTÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.
d’être rassemblée dans ces réservoirs, est disséminée dans des pbytocystes
de la masse parencbymateuse du fruit (fig. 1031).
De même que les véritables laticifères ou les cavités des glandes, ces
canaux peuvent communiquer avec les pbytocystes ambiants; ils peuvent
«îiî »1
i l
Fig. 1034. — Fraxinelle. Combustion de Tessence répandue dans une atmosphère limitée,
puis enflammée (Pouchet).
verser dans leur cavité, et même jusqu’à l’extérieur des organes, le latex,
les produits résineux, etc., qu’ils ont élaborés. Ces produits peuvent être
réintroduits dans la circulation générale de la plante, être utilisés comme
matériaux de nutrition; et c’est ainsi que s’explique ce fait que leur quantité
varie dans une plante suivant différentes circonstances, et aussi cette
doctrine de M. Trécul, qu’il est impossible de considérer ces matières sécrétées
comme absolument inutiles ou excrémentitielles, ainsi qu’on le
faisait quand on croyait à. jamais closes les cavités dans lesquelles elles
ont été produites ou versées. En général, toutefois, les produits de sécrétion
contenus dans les réservoirs glanduleux sont sans emploi ultérieur
dans l’écbange des principes immédiats. Mais pour le latex en particulier,
on peut dire qu’il n’y a pas une seule variété de phytocyste, simple ou composée,
où il ne pénètre et dans laquelle on ne l’ait observé ; cellules,
vaisseaux, fibres libériennes, ligneuses même.
Les phytocystes épidermiques peuvent aussi, se comportant comme les
éléments plus profonds dont il vient d’être question, prendre part à la formation
des cavités glanduleuses ou en être le point de départ. Souvent
alors plus ou moins saillantes et entourées des phytocystes voisins qu’elles
ont soulevés autour d’elles de façon à former une sorte de manchon
(fig. 1021, 1022), ces glandes versent leur contenu à la surface, soit par
exsudation, soit parce qu’elles subissent une solution de continuité. C’est
ce qui arrive, par exemple, aux poils brûlants des Orties (fig. 1022), dont
la cavité sécrète le liquide irritant qu’on connaît. Souvent aussi le compartiment
terminal du poil épidermique pluricellulé, compartiment unique
ou subdivisé par des cloisons, est la véritable glande qui sécrète. C’est ce
qui arrive dans les plantes aromatiques de certains groupes, les Labiées,
par exemple (fig. 004, i/,1020), les Géraniacées, etc. Dans le Houblon, les
petits corps superficiels qui constituent le lupul in, ne sont pas autre
chose, malgré une différence assez grande dans la forme. Dans ces glandes
extérieures, aussi bien que dans un grand nombre des poils glanduleux
auxquels nous venons de faire allusion, l’essence odorante ne s échappe
pas primitivement au dehors ; mais, issue des phytocystes qui 1 ont produite,
elle rencontre la cuticule qui lui fait obstacle, soulève d’abord
celle-ci, la dilate en forme de vésicule, et ne finit, dans certains cas, par
la faire éclater que quand elle s’est accumulée sous elle en très grande
quantité.
Les phytocystes stigmatiques du style, qui laissent transsuder au dehors
la substance visqueuse destinée à retenir le pollen, sont, en somme, des
glandes superficielles, mono- ou polycystiques.
Les substances mucilagineusqs ou résineuses, souvent bdsamiques,
qui, pendant l’hiver, protègent les jeunes bourgeons en empêchant l’eau
de les attaquer, ont encore une origine analogue. Ce sont des poils sécréteurs,
généralement pluricellulaires, issus primitivement d’un seul phytocyste
épidermique, qui lui-même peut prendre part à la sécrétion. On a
depuis quelques années considéré un assez grand nombre de poils secrY
teurs de la surface des plantes comme possédant un principe albuminoïde
susceptible de digérer les aliments animaux ; c’est ce qui caractériserait
les plantes qu’on a nommées insectivores ou carnivores et dont nous
allons dire quelques mots.