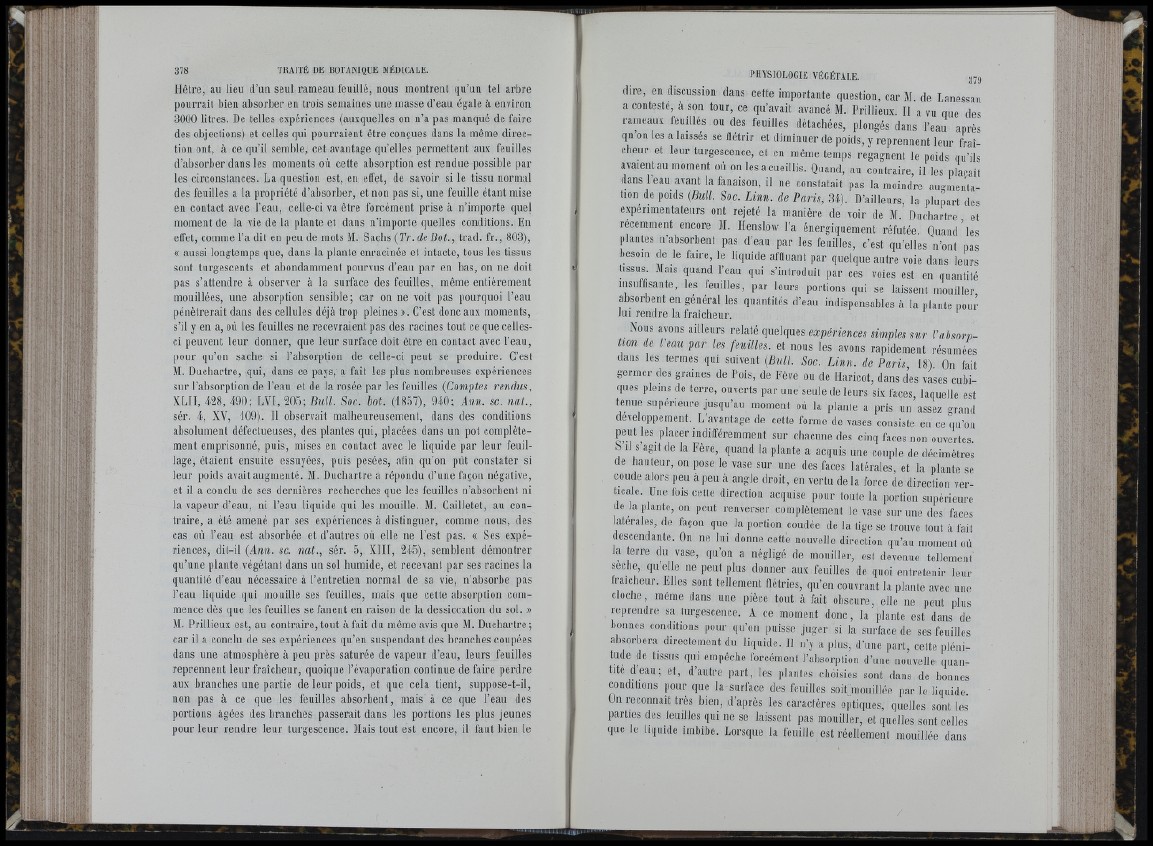
Hêtre, au lieu d’un seul rameau feuillé, nous montrent qu’un tel arbre
pourrait bien absorber en trois semaines une masse d’eau égale à environ
3000 litres. De telles expériences (auxquelles on n’a pas manqué de faire
des objections) et celles qui pourraient être conçues dans la même direction
ont, à ce qu’il semble, cet avantage qu’elles permettent aux feuilles
d’absorber dans les moments où cette absorption est rendue possible par
les circonstances. La question est, en effet, de savoir si le tissu normal
des feuilles a la propriété d’absorber, et non pas si, une feuille étant mise
en contact avec l’eau, celle-ci va être forcément prise à n’importe quel
moment de la vie de la plante et dans n’importe quelles conditions. En
effet, comme l’a dit en peu de mots M. Sacbs (Tr. de Bot., trad. fr., 803),
« aussi longtemps que, dans la plante enracinée et intacte, tous les tissus
sont turgescents et abondamment pourvus d’eau par en bas, on ne doit
pas s’attendre à observer à la surface des feuilles, même entièrement
mouillées, une absorption sensible; car on ne voit pas pourquoi Teau
pénétrerait dans des cellules déjà trop pleines». C’est donc aux moments,
s’il y en a, où les feuilles ne recevraient pas des racines tout ce que celles-
ci peuvent leur donner, que leur surface doit être en contact avec Teau,
pour qu’on sacbe si l’absorption de celle-ci peut se produire. C’est
M. Ducbartre, qui, dans ce pays, a fait les plus nombreuses expériences
sur l’absorption de Teau et de la rosée par les feuilles {Comptes rendus,
XLII, 428, 490; LVI, 205; Bull. Soc. bot. (1857), 940; Ann. sc. nat.,
sér. 4, XV, 109). Il observait malbeureusement, dans des conditions
absolument défectueuses, des plantes qui, placées dans un pot complètement
emprisonné, puis, mises en contact avec le liquide par leur feuillage,
étaient ensuite essuyées, puis pesées, afin qu’on pùt constater si
leur poids avait augmenté. M. Ducbartre a répondu d’une façon négative,
et il a conclu de ses dernières recbercbes que les feuilles n’absorbent ni
la vapeur d’eau, ni Teau liquide qui les mouille. M. Cailletet, au contraire,
a été amené par ses expériences à distinguer, comme nous, des
cas où Teau est absorbée et d’autres où elle ne Test pas. « Ses expériences,
dit-il {Ann. sc. nat., sér. 5, XIII, 2-45), semblent démontrer
qu’une plante végétant dans un sol bumide, et recevant par ses racines la
quantité d’eau nécessaire à Tentretien normal de sa vie, n’absorbe pas
Teau liquide qui mouille ses feuilles, mais que cette absorption commence
dès que les feuilles se fanent en raison de la dessiccation du sol. »
M. Prillieux est, au contraire, tout à fait du même avis que M. Ducbartre;
car il a conclu de ses expériences qu’en suspendant des brandies coupées
dans une atmosphère à peu près saturée de vapeur d’eau, leurs feuilles
reprennent leur fraîcheur, quoique l’évaporation continue de faire perdre
aux branches une partie de leur poids, et que cela tient, suppose-t-il,
non pas à ce que les feuilles absorbent, mais à ce que Teau des
portions âgées des branches passerait dans les portions les plus jeunes
pour leur rendre leur turgescence. Mais tout est encore, il faut bien le
dire, en discussion dans cette importante question, car M. de Lanessan
a contesté, à son tour, ce qu’avait avancé M. Prillieux. II a vu que des
rameaux feuillés ou des feuilles détachées, plongés dans l’eau après
qn’on les a laissés se flétrir et diminuer de poids, y reprennent leur fraîcheur
et leur turgescence, et en même temps regagnent le poids qu’ils
avalentan moment où on les acueillis. Quand, au contraire, il les plaçait
dans l’eau avant la fanaison, il ne constatait pas la moindre aogmenla-
tion de poids {Bull. Soc. Linn. de Paris , 34). D’ailleurs, la plupart des
expérimentateurs ont rejeté la manière de voir de M. Ducbartre et
récemment encore M. Henslow l’a énergiquement réfutée. Quand k e s
plantes n’absorbent pas d’eau par les feuilles, c’est qu’elles "n’ont pas
besoin de le faire, le liquide affluant par quelque autre voie dans leurs
tissus. Mais quand l’eau qui s’introduit par ces voies est en quantité
insuffisante, les feuilles, par leurs portions qui se laissent mouiller
absorbent en général les quantités d’eau indispensables à la plante pour
mi rendre la fraîcheur.
Nous avons ailleurs relaté quelques expériences simples s u r l’absorption
de l'eau par les feuilles, et nous les avons rapideraenl résumées
(tans les termes qui suivent (Bull. Soc. Linn. de Par is, 18). On fait
germer des graines de Pois, de Fève ou de Haricot, dans des vases cubiques
pleins de terre, ouverts par une seule de leurs si.v faces, laquelle est
tenue supérieure jusqu’au moment où la plante a pris un assez grand
développement. L’avantage de cette forme de vases consiste eu ce qu’on
peut les placer indilféremmeuf sur chacune des cinq faces non ouvertes,
b i l S agit de la Fève, quand la plante a acquis une couple de décimètres
de hauteur, on pose le vase sur une des faces latérales, et la plante se
coude alors peu à peu à angle droit, en vertu de la force de direction verticale.
Une fois cette direction acquise pour toute la portion supérieure
de la plante, on peut renverser complètement le vase sur une des faces
laterales, de façon que la portion coudée de la tige se trouve tout à fait
descendante. On ne lui donne cette nouvelle direction qu’au moment où
la terre du vase, qu’on a négligé de mouiller, est devenue tellement
secbe, qu’elle ne peut plus donner aux feuilles de quoi entretenir leur
iraicbeiir. Elles sont tellement flétries, qu’en couvrant la plante avec une
cloche, même dans une pièce tout à fait obscure, elle ne peut plus
reprendre sa Uirgesceace. A ce moment donc, la plante est dans de
bonnes conditions pour qu’on puisse juger si la surface de ses feuilles
a b ^ rb e r a directement du liquide. Il u’y a plus, d’uue part, celte plénitude
de tissus qui empêche forcément l ’absorption d’une nouvelle quantité
d’eau; et, d’autre part, les plantes choisies sont dans de bonnes
c^anditions pour que la surface des feuilles soiLmouillée par le liquide.
On reconnaît très bien, d’après les caractères optiques, quelles sont les
parties des feuilles qui ne se laissent pas mouiller, et quelles sont celles
que le liquide imbibe. Lorsque la feuille est réellement mouillée dans