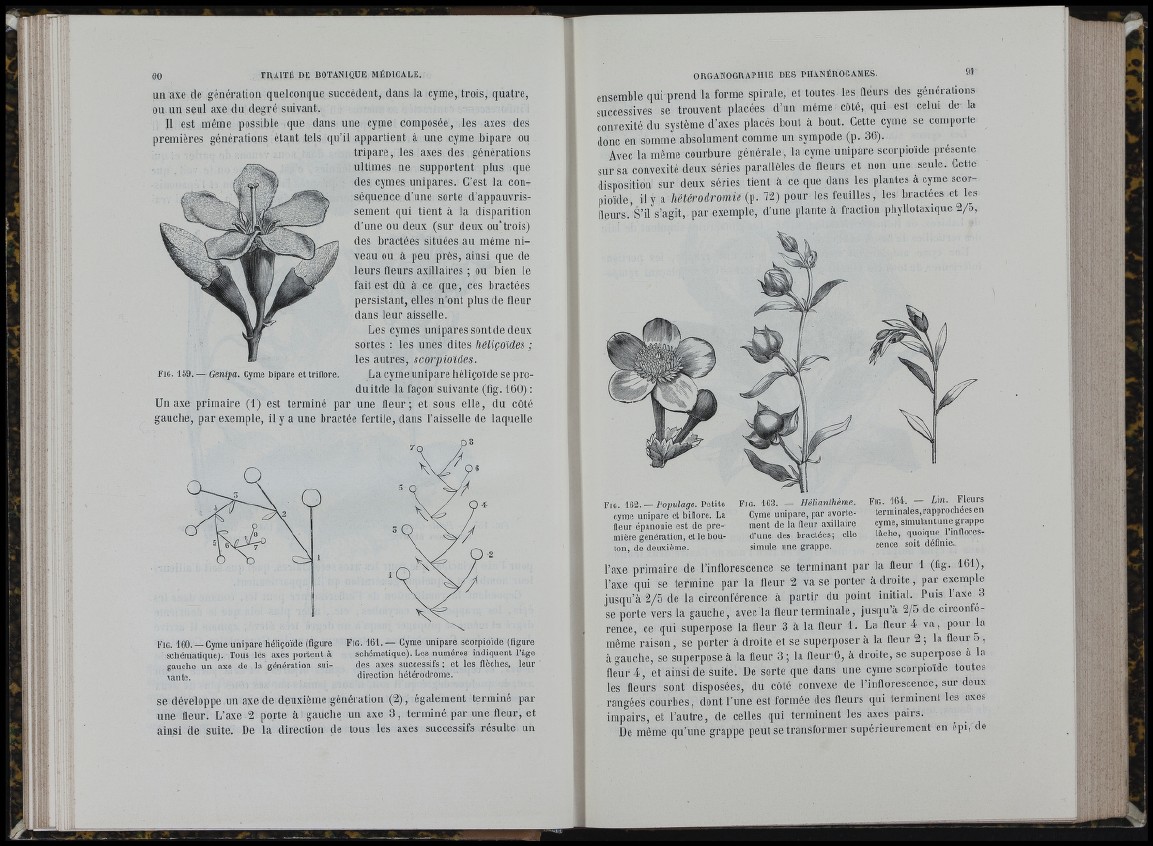
un axe de génération quelconque succèdent, dans la cyme, trois, quatre,
ou un seul axe du degré suivant.
Il est même possible que dans une cyme composée, les axes des
premières générations étant tels qu’il appartient à une cyme bipare ou
tripare, les axes des générations
ni limes ne supportent plus que
des cymes unipares. C’est la conséquence
d’une sorte d’appauvrissement
qui tient à la disparition
d’une ou deux (sur deux oii‘trois)
des bractées situées au même niveau
ou à peu près, ainsi que de
leurs fleurs axiliaires ; ou bien le
fait est dû à ce que, ces bractées
persistant, elles n ’ont plus de fleur
dans leur aisselle.
Les cymes unipares sont de deux
sortes : les unes dites héliçoïdes ;
les autres, scorpioïdes.
La cyme unipare béliçoïde se pro-
du itde la façon suivante (fig. 160) :
Un axe primaire (1) est terminé par une fleur; et sous elle, du côté
gauche, par exemple, il y a une bractée fertile, dans l’aisselle de laquelle
Eig. 160. — Cyme unipare héliçoïde (figure
schématique). Tous les axes portent à
gauche un axe de la génération suivante.
Fig. 161. — Cyme unipare scorpioïde (figure
schématique). Les numéros indiquent l’âge
des axes successifs ; et les flèches, leur
direction hétérodrome.
se développe un axe de deuxième génération (2), également terminé par
une fleur. L’axe 2 porte à gaucbe un axe 3 , terminé par une fleur, et
ainsi de suite. De la direction de tous les axes successifs resuite un
ensemble qui prend la forme spirale, et toutes les fleurs des générations
successives se trouvent placées d’un même côté, qui est celui de la
convexité du système d’axes placés bout à bout. Gette cyme se comporte
donc en somme absolument comme un sympode (p. 36).
Avec la même courbure générale, la cyme unipare scorpioïde présente
sur sa convexité deux séries parallèles de fleurs et non une seule. Cette
disposition sur deux séries tient à ce que dans les plantes à cyme scorpioïde,
il y a hétérodromie (p. 72) pour les feuilles, les bractées et les
fleurs.'s’il s’agit, par exemple, d’une plante à fraction phyllotaxique 2/5,
F i g . 162. — Populage. Petite
cyoee unipare et biflore. La
fleur épanouie est de première
génération, et le bouton,
de deuxième.
F i g . 163. — Ilélianthème .
Gyme unipare, par avortement
de la fleur axillaire
d’une des bractées; elle
simule une grappe.
F ig . 164. — L in . Fleurs
terminales, rapprochées en
cyme, simulant une grappe
lâche, quoique l’inflorescence
soit définie.
l’axe primaire de l’inflorescence se terminant par la fleur 1 (fig. 161),
l’axe qui se termine par la fleur 2 va se porter à d roite , par exemple
j u s q u ’à 2/5 de la circonférence à partir du point initial. Puis 1 axe 3
se porte vers la gaucbe, avec la fleur terminale, jusqu’à 2/5 de circonférence,
ce qui superpose la fleur 3 à la fleur 1. La fleur 4 va , pour la
même raison, se porter à droite et se superposer à la fleur 2 ; la fleur 5 ,
à gaucbe, se superpose à la fleur 3 ; la fleur 6, à droite, se superpose à la
fleur 4 , et ainsi de suite. De sorte que dans une cyme scorpioïde toutes
les fleurs sont disposées, du côté convexe de l’inflorescence, sur deux
rangées courbes, dont l’une est formée des fleurs qui terminent les axes
impairs, et l’autre, de celles qui terminent les axes pairs.
De même qu’une grappe peut se transformer supérieurement en épi, de