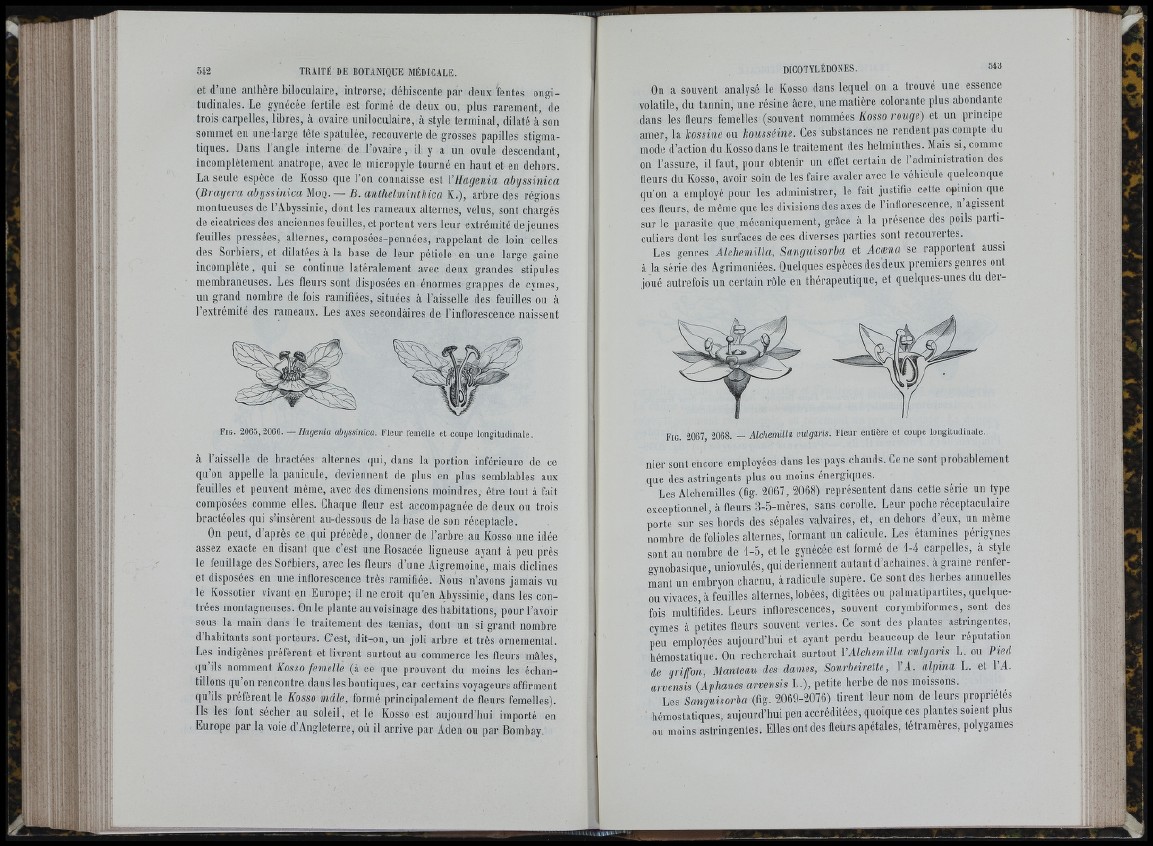
%5!
4
■4
!"
et d’une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux 'fentes ongi-
tudinales. Le gynécée fertile est formé de deux ou, plus rarement, de
trois carpelles, libres, à ovaire uniloculaire, cà style terminal, dilaté à son
sommet en une-large tête spalulée, recouverte de grosses papilles stigmatiques.
Dans l ’angle interne de l’ovaire, il y a un ovule descendant,
incomplètement amatrope, avec le micropyle tourné en haut et en dehors.
La seule espèce de Kosso que l’on coniuaisse est VHagenia abyssinica
(Brayera abyssinica Moq . — B. anthelminthica K.), arbre des régions
mon tueuses de l’Abyssinie, dont les rameaux alternes, velus, sont chargés
de cicatrices des anciennes feuilles, et portent vers leur extrémité de jeunes
feuilles pressées, alternes, composées-pennées, rappelant de loin celles
des Sorbiers, et dilatées à la base de leur pétiole en une large gaine
incomplète, qui se continue latéralement avec deux grandes stipules
membraneuses. Les fleurs sont disposées en énormes grappes de cymes,
un grand nombre de fois ramifiées, situées à l’aisselle des feuilles'ou à
l’extrémité des riimeaux. Les axes secondaires de l’inflorescence naissent
Fig. 2065, 2066. — //«ifenta abyssinica. F le u r femelle et coupe longitudinale.
à l’caisselle de bractées iilternes qui, dans la portion inférieure de ce
qu’on appelle la panicule, deviennent de plus en plus semblables aux
feuilles et peuvent même, avec des dimensions moindres, être tout à fait
composées comme elles. Chaque fleur est accompagnée de deux ou trois
bractéoles qui s’insèrent au-dessous de la base de son réceptacle.
On peut, d’après ce qui précède, donner de l’arbre au Kosso une idée
assez exacte en disant que c’est une Rosacée ligneuse ayant à peu près
le feuillage des Sorbiers, avec les fleurs d’une Aigremoine, mais diclines
et disposées en une inflorescence très ramifiée. Nous n’avons jamais vu
le Kossotier vivant en Europe; il ne croît qu’en Abyssinie, dans les contrées
montagneuses. On le plante au voisinage des habitations, pour l’avoir
sous la main dans le traitement des tænias, dont un si grand nombre
d habitants sont porteurs. G’est, dit-on, un joli arbre et très ornemental.
Les indigènes préfèrent et livrent surtout au commerce les fleurs mâles,
qu’ils nomment Kosso femelle (à ce que prouvent du moins les échantillons
qu’on rencontre dans les boutiques, car certains voyageurs affirment
qu’ils préfèrent le Kosso mâle, formé principalement de fleurs femelles).
Ils les font sécher au soleil, et le Kosso est aujoiird’bui importé en
Europe par la voie d’Angleterre, où il arrive par Aden ou par Rombay.
On a souvent analysé le Kosso dans lequel on a trouvé une essence
volatile, du tannin, une résine âcre, une matière colorante plus abondante
dans les fleurs femelles (souvent nommées Kosso rouge) et un principe
amer, la Iwssine ou kousséine. Ges substances ne rendent pas compte du
mode d ’action du Kosso dans le traitement des helminthes. Mais si, comme
on l ’assure, il faut, pour obtenir nn eifet certain de l’administration des
fleurs du Kosso, avoir soin de les faire avaler avec le véhicule quelconque
qu’on a employé pour les administrer, le fait justifie celte opinion que
ces fleurs, de même que les divisions des axes de l’inflorescence, n agissent
sur le parasite que mécaniquement, grâce a la présence des poils paiti-
culiers dont les surfaces de ces diverses parties sont recouvertes.
Les genres Alchemilla, Sanguisorba et Acoena se rapportent aussi
à la série des Agrimoniées. Quelques espèces des deux premiers genres ont
joué autrefois un certain rôle en thérapeutique, et quelques-unes du deinier
sont encore employées dans les pays chauds. Gene sont probablement
que des astringents plus ou moins énergiques.
Les Alchemilles (fig. 2067, 2068) représentent dans cette série un type
exceptionnel, à fleurs 3-5-mères, sans corolle. Leur poche réceptaculaire
porte sur ses bords des sépales valvaires, et, en dehors d’eux, un même
nombre de folioles alternes, formant un calicule. Les étamines périgynes
sont au nombre de 1-5, et le gynécée est formé de 1-4 carpelles, à style
gynobasique, uniovulés, qui deviennent autant d’achaines. à graine renfermant
un embryon charnu, à radicule supère. Ge sont des herbes annuelles
ou vivaces, à feuilles alternes, lobées, digitées ou palmatipartites, quelquefois
multifides. Leurs inflorescences, souvent corymbiformes, sont des
cymes à petites fleurs souvent vertes. Ge sont des plantes astringentes,
peu employées aujourd’hui et ayant perdu beaucoup de leur réputation
hémostatique. On recherchait surtout VAlchemilla vulgaris L. ou Pied
de griffon. Manteau des dames, Sourbeirette, l’A. alpina L. et l’A.
arvensis (Aphanes arvensis L.), petite herbe de nos moissons.
Les Sanguisorba (fig. 2069-2076) tirent leur nom de leurs propriétés
hémostatiques, a u j o u r d ’ h u i peu accréditées, quoique ces plantes soient plus
ou moins astringentes. Elles ont des fleurs apétales, tétramères, polygames