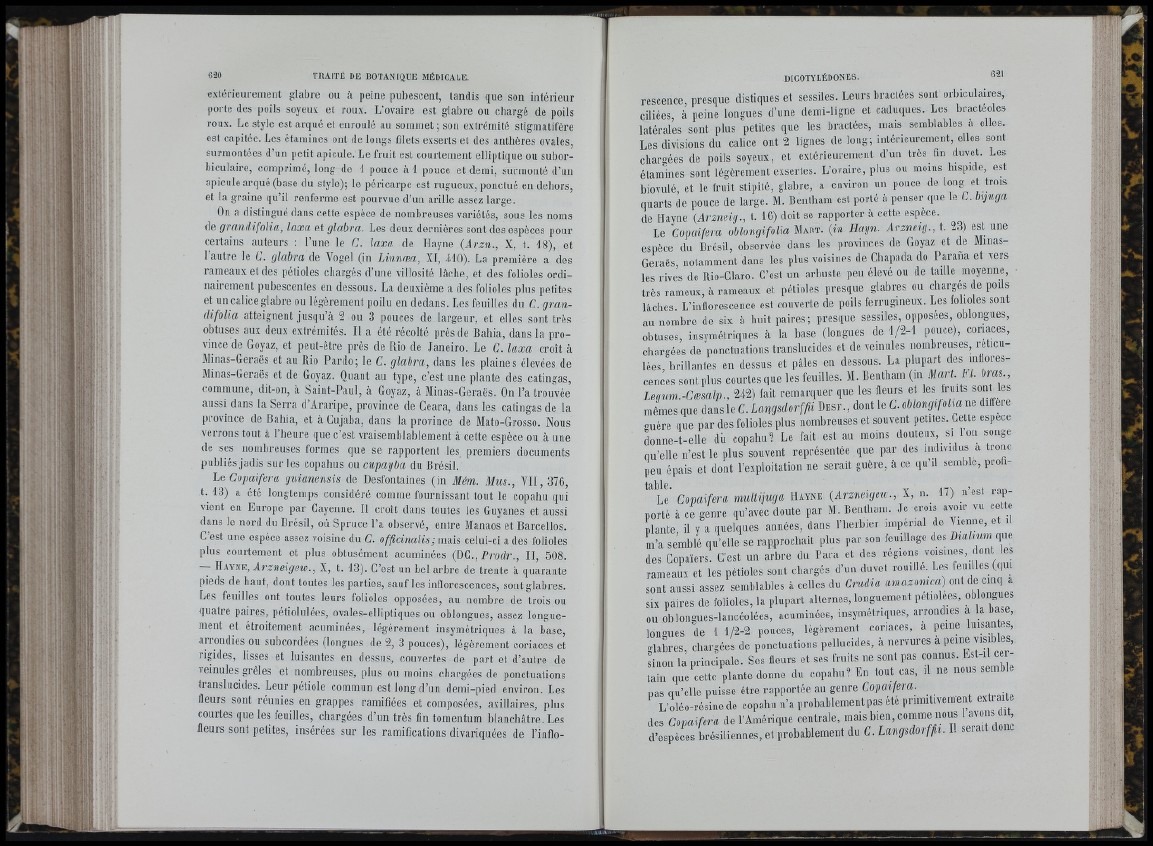
i i i d M
..ia .
m
■J
: t
extérieurement glabre ou à peine pubescent, tandis que son intérieur
porte des poils soyeux et roux. L’ovaire est glabre ou cbargé de poils
roux. Le style est arqué et enroulé au sommet ; son extrémité stigmatifère
est capitée. Les étamines ont de longs filets exserts et des anthères ovales,
surmontées d’un petit apiculé. Le fruit est courtement elliptique ou subor-
biculaire, comprimé, long de 1 pouce cà 1 pouce et demi, surmonté d’un
apiculé arqué (base du style); le périccarpe est rugueux, ponctué en dehors,
et la graine qu’il renferme est pourvue d’un arille assez large.
On a distingué dans cette espèce de nombreuses variétés, sous les noms
de grandifolia, laxa et glabra. Les deux dernières sont des espèces pour
certains auteurs : l’une le C. laxa de Hayne (Ar zn. , X, t. 18), et
l’autre le C. glabra de Vogel (in Linnoea, XI, 410). La première a des
rameaux et des pétioles chargés d’une villosité lâche, et des folioles ordinairement
pubescentes en dessous. La deuxième a des folioles plus petites
et un calice gliibre ou légèrement poilu en dedans. Les feuilles du C. grandifolia
catteignent jusqu’à 2 ou 3 pouces de largeur, et elles sont très
obtuses eaux deux extrémités. Il a été récolté près de Bahia, dans la province
de Goyaz, et peut-être près de Rio de Janeiro. Le C. laxa croît à
Minas-Geraës et au Rio Pardo; le C. glabra, dans les plaines élevées de
Minas-Geraës et de Goyaz. Quant au type, c’est une plante des catingas,
commune, dit-on, à Saint-Paul, à Goyaz, à Minas-Geraës. On l’a trouvée
iiiissi dcans la Serra d’Arcaripe, province de Geara, dans les catingas de la
province de Babia, et à Gujiiba, dans la province de Mato-Grosso. Nous
verrons tout à l’heure que c’est vraisemblablement à cette espèce ou à une
de ses nombreuses formes que se rapportent les premiers documents
publiés jadis sur les copahus ou cupaijba du Brésil.
Le Copaifera guianensis de Desfontaines (in Mém. Mus., VII, 376,
t.^ 13) a été longtemps considéré comme fournissant tout le copahu qni
vient en Europe par Gayenne. H croît dans toutes les Guyanes et aussi
dc^s le nord du Brésil, où Spruce l’a observé, entre Manaos et Biircellos.
G est une espèce assez voisine du C. officinalis; mais celui-ci a des folioles
plus courtement et plus obtusément acuminées (RG., Prodr., II, 508.
— GAYKE, Arzneigew., X, t. 13). G’est un bel arbre de trente à quarante
pieds de haut, dont toutes les parties, sauf les inflorescences, sont glabres.
Les feuilles ont toutes leurs folioles opposées, au nombre de trois ou
qufitre paires, pétiolulées, oviiles-elliptiques ou oblongues, assez longuement
et étroitement acuminées, légèrement insymétriques à la base,
arrondies ou subcordées (longues de 2, 3 pouces), légèrement coriaces et
rigides, lisses et luisantes en dessus, couvertes de part et d’autre de
veinules grêles et nombreuses, plus ou moins chargées de ponctuations
translucides. Leur pétiole commun est long d’un demi-pied environ. Les
fleurs sont réunies en grappes ramifiées et composées, axiliaires, plus
courtes que les feuilles, chargées d’un très fin tomentum blanchâtre. Les
fleurs sont petites, insérées sur les ramifications divariquées de l’inflorescence,
presque distiques et sessiles. Leurs bractées sont orbiculaires,
ciliées, à peine longues d’une demi-ligne el caduques. Les brac.teoles
latérales sont plus petites que les bractées, mais semblables à elles.
Les divisions du calice ont 2 lignes de long; intérieurement, elles sont
chargées de poils soyeux, et extérieurement d’un très fm duvet. Les
étam'ines sont légèrement exsertes. L’ovaire, plus ou moins hispide, est
biovulé, et le fruit stipité, glabre, a environ un pouce de long et trois
quarts de pouce de large. M. Bentham est porté à penser que le G. bijuga
de Hayne (Arzneig., t. 16) doit se rapporter à cette espèce.
Le Copaifera oblongifolia Ma r t , (in Hayn. Ar zneig., t. 2 3 ) est une
espèce du Brésil, observée dans les provinces de Goyaz et de Minas-
Geraës, notamment dans les plus voisines de Gbapada do Parana et vers
les rives de Rio-Glaro. G’est un arbuste peu élevé ou de taille moyenne,
très rameux, à rameaux et pétioles presque glabres ou chargés de poils
lâches. L’inllorescence est couverte de poils ferrugineux. Les folioles sont
au nombre de six à buit paires; presque sessiles, opposées, oblongues,
obtuses, insymétriques à la base (longues de 1/2-1 pouce), cor i^es,
chargées de ponctuations translucides et de veinules nombreuses, i eticu-
lées, brillantes en dessus et pâles eu dessous. La plupart ctes ml ores-
cences soutplus courtes que les feuilles. M. Bentham (m Ma r t p . bras.,
Legum.-Coesalp., 2 4 2 ) fait remarquer que les fleurs et les frmts sont les
mêmes que dans le C. Langsdorffii D e s f . , dont le C. oblongifolia ne différé
guère que par des folioles plus nombreuses et souvent petites. Gette espece
donne-t-elle dù copahu? Le fait est au moins douteux si 1 on songe
qu’elle n ’est le plus souvent représentée que par des individus a troim
peu épais et dont l’exploitation ne serait guère, à ce qu il semble, profiîrIdIg
7
Le' Copaifera muUijuga H a v n e (Arzneigew., X, n._ 17) n’est rapporté
à ce genre qu’avec doute par M. Bentham. Je crois avoir vu cet e
plante, il y a quelques années, dans l’berbier imperial de t ienne ,
m’a semblé qu’elle se rapprochait plus par son feuillage des Dialium que
des Gopaïers. G’est un arbre du Para et des régions voisines, dont les
rameaux et les pétioles sont chargés d’un duvet rouillé. Les
sont aussi assez semblables à celles du Crwiia amaloinca) out ^
six paires do folioles, la plupart alternes, longuement petmlees, «W“ »“®®
ou oblongues-lancéolées, acuminées, insjmétriques, arrondies a la base
longues de I 1/2-2 pouces, légèrement coriaces, a peine ‘«>san e ,
glataes, chargées de ponctuations pellucides, à nervures a 1’%® " “ %
L o n la principale. Ses fleurs et ses fruits ne sont pas connus. Est-.l certain
qne cette plante donne du copahu? En tout cas, il ne nous semble
pas qu’elle puisse être rapportée au genre Copaifera.
L’L o - r é s in e de c o p a h u n ’a probablementpas ete primitivement exl a ie
des Copaifera de l’Amérique cenirale, mais bien, comme nous avons d L
d’espèces brésiliennes, et probablement du C. Laagsiorffit. 11 seiait doue