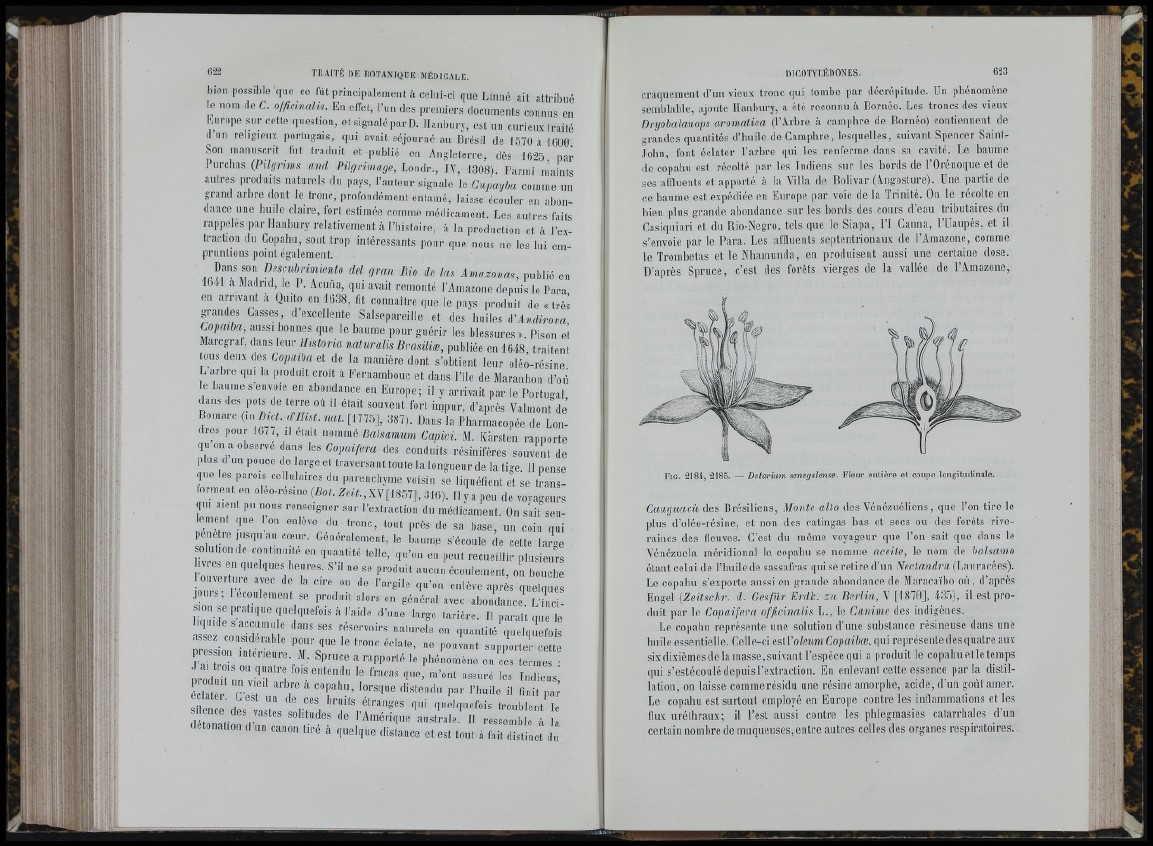
;.;í «fU
bien possible'que ce fut principalement à celni-d que Liimé ait attribué
le nom de C. of í imialü. En effet, l'un des premiers documents connus cn
Europe sur cette question, et signalé par D. Hanbury, est un curieux traité
d un religieux portugais, qui avait séjourné au Brésil de 1570 à 1600
Son manuscrit fut traduit et public eu Angleterre, dès 1025 pa)
Piirclias (PtUjnnis and Pügrimarjé, Londr., IV, 1308). Parmi niaints
antres produits iialurels du pays, l ’auteur signale le Cupayla comme un
grand arbre dont le tronc, profondément entamé, laisse écouler en alion-
dance une huile claire, fort estimée comme médicament. Les autres faits
rappelés par Hanbury relativement à l ’instoire, k la production et à l’extraction
du Copahu, sont trop inléressanls pour quo nous ne les lui em-
priintions point également.
Amazonas , publié en
lO-rl a Madrid, le P. Acuna, qui avait remonté l ’Amazone depuis le Para
en arrivant à Quito en 1638, fit connaître que le pays produit de « trè)
grandes Casses, d’excellente Salsepareille et des huiles A'Ani irova
Copaiha aussi bonnes que le baume pour guérir les blessures ». Pison et
Marcgraf, dans leur Historia naturalis Brasiliæ, publiée en 1648 traitent
tous deiLv des Copaiba et de la manière dont s’obtient leur oléo-résine.
L arbre qui la produit croît à Fernambouc et daus l’Ile de Maranlioii d’oii
le baume s envoie eu abondance eu Europe; il y arrivait par le Portugal
dans des pots de terre ou il était souvent fort impur, d’après Valmont de
Boinare Oo Btct. d'Hist. ««i. [177,5], 387). Daus la Pharmacopée de Londres
poui 1677, il était nommé Balsamum Capivi. M. Kàrsteii rapporte
qu on a observe dans les Copaifera des conduits résinifères souvent de
plus d uu pouce de large et traversant toute la longueur de la tige. 11 pense
que les parois cellulaires du parenchyme voisin sc liquéfient et se trans-
lormenten oleo-résine (Boi./ » « . , .VV[.I857]. 316). I ly a p e u de voyageurs
qu. aient pu nous rensoiguer sur l ’extracliou du médicament. On sait seulement
que Ion enlève du tronc, tout près de sa base, un coin qui
penetre jiisqu au coeur. Gcneralement, le baume s’écoule de celte large
solulionde coul.nu.té en quaulité telle, qu’on en peut recueillir plusieurs
ivres en quelques heures. S’il ne se produit aucun écoulement, on bouche
ouverture avec de la d r e on de l’argile qu’ou enlèvo apr)s q i i e t a u j
.loiiis; I écoulement sc produit alors cn général avec abondance L’L i -
m„ se pratique quelquefois à l’aide d’une large tarière. 11 pa/alt qu Te
Kiu.de s’accumu e dans ses réservoirs na.urers en quantitéT uTlqüdoll
assez^ considerable pour que le tronc éclate, ne pouvant supporter cette
î ’aTh.T’'s le phénomène en ces termes ■
.1 a trois ou quatre fois eulendu le fracas que, m’ont assuré les IncUenV
iTTatëi “c ’e™‘!i,rTta * “ tciater. 0 est un de ces rb'r™uits’ 'é°t'r' "an' “ge s qui quef®lq’u’ efois troublent p l/e
silence des vastes solitudes de l ’Amérique australe II res embte I
.letonaliou d’un canon tiré à quelque distance et est tout à f Z H Z d 4
craquement d’un vieux tronc qui tombe par décrépitude. Un phénomène
semblable, ajoute Hanbury, a été reconnu à Bornéo. Les troncs des vieux
Dryobalanops aromatica (l’Arbre à camphre de Bornéo) contiennent de
grandes quantités d’huile de Camphre, lesquelles, suivant Spencer Saint-
.Tohn, font éclater Tarbre qui les renferme dans sa cavité. Le baume
de copahu est récolté par les Indiens sur les bords de TOrénoque et de
ses affluents et apporté à la Yilla de Bolivar (Angosture). Une partie de
ce baume est expédiée en Europe par voie de la Trinité. On le récolte en
bien plus grande abondance sur les bords des cours d’eau tributaires dn
Gasiquiari et du Rio-Negro, tels qne le Siapa, TI Canna, TUaupès, et il
s’envoie par le Para. Les affluents septentrionaux de l’Amazone, comme
le Trombetas et le Nbamunda, en produisent aussi une certaine dose.
D’après Sprnce, c’est des forêts vierges de la Vtallée de l’Amazone,
Fig. 2184, 2185. — Detarium senegalense. Fleur entière et coupe longitudinale.
Caaguacù des Brésiliens, Monte alto des Vénézuéliens, que Ton tire le
plus d’oléo-résine, et non des catingas bas et secs ou des forêts riveraines
des fleuves. C’est du même voyageur que Ton sait qne dans le
Vénézuela méridional le copahu se nomme aceite, le nom de balsamo
étant celui de Thuile de sassafras qui se retire d’un Nectandra (Lauracées).
Le copahu s’exporte aussi en grande abondance de Maracaïbo o ù , d’après
Engel (Zeitschr. d. Gesfür Èrdk. z u Berlin, V [1870], 435), il est produit
par le Copaifera officinalis L., le Canime des indigènes.
Le copahu représente uae solution d’une substance résineuse dans une
huile essentielle. Celle-ci eslVoleumCopaibæ, qui représente des quatre aux
six dixièmes de la masse, suivant Tespècequi a produit le copahu et le temps
qui s’est écoulé depuis l’extraction. En enlevant cette essence p a r l a distillation,
on laisse comme résidu une résine amorphe, acide, d’un goût amer.
Le copahu est surtout employé en Europe contre les inflammations et les
flux urélhraux; il Test aussi contre les phlegmasies catarrhales d’un
certain nombre de muqueuses, entre autres celles des organes respiratoires.