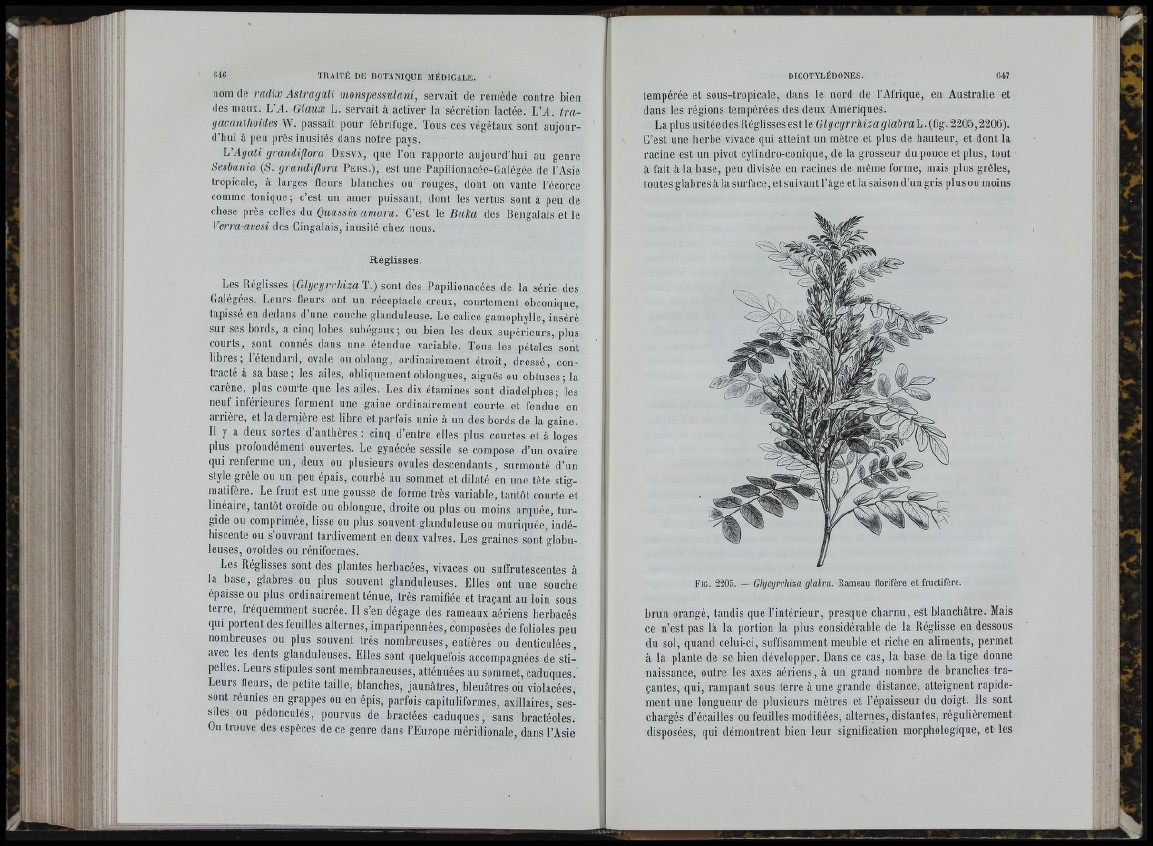
i i
tiom de radix Astragali monspessulani, servait, de remède contre bien
des maux. L’A. Glaux L. servait à activer la sécrétion lactée. L’A. tra-
gacanthoides W. passait pour fébrifuge. Tous ces végétaux sont aujourd’bui
à peu près inusités dans notre pays.
L ’Agali grandiflora D e s v x , que l ’on rapporte aujourd’bui au genre
Sesbania (S. grandiflora P e r s . ) , est une Papilionacée-Galégée de l’Asie
tropicale, cà larges fleurs blancbes ou rouges, dont on vante l’écorce
comme tonique; c’est un amer puissant, dont les vertus sont à peu de
cbose près celles du Quassia amara. C’est le Buka des Bengalais et le
Verra-avesi des Cingalais, inusité cbez nous.
R ég lisse s.
Les Réglisses (Glycyrrhiza T.) sont des Papilionacées de la série des
Gcalégées. Leurs fleurs ont un réceptacle creux, courtement obconique,
tapissé en dedans d’une concbe glanduleuse. Le calice gamopbylle, inséré
sur ses bords, a cinq lobes subégiiux; ou bien les deux supérieurs, plus
courts, sont connés dcans une étendue variable. Tous les pétales sont
libres; l’étendard, ovale ou oblong, ordinairement étroit, dressé, contracté
à sa base; les ailes, obliquement oblongues, aiguës ou obtuses; la
carène, plus courte que les ailes. Les dix étamines sont diadelpbes; les
neuf inférieures forment une gaine ordinairement courte et fendue en
carrière, et la dernière est libre et parfois unie à un des bords de la gaine.
Il y a deux sortes d’antbères : cinq d’entre elles plus courtes et à loges
plus profondément ouvertes. Le gynécée sessile se compose d’un ovaire
qui renferme un, deux ou plusieurs ovules descendants, surmonté d’un
style grêle ou un peu épais, courbé au sommet et dilaté en une tête stigmatifère.
Le fruit est une gousse de forme très Vcariable, tantôt courte et
linéaire, tantôt ovoïde ou oblongue, droite ou plus ou moins arquée, turgide
ou comprimée, lisse ou plus souvent glanduleuse ou muriquée, indébiscente
ou s ouvrant tardivement en deux valves. Les graines sont globuleuses,
ovoïdes ou réniformes.
Les Réglisses sont des plantes herbacées, vivaces ou suffrutescentes à
la bcase, glabres ou plus souvent glanduleuses. Elles ont une souche
épaisse ou plus ordincairement ténue, très ramifiée et traçant au loin sous
terre, fréquemment sucrée. Il s’en dégage des rameaux aériens herbacés
qui portent des feuilles alternes, imparipennées, composées de folioles peu
nombreuses ou plus souvent très nombreuses, entières ou denticulées,
avec les dents glanduleuses. Elles sont quelquefois accompagnées de stipelles.
Leurs stipules sont membraneuses, atténuées au sommet, caduques.
Leurs fleurs, de petite taille, blanches, jaunâtres, bleuâtres où violacées,
sont réunies en grappes ou en épis, parfois capituliformes, axiliaires, sessiles
ou pédonculés, pourvus de bractées caduques, sans bractéoles.
On trouve des espèces de ce genre dans l’Europe méridionale, dans l ’Asie
tempérée et sous-tropicale, dans le nord de l’Afrique, en Australie et
dans les régions tempérées des deux Amériques.
La plus usitée des Réglisses est le Glycyrrhiza glabra L . (fig. 2205,2206).
C’est une herbe vivace qui atteint un mètre et plus de hauteur, et dont la
racine est un pivot cylindro-conique, de la grosseur du pouce et plus, tout
à fait à la base, peu divisée en racines de même forme, mais plus grêles,
toutes glabres à la surface, et suivant Tâge et la saison d’un gris plus ou moins
Fig. 2205. — Glycyrrhiza ylabra. Rameau florifère el fructifère.
brun orangé, tandis que l’intérieur, presque charnu, est blanchâtre. Mais
ce n’est pas là la portion la plus considérable de la Réglisse en dessous
du sol, quand celui-ci, suffisamment meuble et riche en aliments, permet
à la plante de se bien développer. Dans ce cas, la base de la tige donne
naissance, outre les axes aériens, à un grand nombre de branches traçantes,
qui, rampant sous terre à une grande distance, atteignent rapidement
une longueur de plusieurs mètres et l’épaisseur du doigt. Ils sont
chargés d’écailles ou feuilles modifiées, alternes, distantes, régulièrement
disposées, qui démontrent bien leur signification morphologique, et les
■m-
■k