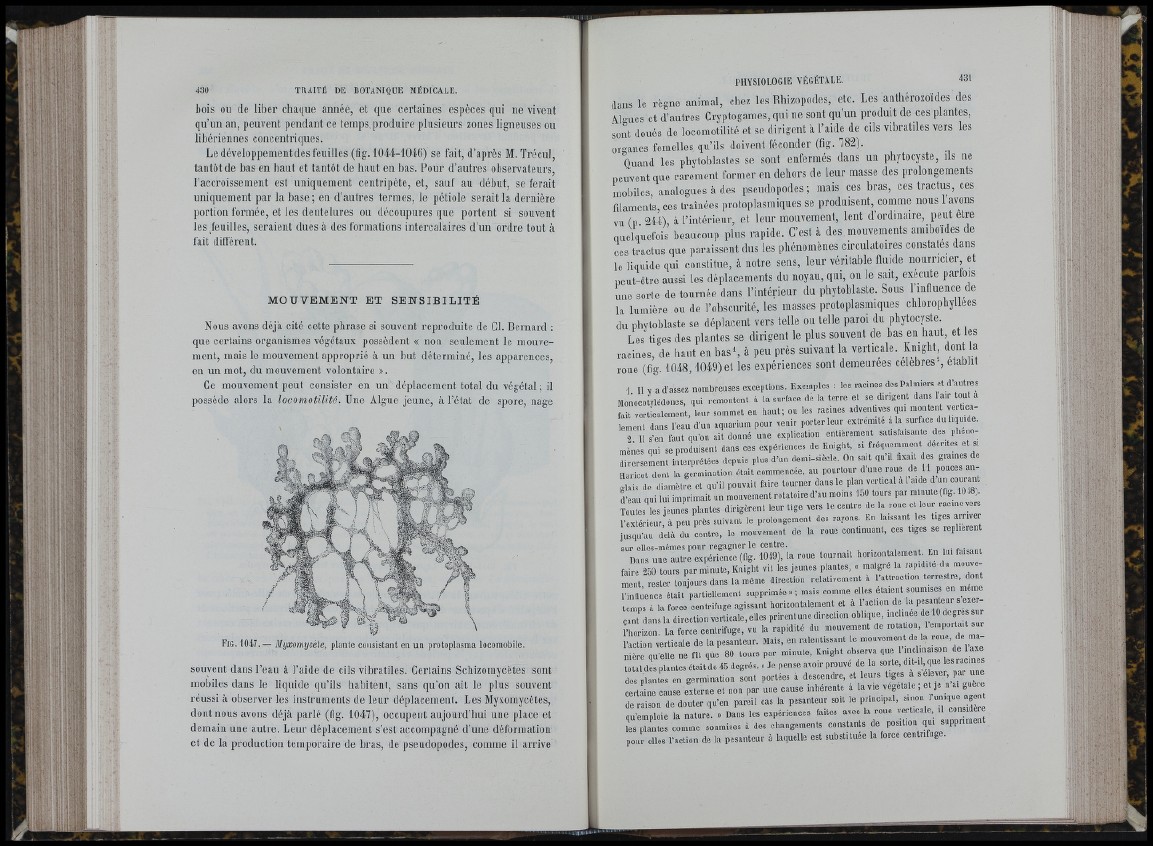
Ml
'1.
N l i p i
i
bois OU de liber chaque année, et que certaines espèces qui ne vivent
qu’un an, peuvent pendant ce temps,produire plusieurs zones ligneuses on
libériennes concentriques.
Le développement des feuilles (fig. 1044-1046) se fait, d’après M. Trécul,
tantôt de bas en haut et tantôt de haut en bas. Pour d’antres observateurs,
l’accroissement est uniquement centripète, et, sauf au début, se ferait
uniquement par la base ; en d’antres termes, le pétiole serait la dernière
portion formée, et les dentelures on découpures que portent si souvent
les feuilles, seraient dues à des formations intercalaires d’un ordre tout à
fait différent.
M O U V EM E N T ET S E N S I B I L I T É
Nous avons déjà cité cette phrase si souvent reproduite de Cl. Bernard :
que certains organismes végétaux possèdent « non seulement le mouvement,
mais le mouvement approprié à un but déterminé, les apparences,
en un mot, du mouvement volontaire ».
Ce mouvement peut consister en un déplacement total dn végétal ; il
possède alors la locomotilité. Une Algue jeune, à l’état de spore, nage
Fig . i0 4 7 .— Myxomycète, plante consistant en u n protoplasma locomobile.
souvent dans l ’eau à l’aide de cils vibrátiles. Certains Schizomycètes sont
mobiles dans le liquide qu’ils habitent, sans qu’on ait le plus souvent
réussi à observer les instruments de leur déplacement. Les Myxomycètes,
dont nous avons déjà parlé (fig. 1047), occupent aujourd’hui une place et
demain une autre. Leur déplacement s’est accompagné d’une déformation
et de la production temporaire de bras, de pseudopodes, comme il arrive
dans le règne animal, chez les Bhizopodes, etc. Les anthérozoïdes des
Ateues et d’autres Cryptogames, qui ne sont qu’un produit de ces plantes,
sont doués de locomotilité et se dirigent à l’aide de cils vibrátiles vers les
or»anes femelles qu’ils doivent féconder (fig. 782).
Quand les phytoblastes se sont enfermés dans un phytocyste, ils ne
peuvent que rarement former en dehors de leur masse des prolongements
mobiles, analogues à des pseudopodes ; mais ces bras, ces tractus, ces
filaments, ces traînées protoplasmiques se produisent, comme nous 1 avons
vu (p 244) à l’intérieur, et leur mouvement, lent d’ordinaire, peut être
ciielqnefois beaucoup plus rapide. C’est à des, mouvements amiboïdes de
ces tractus que paraissent dns les phénomènes circulatoires constatés dans
le liquide qui constitue, à notre sens, leur véritable fluide nourricier et
peut-être aussi les déplacements du noyau, qui, on le sait, execute parfois
une sorte de tournée dans l’intérieur du phytoblaste. Sous l’influence de
la lumière ou de l’obscurité, les masses protoplasmiques chloropbyllees
du phYtoblaste se déplacent vers telle ou telle paroi du phytocyste.
Les tiges des plantes se dirigent le plus souvent de bas en baut, et les
racines, de haut en bas% à peu près suivant la verticale. linight dont la
roue (fig. 1048,1049) et les expériences sont demeurees celebres , établit
1 11 y a d’assez nombreuses exceptions. Exemples : les racines des Palmiers et d’autres
Monocotylédones, qui remontent à la surface de la terre et se dirigent dans 1 air tout a
fait verticalement, leur sommet en h a u t; ou les racines adventives montent verticalement
dans l’eau d’un aquarium pour v en ir porter leur extrémité a la surfoce du liquide.
2 11 s’en faut qu’on ait donné une explication entièrement satisfaisante des phénomènes
qui se produisent dans ces expériences de Knight, si fréquemment décrites et si
diversement interprétées depuis plus d’un demi-siècle. On sait qu iL fixait °
Haricot dont la germination était commencée, au pourtour d une roue de 11 pouces anglais
de diamètre et qu’il pouvait faire tourner dans le plan vertical a 1 aide d un courant
k a u qui lui imprimait un mouvement rotatoire d’au moins 150 tours par minute (fig. 1018,.
Toutes les jeunes plantes dirigèrent leur tig e vers le centre de la roue e leur racine vers
l ’extérieur à peu près suivant le prolongement des rayons. En laissant les tiges m river
jusqu’au delà du centre, le mouvement de la roue continuant, ces tiges se replièrent
sur elles-mêmes pour regagner le centre. • « i m Fn
Dans une autre expérience (fig. 1049), la roue tournait horizonte ement En ^
faire 250 tours par minute, Knight vit les jeunes plantes, « maigre la rapidité du m o v e ment
rester toujours dans la même direction relativement a 1 attraction teriestre, d
l’intlùence était partiellement supprimée »; mais comme elles étaient soumises en meme
temps à la force centrifuge agissant horizontalement et à l’action de la ®
çant dans la direction verticale, elles prirent une direction oblique, inclmee d e lO d o v e s sur
S r i l . La force centrifuge, vu la rapidité dn mouvement de rotatmn em p o^^ f ^ a -
l’action verticale de la pesanteur. Mais, en ralentissant le mouvement de la .one, de ma
nière qu’elle ne fît que 80 tours par minute, Knight observa que 1 inclinaison de 1 axe
total des plantes était de 45 degrés. « Je pense avoir prouvé de la sorte, d iU l, que les racines
des plantes en germination sont portées à descendre, et leurs tiges a s eleyer, par m
I r ta in e cauL externe et non par une cause inhérente à la vie végétale ; et je n’ai guere
de raison de douter qu’en pareil cas la pesanteur soit le principal, snmn 1
qu’emploie la nature. » Dans les expériences faites avec la roue verticale, ü consideie
les plantes comme soumises à des changements constants de position qui suppriment
pour elles l'action de la pesanteur à laquelle est substituée la force centrifuge.
i
i )
i
-■M
kl I;:...