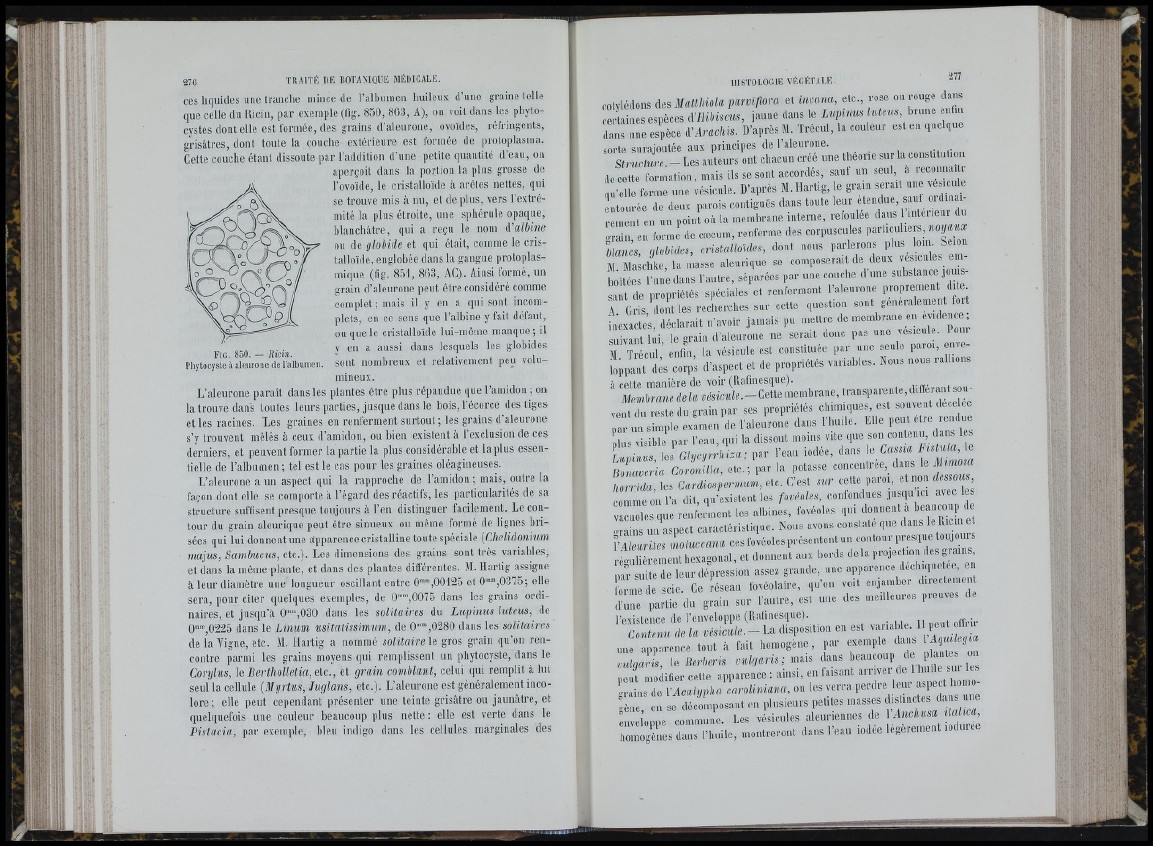
: i; k
. t.
ces liquides une tranche mince de ralbumeii huileux d’une graine telle
que celle du Ricin, par exemple (fig. 850, 8G3, A), on voit dans les phytocystes
dont elle est formée, des grains d’aleurone, ovoïdes, rélringents,
grisâtres, dont toute la couche extérieure est formée de protoplasma.
Cette couche étant dissoute par l’addition d’une petite quantité d eau, on
F ig . 850. — Ricin.
Phytocyste à aleurone de l’albumen.
aperçoit dans la portion la plus grosse de
l ’ovoïde, le cristalloïde à arêtes nettes, qui
se trouve mis à nu, et de plus, vers l’extrémité
la plus étroite, une sphérule opaque,
blanchâtre, qui a reçu le nom d’albine
ou de globide et qui était, comme le cris-
talloide, englobée dans la gangue protoplasmique
(fig. 851, 803, AC). Ainsi formé, un
grain d’aleiirone peut être considéré comme
complet; mais il y en a qui sont incomplets,
en ce sens que l’albine y fait défaut,
ou que le cristalloïde lui-même manque ; il
y en a aussi dans lesquels les globides
sont nombreux et relativement peu volumineux.
L’aleurone paraît dans les plantes être plus répandue que l’amidon; on
la trouve dans toutes leurs parties, jusque dans le bo is ,l’écorce des tiges
et les racines. l e s graines en renferment surtout ; les grains d’aleurone
s’y trouvent mêlés à ceux d’amidon, ou bien existent à l’exclusion de ces
derniers, et peuvent former la partie la plus considérable et lapins essentielle
de l’albumen ; tel est le cas pour les graines oléagineuses.
L’aleurone a un aspect qui la rapproche de l’amidon ; mais, outre la
façon dont elle se comporte à l’égard des réactifs, les particularités de sa
structure suffisent presque toujours à l ’en distinguer facilement. Le contour
du grain aleurique peut être sinueux ou même formé de lignes brisées
qui lui donnent une âpparence cristalline toute spéciale (Chelidonium
majus, Sambucus, etc.). Les dimensions des grains sont très variables,
et dans la même plante, et dans des plantes différentes. M.Hartig assigne
à leur diamètre une longueur oscillant entre 0™"“,00125 et 0'”” ,0375; elle
sera, pour citer quelques exemples, de 0””,0075 dans les grains ordinaires,
et jusqu’à 0™“ ,030 dans les solitaires du Lupinus luteus, de
0”"’,0225 dans le L in um usitatissimum, de 0“™,0280 dans les solitaires
de la Vigne, etc. M. Hartig a nommé solitaire le gros grain qu’on rencontre
parmi les grains moyens qui remplissent un phytocyste, dans le
Corylus, le Bertholletia, etc., et grain comblant, celui qui remplit à lui
seul la cellule (Myrtus, Juglans, etc.). L’aleurone est généralement incolore
; elle peut cependant présenter une teinte grisâtre ou jaunâtre, et
quelquefois une couleur beaucoup plus nette : elle est verte dans le
Pistacia, par exemple, bleu indigo dans les cellules marginales des
cotylédons des Matthiola parviflora et incana, etc., rose on ronge dans
certaines espèces d’üibiscus, jaune dans le Luptnus luteus, hvnne ei
dans une espèce d’Arac/us._ D’après M. Trécul, la couleur est en quelque
sorte suraioutée aux principes de Taleurone.
Struclure — Les .-luleurs ont chacun créé une théorie sur la constitul ion
dcccTe fo L t i o u , mais ils se sont accordés, sauf uu seul, a reconua. r
/ c u l formc une vésicule. D'après M. Hartig, le grain scr.ait une ves.erüc
entourée (le deux parois coiiligués dans toute leur etendue, sauf ordu
“ ( u k t eu un point où la membrane interne, refoulée d a n s l'mlen eu r du
grain, eu forme de cæcum, renferme des corpuscules r “"'®“
I hm i s flloUies, cristalloUes, dont nous parlerons plus Ion . Scion
rM a i e h k e la ./asse aleurique se composerait (le deux vésicules emp
i l é e s 1 un’e dans l'autre, séparées par une couche d'une substance jouissant
de propriétés spéciales et renfermant l’aleurone proprement dite,
r Gris dont les r e le r c l .e s sur cette question sont généralement fort
hi'exacte’s déclarait n’avoir jamais pu mellre de membrane en evidence;
" P i Î e grain d’aleurone ne serait donc pas nue vésicule. Pour
1 ï ré c u l enfin, la vésicule est constituée par une seule paroi, enve-
ÎÔ p p l t des corps d’aspect et de propriétés variables. Nous nous ralhous
à cette manière de voir (Piafinesque).
Mmb r a n c de la v é s i c u l e . -CMe raembraue, ''■=>>«P'"4‘k ' k ) , " k e “e
vent du reste du grain par ses propriétés chimiques, est souvent dcce ce
p a P m k m le examen de l ’alenrone dans l ’huile. Elle peut etre rendu
,lus visible par l’eau, qui la dissout moins vile
lu p in u s , les Glycyr rhUa; par l ’eau rodee, dans G ^ C s fe M
Boncweria Coronilla, etc.; par la potasse conceiiliee,^ dans le Mimosa
hórrida les Cardiospermum, etc. C’est sur cette paroi, et non essous,
comme o’n l’a dit, qu’existent les fovéoles, confondues jusqu rcr avec les
vacuoles que reufennent les albines, fovéoles qui donnent a beaumnp de
.„■ains un aspect caractéristique. Nous avons constaté que dans 1^%“ %
V Aleurites moluceana ces fovéoles présentent un contour presque toujo
r c P " r e . r l h e x a g o n a l , et donnent aux bords delà projectrou des grarns
in”r suite de leur dépression assez grande, une apparence dcch.quetee, en
L P I s re. Ce L e a n fovéolaire, qu’on voit enjamber d.reetemen
k P o partie (lu grain sur l’autre, est nue (les me.lieures preuves de
Texistcnce de l’enveloppe (Rafinesque).
contenu de la v é s i c u l e . - L o disposition en est ^ m L \ C u t l e l
une apparence tout à fait homogène , par exemple dans 1 Aquilegia
imlaaHs le Berberis vulgar i s ; mais dans beaucoup de plantes on
Ï Ï r/oPifre, e l e apparen/e i ainsi, eu faisant arriver de l’hurle sur les
b-ains de VAcalypha caroliniana, on les verra perdre leur aspei,t homo
: r z se Pcomposaut en plusieurs petites masses distinctes dans une
enveloppe commune. Les vésicules aleuriennes de 1 Anchusa üahca,
homogènes dans l’I.uile, montreront dans l’eau iodée legerement iodu.ee
k l i -