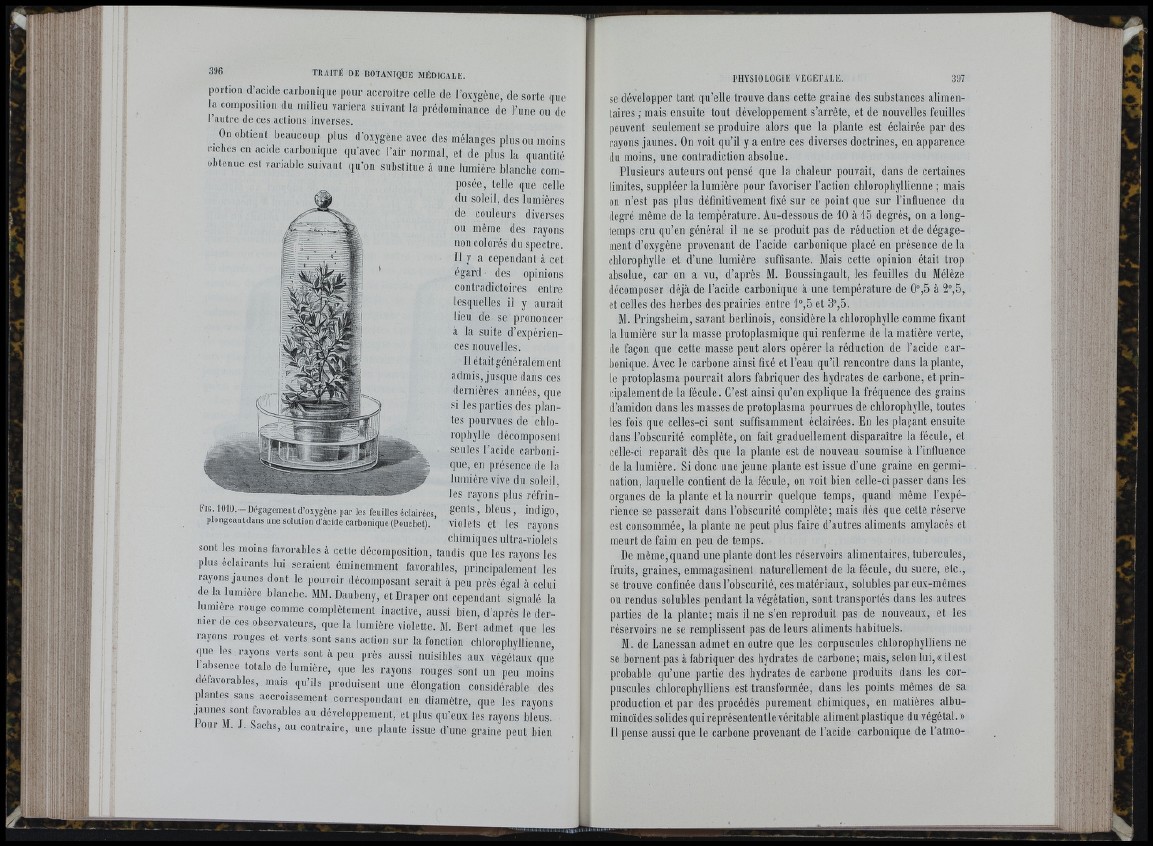
ik
-Bî
" t
.ti
portion d’acide carbonique pour accroître celle de l ’oxygène, de sorte que
la composition du milieu variera suivant la prédominance de l’une ou de
l’autre de ces actions inverses.
On obtient beaucoup plus d ’oxygène avec des mélanges pins ou moins
ricbes en acide carbonique qu’avec l’air normal, et de^ilus la quantité
oblemie esl variable suivant qu’on substitue à une lumière blancbe composée,
telle qne celle
du soleil, des lumières
de couleurs diverses
ou même des rayons
non colorés du spectre.
Il y a cependant à cet
égard des opinions
contradictoires entre
lesquelles il y aurait
lieu de se prononcer
à la suite d’expériences
nouvelles.
Il étaitgénéralement
admis, jusque dans ces
dernières années, que
si les parties des plantes
pourvues de cbio-
ropbylle décomposent
seules l’acide carbonique,
en présence de la
lumière vive du soleil,
les niyons plus réfringents
, bleus, indigo,
violets et les rayons
cbimiques ultra-violets
Fig 101ü.--Dégagement d’oxygène par les feuilles éclairées,
plongeant dans une solution d’acide carbonique (Pouchet).
sont les moins favorables à cette décomposition, tandis que les rayons les
plus éclairants lui seraient éminemment favorables, principalement les
rayons jaunes dont le pouvoir décomposant serait à peu près égal cà celui
de la lumiere blancbe. MM. Daubeny, et Draper ont cependant signalé la
lumiere ronge comme complètement inactive, aussi bien, d ’après^ le dernier
de ces observiiteurs, que la lumière violette. M. Bert admet que les
rayons rouges et verts sont sans action sur la fonction cbloropbyllienne,
que les ivayons verts sont à peu près aussi nuisibles aux végétaux que
I cabsence totale de lumière, que les rayons rouges sont un peu moins
l eavorables, imais qu’ils produisent nue élongation considérable des
plantes ScTus accroissement correspondant en diamètre, que les rayons
.janiies sont favorables au développement, et plus qu’eux les rayons bleus.
Olir M. J. Sacbs, au contraire, une plante issue d’ime graine peut bien
se développer tcant qu’elle trouve dans cette graine des substances alimentaires;
mais ensuite tout développement s’arrête, et de nouvelles feuilles
peuvent seulement se produire alors que la plante est éclairée par des
ivayons jaunes. On voit qu’il y a entre ces diverses doctrines, en apparence
du moins, une contradiction absolue.
Plusieurs auteurs ont pensé que la cbaleur pouvait, dans de certaines
limites, suppléer la lumière pour favoriser l’action chloropbyllienne ; mais
on n’est pas plus définitivement fixé sur ce point que sur l’influence du
degré même de la température. Au-dessous de 10 à 15 degrés, on a longtemps
cru qu’en général il ne se produit pas de réduction et de dégage-
iiient d ’oxygène provenant de l’acide carbonique placé en présence de la
cbloropbylle et d’une lumière suffisante. Mais cette opinion était trop
absolue, car on a vu, d ’après M. Boussingault, les feuilles du Mélèze
décomposer déjà de l’acide carbonique à une température de 0“,5 à 2®,5,
et celles des berbes des prairies entre 1“,5 et 3®,5.
M. Pringsbeim, savant berlinois, considère la cbloropbylle comme fixant
la lumière sur la masse protoplasmique qui renferme de la matière verte,
de façon que cette masse peut alors opérer la réduction de l’acide c a r bonique.
Avec le carbone ainsi fixé et l’eau qu’il rencontre dans la plante,
le protoplasma pourrait alors fabriquer des hydrates de carbone, et principalement
de la fécule. C’est ainsi qu’on explique la fréquence des grains
d’amidon dans les masses de protoplasma pourvues de chlorophylle, toutes
les fois que celles-ci sont suffisamment éclairées. En les plaçant ensuite
dans l’obscurité complète, on fait graduellement disparaître la fécule, et
celle-ci reparaît dès que la plante est de nouveau soumise à l’influence
de la lumière. Si donc une jeune plante est issue d’une graine en germination,
laquelle contient de la fécule, on voit bien celle-ci passer dans les
organes de la plante et la nourrir quelque temps, quand même l’expérience
se passerait dans l’obscurité complète; mais dès que cette réserve
est consommée, la plante ne peut plus faire d’autres aliments amylacés el
meurt de faim en peu de temps.
De même, quand une plante dont les réservoirs alimentaires, tubercules,
fruits, graines, emmagasinent naturellement de la fécule, du sucre, etc.,
se trouve confinée dans l’obscurité, ces matériaux, solubles par eux-mêmes
ou rendus solubles pendant la végétation, sont transportés dans les autres
parties de la plante ; mais il ne s’en reproduit pas de nouveaux, et les
réservoirs ne se remplissent pas de leurs aliments habituels.
M. de Lanessan admet en outre que les corpuscules chlorophylliens ne
se bornent pas à fabriquer des hydrates de carbone ; mais, selon lui, « il est
probable qu’une partie des hydrates de carbone produits dans les corpuscules
chlorophylliens est transformée, dans les points mêmes de sa
production et par des procédés purement chimiques, en matières albuminoïdes
solides qui représententle véritable aliment plastique du végétal.»
Il pense aussi que le carbone provenant de l’acide carbonique de l’atmo