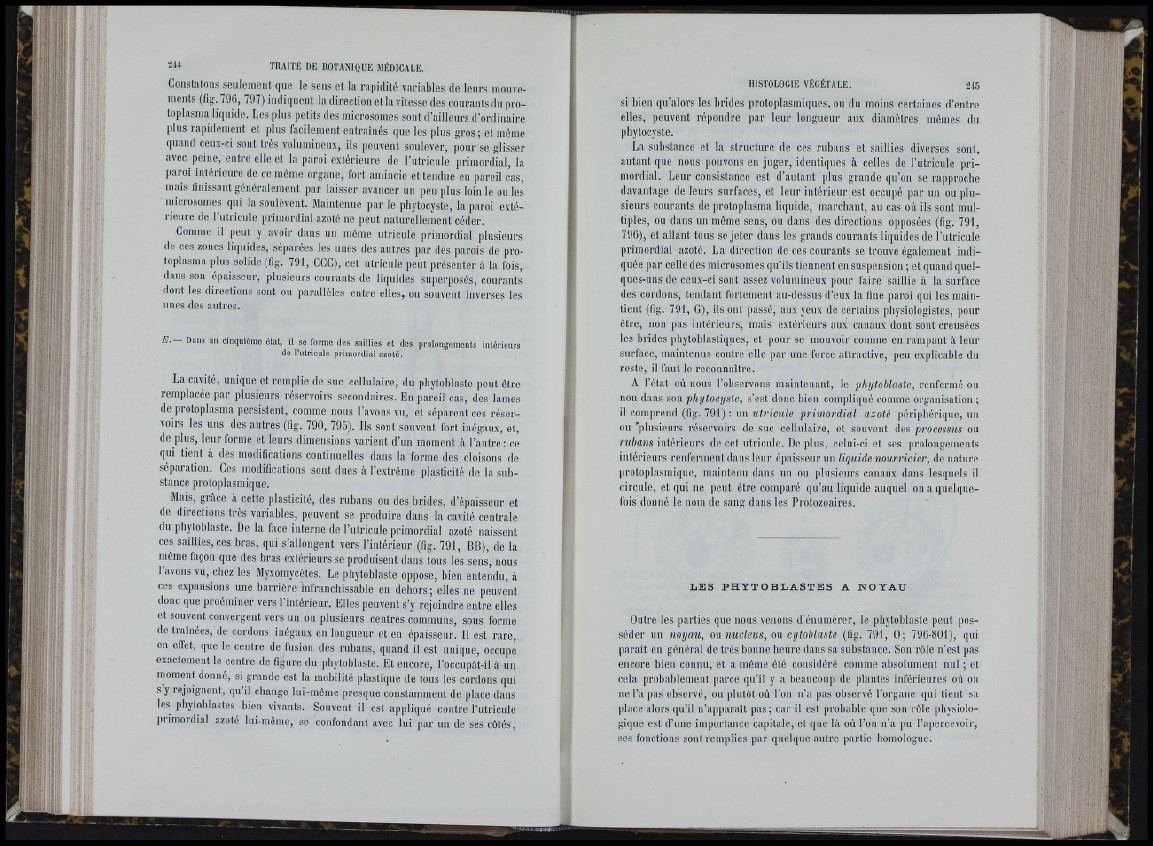
'il :
f
Constatons seulement que le sens et la rapidité variables de leurs mouvements
(fig. 796, 797) indiquent la direction et la vitesse des courants du protoplasma
liquide. Les plus petits des microsomes sont d’ailleurs d’ordinaire
plus rapidement et plus facilement entraînés que les plus gros ; et même
quand ceux-ci sont très volumineux, ils peuvent soulever, pour se glisser
avec peine, entre elle et la paroi e.xtérienre de l’utricule primordial, la
paroi intérieure de ce même organe, fort amincie et tendue en pareil cas,
mais finissant généralement par laisser avancer un peu plus loin le ou les
microsomes qui la soulèvent. Maintenue par le phytocyste, la paroi extérieure
de l’utricule primordial azoté ne peut naturellement céder.
Comme il peut y avoir dans un même utricule primordial plusieurs
de ces zones liquides, séparées les unes des autres par des parois de protoplasma
plus solide (fig. 791, CGC), cet utricule peut présenter à la fois,
dans son épaisseur, plusieurs courants de liquides superposés, courants
dont les directions sont ou parallèles entre elles, ou souvent inverses les
unes des autres.
E. — Dans un cinquième état, il se forme des saillies et des prolongements intérieurs
de l ’utricule primordial azoté.
La cavité, unique et remplie de suc cellulaire, du phytoblaste peut être
remplacée par plusieurs réservoirs secondaires. En pareil cas, des lames
de protoplasma persistent, comme nous l ’avons vu, et séparent ces réservoirs
les uns des autres (fig. 790, 795). Ils sont souvent fort inégaux, et,
de plus, leur forme et leurs dimensions varient d’un moment à l ’autre: ce
qui tient à des modifications continuelles dans la forme des cloisons de
séparation. Ces modifications sont dues à l’extrême plasticité de la substance
protoplasmique.
Mais, grâce â cette plasticité, des rubans ou des brides, d’épaisseur et
de directions très variables, peuvent se produire dans la cavité centrale
du phytoblaste. De la face interne de l’utricule primordial azoté naissent
ces saillies, ces bras, qui s’allongent vers l’intérieur (fig. 791, BB), de la
même façon que des bras extérieurs se produisent dans tous les sens, nous
l’avons vu, chez les Myxomycètes. Le phytoblaste oppose, bien entendu, à
ces expansions une barrière infranchissable en dehors ; elles ne peuvent
donc que proéminer vers l’intérieur. Elles peuvent s’y rejoindre entre elles
et souvent convergent vers un ou plusieurs centres communs, sous forme
de traînées, de cordons inégaux en longueur et en épaisseur. Il est rare,
en effet, que le centre de fusion des rubans, quand il est unique, occupé
exactement le centre de figure du phytoblaste. Et encore, l ’occupât-il â un
moment donné, si grande est la mobilité plastique de tous les cordons qui
s y rejoignent, qu’il change lui-même presque constamment de place dans
les phytoblastes bien vivants. Souvent il est appliqué contre l’utricule
piimordial azoté lui-même, se confondant avec lui par un de ses côtés,
si bien qu’alors les brides protoplasmiques, ou du moins certaines d’entre
elles, peuvent répondre par leur longueur aux diamètres mêmes du
phytocyste.
La substance et la structure de ces rubans et saillies diverses sont,
autant que nous pouvons en juger, identiques â celles de l’utricule primordial,
Leur consistance est d’autant plus grande qu’on se rapproche
davantage de leurs surfaces, et leur intérieur est occupé par un ou plusieurs
courants de protoplasma liquide, marchant, au cas où ils sont multiples,
ou dans un même sens, ou dans des directions opposées (fig, 791,
796), et allant tons se jeter dans les grands courants liquides de l’utricule
primordial azoté. La direction de ces courants se trouve également indiquée
par celle des microsomes qu’ils tiennent en suspension ; et quand quelques
uns de ceu.x-ci sont assez volumineux pour faire saillie â la surface
des cordons, tendant fortement au-dessus d’eux la fine paroi qui les maintient
(fig. 791, G), ils ont passé, aux yeux de certains physiologistes, pour
être, non pas intérieurs, mais extérieurs aux canaux dont sont creusées
les brides phytoblastiques, et pour se mouvoir comme en rampant â leur
surface, maintenus contre elle par une force attractive, peu explicable du
reste, il faut le reconnaître.
A l’état où nous l’observons maintenant, le phytoblaste, renfermé ou
non dans son phytocyste, s’est donc bien compliqué comme organisation ;
il comprend (fig. 791) : un utricule primordial azoté périphérique, un
ou 'plusieurs réservoirs de suc cellulaire, et souvent des processus ou
rubans intérieurs de cet utricule. De plus, celui-ci et ses prolongements
intérieurs renferment dans leur épaisseur un liquide nourricier, de nature
protoplasmique, maintenu dans un ou plusieurs canaux dans lesquels il
circule, et qui ne peut être comparé qu’au liquide auquel on a quelquefois
donné le nom de sang dans les Protozoaires.
LES P H Y T O B L A S T E S A N O Y A U
Outre les parties que nous venons d’énumérer, le phytoblaste peut posséder
un noyau, oa nucléus, ou cytoblaste (fig. 791, 0 ; 796-801), qui
paraît en général de très bonne heure dans sa substance. Son rôle n’est pas
encore bien connu, et a même été considéré comme absolument nul ; et
cela probablement parce qu’il y a beaucoup de plantes inférieures où on
ne l’a pas observé, ou plutôt où l’on n’a pas observé l’organe qui tient sa
place alors qu’il n’apparaît pas ; car il est probable que son rôle physiologique
est d’une importance capitale, et que lâ où l’on n ’a pu l’apercevoir,
ses fonctions sont remplies par quelque autre partie homologue.
‘b Í
’ .•k i'r
G 'AU' b k, '
;%%■
IpkM;
Í 'i i
i « \à
d
'*■ '■ .
i '
■: 'li'i
j a - ü l i i ;
*.,5
" G'ik M
k- G
k , .
u.i.k ■