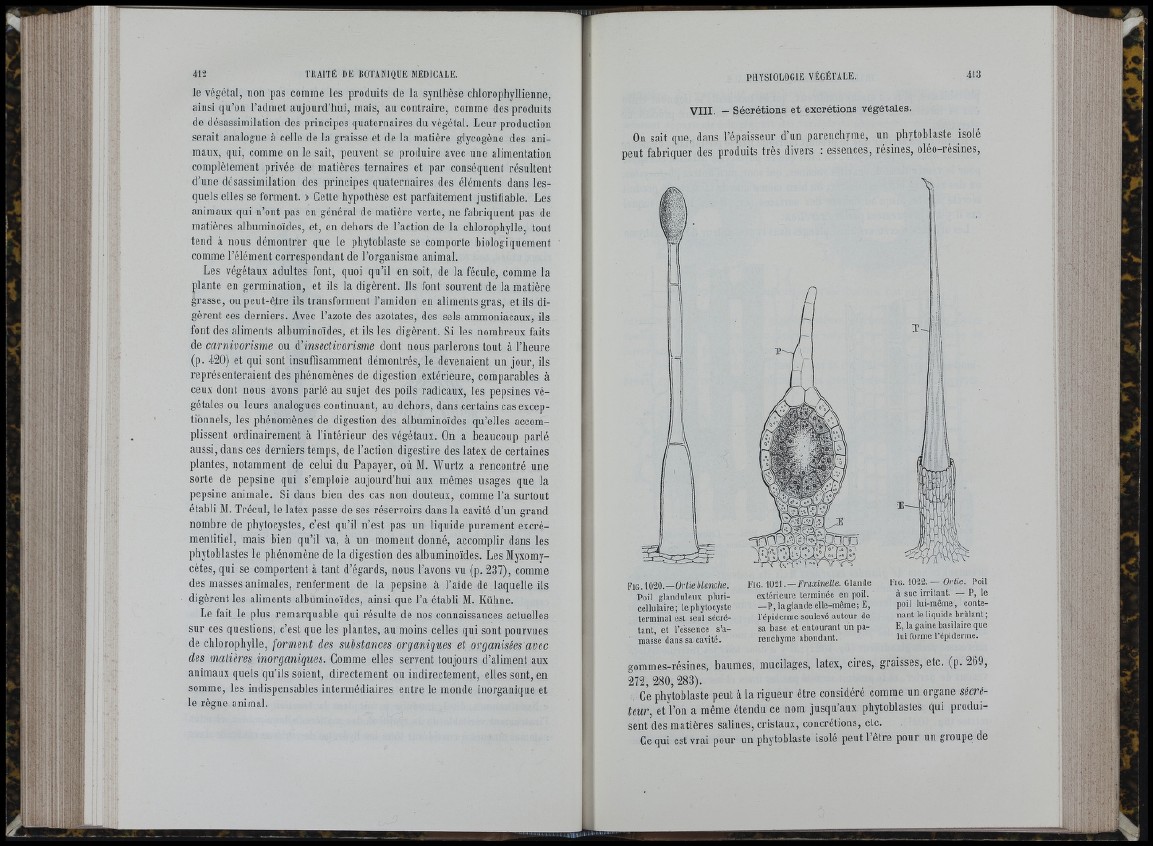
le végétal, non pas comme les produits de la synthèse chlorophyllienne,
ainsi qu’on l’admet aujourd’hui, mais, au contraire, comme des produits
de désassimilation des principes quaternaires du végétal. Leur production
serait analogue à celle de la graisse et de la matière glycogène des animaux,
qui, comme on le sait, peuvent se produire avec une alimentation
complètement privée de matières ternaires et par conséquent résultent
d’une désassimilation des principes quaternaires des éléments dans lesquels
elles se forment. » Cette hypothèse est parfaitement justifiable. Les
animaux qui n’ont pas en général de matière verte, ne fabriquent pas de
matières albuminoïdes, et, en dehors de l ’action de la chlorophylle, tout
tend à nous démontrer que le phytoblaste se comporte biologiquement
comme l’élément correspondant de l’organisme animal.
Les végétaux adultes font, quoi qu’il en soit, de la fécule, comme la
plante en germination, et ils la digèrent. Ils font souvent de la matière
grasse, ou peut-être ils transforment l’amidon en aliments gras, et ils digèrent
ces derniers. Avec l’azote des azotates, des sels ammoniacaux, ils
font des aliments albuminoïdes, et ils les digèrent. Si les nombreux faits
de carnivorisme ou à’insectivorisme dont nous parlerons tout à l’heure
(p. 420) et qui sont insuffisamment démontrés, le devenaient un jour, ils
représenteraient des phénomènes de digestion extérieure, comparables à
ceux dont nous avons parle au sujet des poils radicaux, les pepsines végétales
ou leurs analogues continuant, au dehors, dans certains cas exceptionnels,
les phénomènes de digestion des albuminoïdes qu’elles accomplissent
ordinairement à l’intérieur des végétaux. On a beaucoup parlé
aussi, dans ces derniers temps, de l ’action digestive des latex de certaines
plantes, notamment de celui du Papayer, où M. Wurtz a rencontré une
sorte de pepsine qui s’emploie aujourd’hui aux mêmes usages que la
pepsine animale. Si dans bien des cas non douteux, comme l ’a surtout
établi M. Trécul, le latex passe de ses réservoirs dans la cavité d’un grand
nombre de phytocystes, c’est qu’il n ’est pas un liquide purement excré-
mentitiel, mais bien qu’il va, à un moment donné, accomplir dans les
phytoblastes le pbénomène de la digestion des albuminoïdes. Les Myxomycètes,
qui se comportent à tant d’égards, nous l’avons vu (p. 237), comme
des masses animales, renferment de la pepsine à l’aide de laquelle ils
digèrent les aliments albuminoïdes, ainsi que l’a établi M. Kühne.
Le fait le plus remarquable qui résulte de nos connaissances actuelles
sur ces questions, c’est que les plantes, au moins celles qui sont pourvues
de cblorophylle, forment des substances organiques et organisées avec
des matières inorganiques. Comme elles servent toujours d’aliment aux
animaux quels qu’ils soient, directement ou indirectement, elles sont, en
somme, les indispensables intermédiaires entre le monde inorganique et
le règne animal.
VIII. — Sécrétions e t excrétions v ég é ta le s.
On sait que, dans l’épaisseur d’un parenchyme, un phytoblaste isolé
peut fabriquer des produits très divers : essences, résines, oléo-résines.
Fig. \020.— Ortieblanche.
Poil glanduleux pluri-
cellulaire; le phytocyste
terminal est seul sécrétant,
et l’essence s’amasse
dans sa cavité.
TFiü.
1021 . — Fraxinelle. Glande
extérieure terminée en poil.
—P, la glande elle-même ; E,
répiderrne soulevé autour de
sa base et entourant un parenchyme
abondant.
Fig. 1022. — Ortie. Poil
à suc irritant. — P, le
poil lui-même, contenant
le liquide brûlant;
E, la gaine basilaire que
lui forme Tépiderme.
gommes-résines, baumes, mucilages, latex, cires, graisses, etc. (p. 269,
27 2 ,2 8 0 ,2 8 3 ).
Ce phytoblaste peut à la rigueur être considéré comme un organe sécréteur,
et Von a même étendu ce nom jusqu’aux phytoblastes qui produisent
des matières salines, cristaux, concrétions, etc.
Ce qui est vrai pour un phytoblaste isolé peut l ’être pour un groupe de