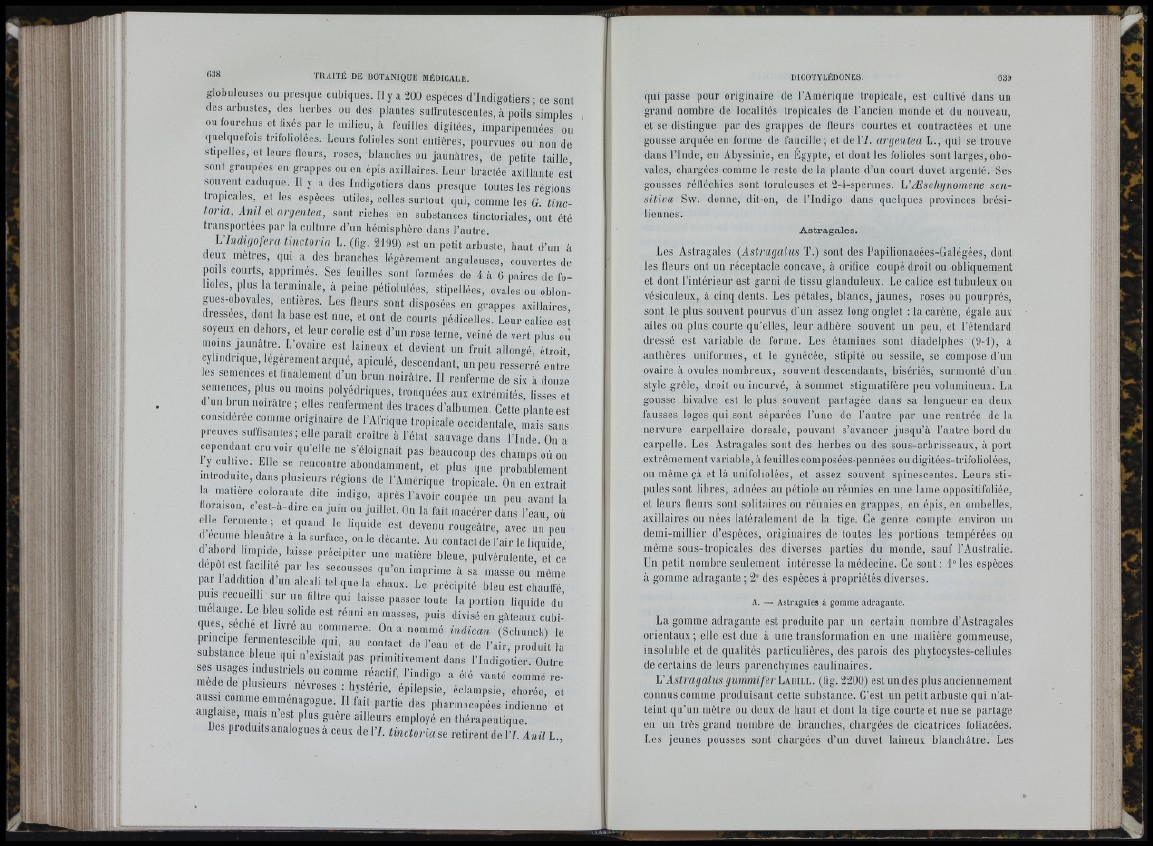
' i
globuleuses ou presque cubiques. Il y a 200 espèces d’indigotiers ; ce sont
des arbustes, des berbes ou des plantes suiirutescentes, à poils simples
o u lo u r cb n s e t f ix é sp a r lemi l ieu , à feuilles digitées, imparipennées ou
([uelqueiois trifoliolées. Leurs folioles sont entières, pourvues ou non de
stipelles, et leurs fleurs, roses, blancbes ou jaunâtres, de petite taille
sont groupées en grappes ou en épis axiliaires. Leur bractée axillante est
souvent caduque. II y a des Indigotiers dans presque toutes les régions
tropicales, et les espèces utiles, celles surtout qui, comme les G. t inctoria,
Am i et argentea, sont ricbes en substances tinctoriales, ont été
transportées par la culture d’nn bémispbère dans l’autre.
h Indigofera tinctoria L. (fig. 2199) est un petit arbuste, baut d’un à
deux mètres, qui a des brandies légèrement anguleuses, couvertes de
poils courts, apprimés. Ses feuilles sont formées de 4 cà ü paires de folioles,
plus la terminale, à peine pétiolulées, stipellées, ovales ou oblon-
gues-obovales, entières. Les lleurs sont disposées en grappes axiliaires
dressees, dont la base est nue, et ont de courts pédicelles. Leur Ccalice est
soyeux en dehors, et leur corolle est d’un rose terne, veiné de vert plus ou
moins jaunâtre. L’ovaire est Laineux et devient nn fruit allongé, étroit
cjhudrique, legerement arqué, apiculé, descendant, un peu resserré entre
les semences et finalement d’un brun noirâtre. Il renferme de six â douze
semences, plus ou moins polyédriques, tronquées aux extrémités, lisses et
d un brun noirâtre ; elles renferment des traces d’calbumen Gette plante est
considcree ramme originaire de l’Afrique tropicale occidentale, mais sans
pi cuves suibsantes; elle parcaît croître â l’état sauvage dans l ’Iude. On a
cependant cru voir qu’elle ne s’éloignait pcas beaucoup des champs où on
1 y eu tive. Elle se rencontre abondamment, et plus que probablement
inlrodmte, dcans plusieurs régions de l ’Amérique tropicale. Ou en extrait
a matiere colorcaute dite indigo, après l ’avoir coupée un peu avant la
lloicaisou, c est-a-dire eu juin ou juillet. On la Lait macérer dans l ’eau, où
elle fermente ; et quand le liquide est devenu rougeâtre, avec uu peu
decume bleuâtre a lasurface, onle décante. Au couLact de Tcair le liquide
a^b^ord limpide, laisse précipiter une matière bleue, pulvérulente, et ce
dcpotes acilite par les secousses qu’on imprime â sa masse ou même
pai addition d un calcaii tel que la chaux. Le précipité bleu est chauffé
elau.e. Le bleu solide est reimi en masses, puis divisé en gâteaux cubi-
1 es, racbeet livre au commerce. On a nommé indican (Scbunck) le
de l’air, produit la
bstance bleue qui u existait pas primitivement dans l’Indigotier. Outre
‘ “ 'digo a élé vanté comme re-
mede de plusieurs névrosés : hystérie, épilepsie, éclampsie, cborée, et
SS comme emmenapgue. Il fait partie des pbar.nacopées indien,m et
anglaise, inais n est plus guère ailleurs employé en thérapeutique.
Des produits analogues â ceux de 17. tinctoria se retirent de 1’/. An i l L.,
! !
qui passe pour originaire de l’Amérique tropicale, est cultivé dans un
grand nombre de localités tropicales de l’ancien monde et du nouveau,
et se distingue par des grappes de tleurs courtes et contractées et une
gousse arquée en forme de faucille; et d e l ’i. argentea L., qui se trouve
dans l’Inde, en Abyssinie, en Égypte, et dont les folioles sont larges, obovales,
cbargées comme le reste de la plante d’un court duvet argenté. ISes
gousses réfléchies sont toruleuses et 2-4-spermes. h ’Æschynomene sensitiva
Sw. donne, dit-on, de l’Indigo dans quelques provinces brésiliennes.
Astragales.
Les Astragales (Astragalus T.) sont des Papilionaoées-Galégées, dont
les fleurs ont un réceptacle concave, â orifice coupé droit ou obliquement
et dont l’intérieur est garni de tissu glanduleux. Le calice est tubuleux ou
vésiculeux, â cinq dents. Les pétales, blancs, jaunes, roses ou pourprés,
sont le plus souvent pourvus d’un assez long onglet : la carène, égale aux
ailes ou plus courte qu’elles, leur adhère souvent un peu, et l’étendard
dressé est variable de forme. Les étamines sont diadelpbes (9-1), â
anthères unifortnes, et le gynécée, stipité ou sessile, se compose d’im
ovaire â ovules nombreux, souvent descendants, bisériés, surmonté d’un
style grêle, droit ou incurvé, â sommet stigmatifère peu volumineux. La
gousse bivalve est le plus souvent partagée dans sa longueur en deux
fausses loges qui sont séparées l’une de l’autre par une rentrée de la
nervure carpellaire dorsale, pouvant s’avancer jusqu’à l’autre bord du
carpelle. Les Astragales sont des herbes ou des sous-arbrisseaux, â port
extrêmement variable, â feuilles composées-pennées ou digitées-trifoliolées,
ou même çâ et lâ unifoliolées, et assez souvent spinesceutes. Leurs stipules
sont libres, adnées au pétiole ou réunies en une lame oppositifoliée,
et leurs fleurs sont solitaires ou réunies en grappes, en épis, en ombelles,
axiliaires ou nées latéralement de la tige. Ge genre compte environ uu
demi-millier d’espèces, originaires de toutes les portions tempérées ou
même sous-tropicales des diverses parties du monde, sauf l’Australie.
Un petit nombre seulement intéresse la médecine. Ce sont: 1® les espèces
â gomme adragante; 2“ des espèces â propriétés diverses.
A. — Astragales à gomme adragante.
La gomme adragante est produite par un certain nombre d’Astragales
orientaux; elle est due â une transformation en une matière gommeuse,
insoluble et de qualités particulières, des parois des pbytocystes-cellules
de certains de leurs pareiicbymes caulinaires.
U Astragalus gummifer L a u i l l . (fig. 2200) est un des plus anciennement
connus comme produisant cette substance. G’est uu pelit arbuste qui n’atteint
qu’un mètre ou deux de baut et dont la tige courte et nue se partage
en un très grand nombre de branches, cbargées de cicatrices foliacées.
Les jeunes pousses sont cbargées d’un duvet laineux blancbâtre. Les