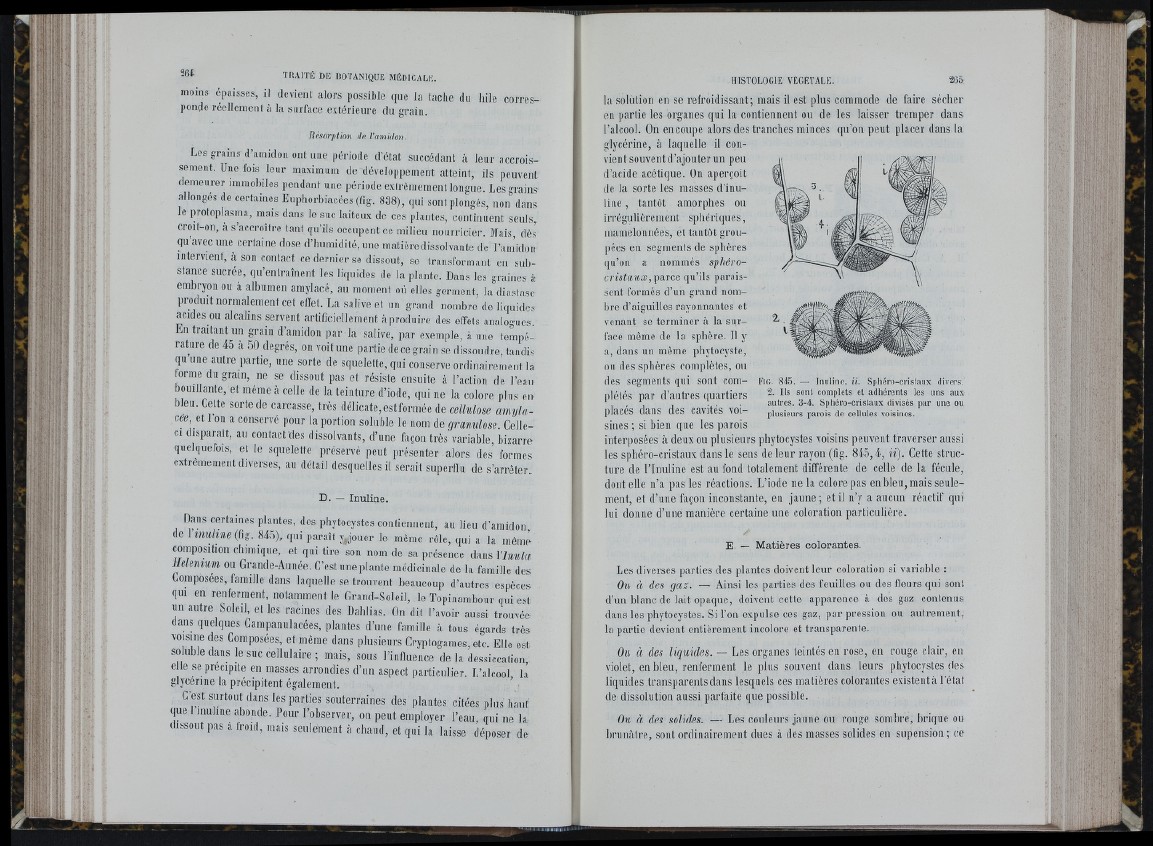
moins épaisses, il devient alors possible que la tacbe du liile corresponde
réellement à la surface extérieure du grain.
Résorption de l’amidon.
Les grains d’amidon ont une période d’état succédant a leur accroissement.
Une fois leur maximum de développement atteint, ils peuvent
demeurer immoliiles pendant une période exirémement longue. Leso-rains
allongés de certaines Enpborbiacées (fig. 838), qui sont plongés, non dans
le protoplasma, mais dans le suc laiteux de ces plantes, continuent seuls
croit-on, a s’accroître tant qu’ils occupent ce milieu nourricier. Mais, dès
qu avec mie certaine dose d’bumidité,une matièredissolvante de l’amidon
intervient, à son contact ce dernier se dissout, se transformant en substance
sucrée, qu’entraînent les liquides de la plante. Dans les graines k
embryon ou à albumen amylacé, au moment où elles germent, la diastase
produit normalement cet eifet. La salive et un grand nombre de liquides
acides ou alcalins servent artificiellement à produire des effets analomcs.
En traitant un grain d’amidon par la salive, par exemple, à une température
de 45 à 50 degrés, on voit une partie de ce grain se dissoudre, tandis
qu une antre partie, une sorte de squelette, qui conserve ordinairement la
forme du grain, ne se dissout pas et résiste ensuite à l ’action de l ’eau
bouillante, et même à celle de la teinture d’iode, qui ne la colore plus en
b eu. Cette sorte de carcasse, très délicate, est formée de cellulose amy la cée,
oi l ’on a conservé pour la portion soluble le nom de granulóse. Celle-
ci disparad, au contact des dissolvants, d’une façon très variable, bizarre
quelquefois, et le squelette préservé peut présenter alors des formes
extrêmement diverses, an détail desquelles il serait snpertlu de s’arrêter.
D. — Inuline.
Dans certaines plantes, des phytocystes contiennent, au lieu d’amidon
de inuhne (fig. 845), qui paraît y.jouer le même rôle, qui a la môme
composition chimique, et qui tire son nom de sa présence dans Vlnula
Helemum ou Grande-Aiinée. C’est une plante médicinale de la famille des
Composées, famille dans laquelle se trouvent beaucoup d’autres espèces
qui en renferment, notamment le Grand-Soleil, le Topinambour qui est
nu autre Soleil, et les racines des Dahlias. On dit l ’avoir aussi trouvée
dans quelques Campanulacées, plantes d’une famille à tous égards très
voisine des Composées, et même dans plusieurs Cryptogames, etc. Elle est
soluble dans le suc cellulaire ; mais, sous l ’influence de la dessiccation
e le se precipite en masses arrondies d’nn aspect particulier. L’alcool la
glycerine la précipitent également. ’
C’est surtout dans les parties souterraines des plantes citées plus baut
que 1 inulme abonde. Pour l’observer, on peut employer l’eau, qui ne la
dissout pas à froid, mais seulement à chaud, et qui la laisse déposer de
la solution en se refroidissant; mais il est plus commode de faire sécher
en partie les organes qui la contiennent ou de les laisser tremper dans
l’alcool. On en coupe alors des tranches minces qii’on peut placer dans la
glycérine, à laquelle il convient
souvent d’ajouter un peu
d’acide acétique. On aperçoit
de la sorte les masses d’inu-
l in e , tantôt amorphes ou
irrégulièrement sphériques,
mamelonnées, et tantôt groupées
en segments de sphères
qu’on a nommés sphéro-
cris taux, parce qu’ils paraissent
formés d’un grand nombre
d’aiguilles rayonnantes et
venant se terminer à la surface
même de la sphère. D y
a, dans un môme phytocyste,
ou des sphères complètes, ou
des segments qui sont complétés
par d’autres ([uartiers
placés dans des cavités voisines
; si bien que les parois
ITg- 845. — Inuline. ii. Sphéro-cristaux divers.
2. Us sont compiets el adhérents ies uns aux
autres. 3-4. Spiiéro-crislaux divisés par une ou
piusieurs parois de ceiluies voisines.
interposées à deux ou plusieurs pbytocystes voisins peuvent traverser aussi
les sphéro-cristaiix dans le sens de leur rayon (fig. 845,4, ii). Cette structure
de rDiuline est au fond totalement différente de celle de la fécule,
dont elle n’a pas les réactions. L’iode ne la colore pas en bleu, mais seulement,
et d’une façon inconstante, en jau n e ; et il n’y a aucun réactif qui
lui donne d’une manière certaine une coloration particulière.
E — Matières colorantes.
Les diverses parties des plantes doivent leur coloration si variable :
Ou à des gaz. — Ainsi les parties des feuilles ou des fleurs qui sont
d’un blanc de lait opaque, doivent cette apparence cà des gaz contenus
dans les phytocystes. Si l’on expulse ces gaz, par pression ou autrement,
la pcartie devient entièrement incolore et transparente.
Ou à des liquides. — Les organes teintés en rose, en rouge clair, en
violet, en bleu, renferment le plus souvent dans leurs phytocystes des
liquides transparents dans lesquels ces matières colorantes existent à l’état
de dissolution aussi parfaite que possible.
Ou à des solides. — Les couleurs jaune ou rouge sombre, brique ou
brunâtre, sont ordinairement dues à des masses solides en snpension ; ce