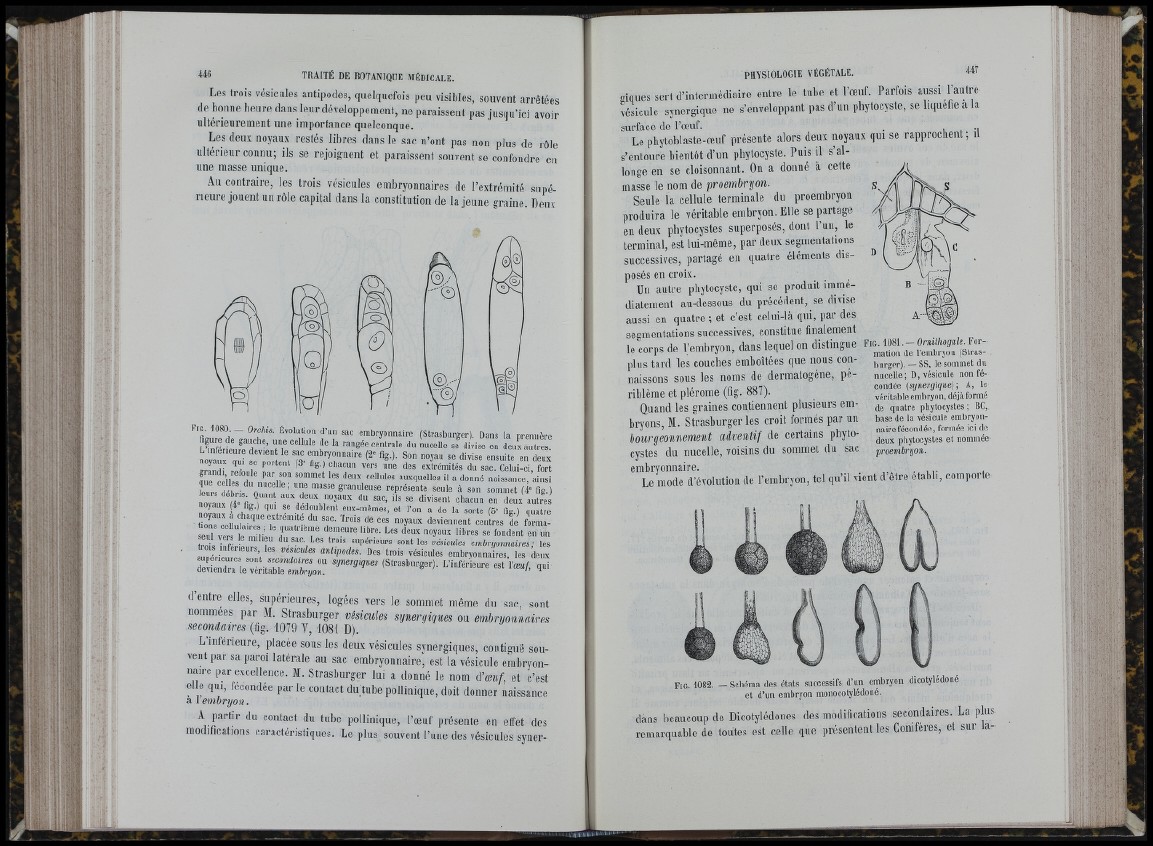
Les trois vésicules antipodes, quelquefois peu visibles, souvent arrêtées
de bonne beure dans leur développement, ne paraissent pas jusqu’ici avoir
ultérieurement une importance quelconque.
Les deux noyaux restés libres dans le sac n’ont pas non plus de rôle
ultérieur connu; ils se rejoignent et paraissent souvent se confondre en
une masse unique.
Au contraire, les trois vésicules embryonnaires de l’extrémité supérieure
jouent uu rôle capital dans la constitution de la jeune graine. Deux
Fig. 1080. Orchis. Évolution d’un sac embryonnaire (Strasburger). Dans la première
S r em ï'T ’ divise en deux 4 n r e s !
grind! refinle ^ du sac. Celui-ci, fort
mie celles d n n auxquelles il a donné naissance, ainsi
leuis d é b r i s n f “ a® granuleuse représente seule à son sommet (4® fig.)
n o v a u . t e 1 ^ 7 ? ' aux deux noyaux du sac, ils se divisent chacun en deux au tfe i
n n i! ’ > ^ 7 dédoublent eux-mêmes, et l ’on a de la sorte (5® fig.) quatre
t io L t f iu lr ir i^ r noyaux deviennent centres de formaseiü
vers le nii ? " f"'-'"“"" f°"6ent eu un
trois inférinn? 1 Supérieurs sont les vésicules embryonnaires; les
Î t é r i e 4 ’i '’T Des trois vésicules embryonnaires, les deux
S X y : t t r r X r (S t-sb u r g e r ). L’inféneure est l ’oe«/, qui
d’entre elles, supérieures, logées vers le sommet même du sac, sont
uommees par M. Strasburger vésicules synergiques ou embryonnaires
secondaires (fig. 1079 V, 1081 D).
L inférieure, placée sous les deux vésicules synergiques, contiguë souvent
pat sa paroi latérale au sac embryonnaire, est la vésicule embryonnaire
par excellence. M. Strasburger lui a donné le nom d’oeuf, et c’est
e e qui, fécondée par le contact du tube pollinique, doit donner naissance
a 1 embryon.
A partir du contact du tube pollinique, l’oeuf présente en effet des
modifications caractéristiques. Le plus souvent l’une des vésicules synero
iques sert d’intermédiaire entre le tube et l’oeuf. Parfois aussi l’autre
vésicule synergique ne s’enveloppant pas d’un phytocyste, se liquéfié a la
surface de l’oeuf. . i , -i
Le phytoblaste-oeuf présente alors deux noyaux qui se rapprochent; il
s’entoure bientôt d’un phytocyste. Puis il s’allonge
en se cloisonnant. On a donné à cette
masse le nom de proembryon.
Seule la cellule terminale du proembryon
produira le véritable embryon. Elle se ^ r t a g e
en deux phytocystes superposés, dont l’un, le
terminal, est lui-même, par deux segmentations
successives, partagé en quatre éléments disposés
en croix.
Un autre phytocyste, qui se produit immédiatement
au-dessous du précédent, se divise
aussi en quatre ; et c’est celui-là qui, par des
segmentations successives, constitue finalement
le corps de l ’embryon, dans lequel on distingue IV w x VI»-/ * “ J -----7 - X F . o J « . - f «
plus tard les couches emboîtées que nous con
naissons sous les noms de dermatogéne, périblème
et plérome (fig. 887).
Quand les graines contiennent plusieurs embryons,
M. Strasburger les croit formés par un
bourgeonnement adventi f de certains phytocystes
du nucelle, voisins du sommet du sac
niation de l’embryon (Strasburger).—
SS, le sommet du
nucelle; D, vésicule non fécondée
(synergique) A, le
véritable embryon, déjà formé
de quatre phytocystes ; BG,
base de la vésicule embryonnaire
fécondée, formée ici de
deux phytocystes et nommée
proembryon.
embryonnaire.
Le mode d’évolution de l’embryon, tel qu’il vient d etre établi, compoite
F ig . 1082. — Schéma des états successifs d’un embryon dicotylédoné
et d’ua embryon monocotylédoné.
dans beaucoup de Dicotylédones des modifications secondaires. La plus,
remarquable de toutes est celle que présentent les Conifères, et sur la