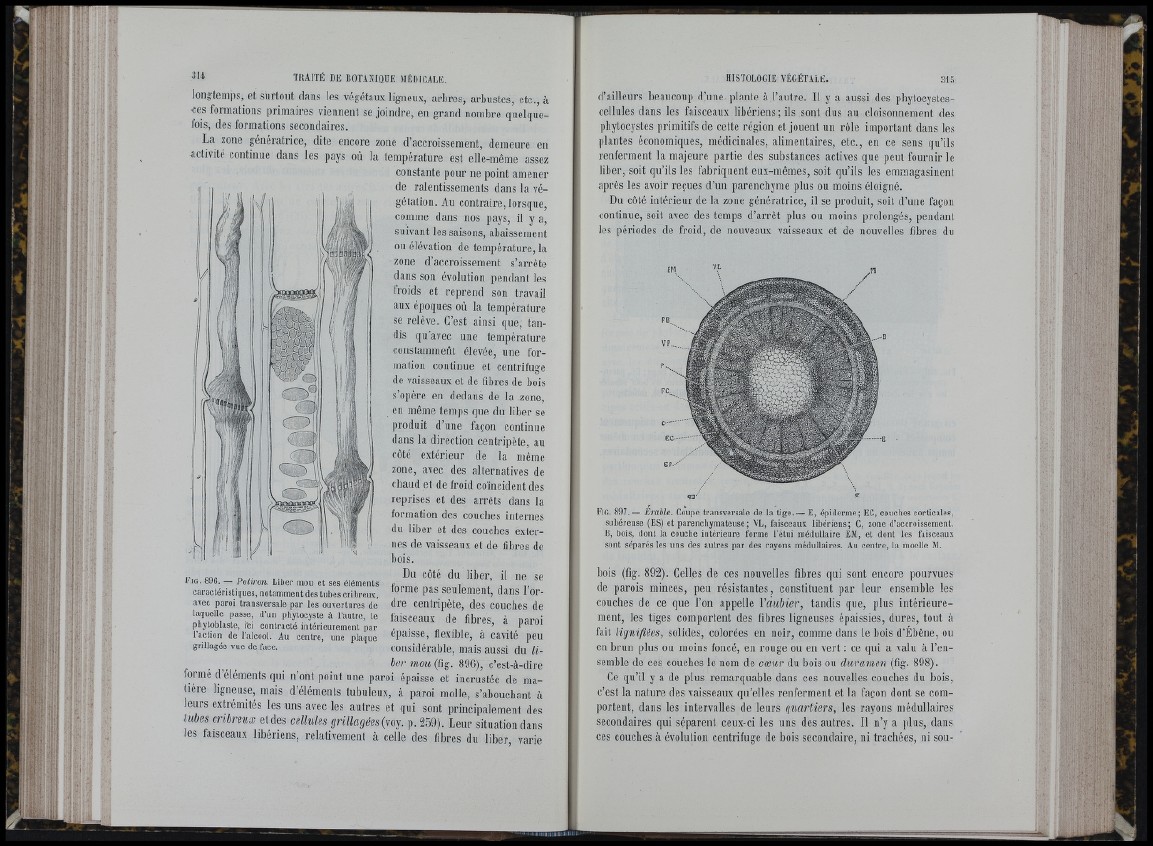
" k l I k
i
■ •’ ‘'iti
I I
'■fÎ
longtemps, et surtout dans les végétaux ligneux, arbres, arbustes, etc., à
■ces formations primaires viennent se joindre, en grand nombre quelquefois,
des formations secondaires.
La zone génératrice, dite encore zone d’accroissement, demeure en
activité continue dans les pays où la température est elle-même assez
constante pour ne point amener
de ralentissements dans la végétation.
Au contraire, lorsque,
comme dans nos pays, il y a,
suivant les saisons, abaissement
ou élévation de température, la
zone d’accroissement s’arrête
dans son évolution pendant les
froids et reprend son travail
aux époques où la température
se relève. G’est ainsi que, tandis
qu’avec une température
constamment élevée, une formation
continue et centrifuge
de vaisseaux et de fibres de bois
s’opère en dedans de la zone,
en même temps que du liber se
produit d’une façon continue
dans la direction centripète, au
côté extérieur de la même
zone, avec des alternatives de
chaud et de froid coïncident des
reprises et des arrêts dans la
formation des couches internes
du liber et des couches externes
de vaisseaux et de fibres de
bois.
Du côté du liber, il ne se
forme pas seulement, dans l ’ordre
centripète, des couches de
faisceaux de fibres, à paroi
épaisse, flexible, à cavité peu
considérable, mais aussi du liber
mou (fig. 89G), c’est-à-dire
l’ iG. 896. — Potiron. Liber mou et ses éléments
caractéristiques, notamment des tubes cribreux,
avec paroi transversale par les ouvertures de
laquelle passe, d’un phytocyste à l ’autre, le
phytoblaste, i'ci contracté intérieurement par
1 action de l ’alcool. Au centre, une plaque
grillagée vue de face.
lorme d’eléments qui n’ont point une paroi épaisse et incrustée de matière
ligneuse, mais d’éléments tubuleu.x, à paroi molle, s’abouchant à
leurs extrémités les uns avec les autres et qui sont principalement des
tubes cribreux oidos, cellules grillagées(yoy. p. 259). Leur situation dans
les faisceaux libériens, relativement à celle des fibres du liber, varie
d’ailleurs beaucoup d’une plante à l’autre. Il y a aussi des phytocystes-
cellules dans les faisceaux libériens ; ils sont dus au cloisonnement des
phytocystes primitifs de cette région et jouent un rôle important dans les
plantes économiques, médicinales, alimentaires, etc., en ce sens qu’ils
renferment la majeure partie des substances actives que peut fournir le
liber, soit qu’ils les fabriquent eux-mêmes, soit qu’ils les emmagasinent
après les avoir reçues d’un parenchyme plus ou moins éloigné.
Du côté intérieur de la zone génératrice, il se produit, soit d’une façon
continue, soit avec des temps d’arrêt plus ou moins prolongés, pendant
les périodes de froid, de nouveaux vaisseaux et de nouvelles fibres du
, B
93-'
Fig. 897.— Erable. Co'upe transversale de la tige. — E, épiderme; EG, couches corticales,
subéreuse (ES) et parenchymateuse; VL, faisceaux libériens; G, zone d’accroissement.
B, bois, dont la couche intérieure forme l’étui médullaire EM, et dont les faisceaux
sont séparés les uns des autres par des rayons médullaires. Au centre, la moelle M.
bois (fig. 892). Gelles de ces nouvelles fibres qui sont encore pourvues
de parois minces, peu résistantes, constituent par leur ensemble les
couches de ce que l’on appelle Vaubier, tandis que, plus intérieurement,
les tiges comportent des fibres ligneuses épaissies, dures, tout à
fait lignifiées, solides, colorées en noir, comme dans le bois d’Ébène, ou
en brun plus ou moins foncé, en rouge ou en vert : ce qui a valu à l’ensemble
de ces couches le nom de coeur du bois ou duramen (fig. 898).
Ge qu’il y a de plus remarquable dans ces nouvelles couches du bois,
c’est la nature des vaisseaux qu’elles renferment et la façon dont se comportent,
dans les intervalles de leurs quartiers, les rayons médullaires
secondaires qui séparent ceux-ci les uns des autres. Il n ’y a plus, dans
ces couches à évolution centrifuge de bois secondaire, ni trachées, ni sou