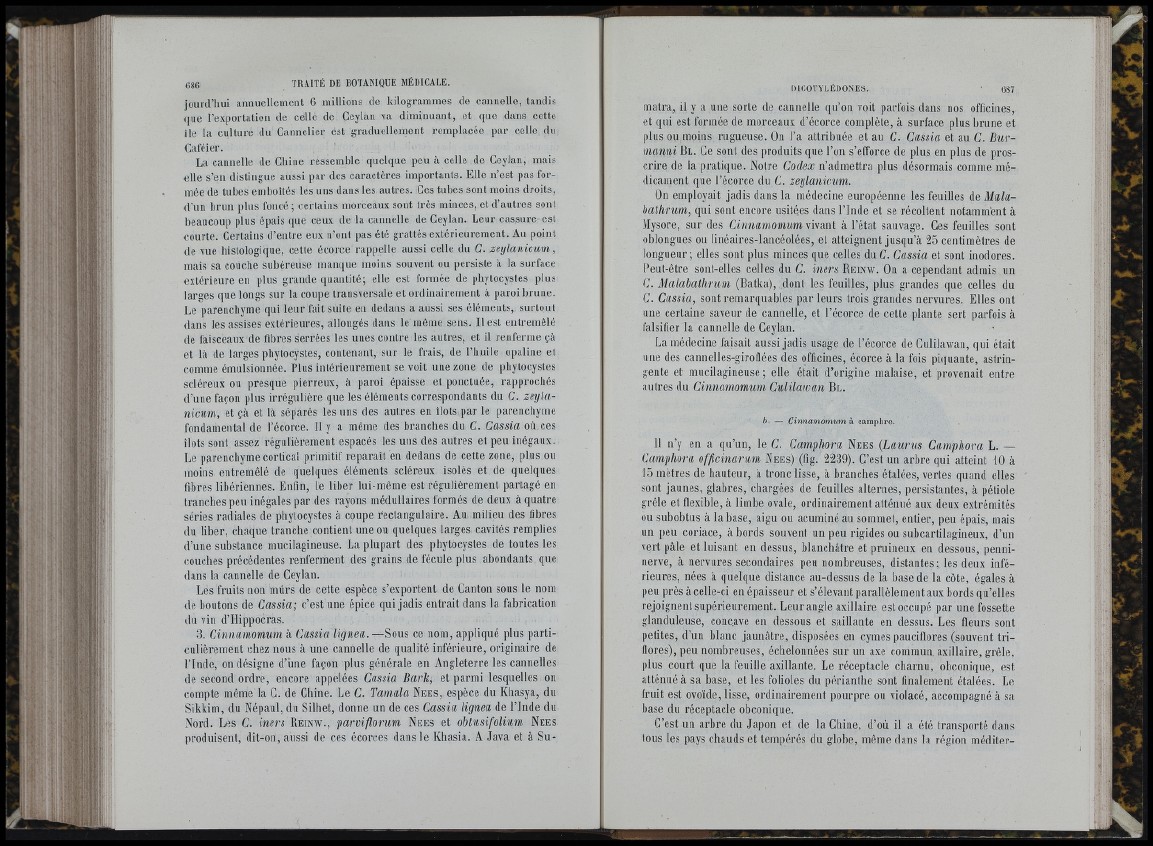
jourd’hui annuellement 6 millions de kilogrammes de cannelle, tandis
que l’exportation de celle de Ceylan va diminuant, et que dans cette
île la culture du Cannelier est graduellement remplacée par celle du
Caféier.
La cannelle de Chine ressemble quelque peu à celle de Ceylan, mais
elle s’en distingue aussi par des caractères importants. Elle n’est pas formée
de tubes emboîtés les uns dans les autres. Ces tubes sont moins droits,
d’un brun plus foncé; certains morceaux sont très minces, et d’autres sont
beaucoup plus épais que ceux de la cannelle de Ceylan. Leur cassure esl
courte. Certains d’entre eux n’ont pas été grattés extérieurement. Au point
de vue histologique, cette écorce rappelle aussi celle du C. zeylanicum,
mais sa couche subéreuse manque moins souvent ou persiste à la surface
extérieure en plus grande quantité ; elle est formée de phytocystes plus
larges que longs sur la coupe transversale et ordinairement à paroi brune.
Le parenchyme qui leur fait suite en dedans a aussi ses éléments, surtout
dans les assises extérieures, allongés dans le même sens. Il est entremêlé
de faisceaux de fibres serrées les unes contre les autres, et il renferme çà
et là de larges phytocystes, contenant, sur le frais, de l’huile opaline et
comme émulsionnée. Plus intérieurement se voit une zone de phytocystes
scléreux ou presque pierreux, à paroi épaisse et ponctuée, rapprochés
d’une façon plus irrégulière que les éléments correspondants du C. zeylanicum,
et çà et là séparés les uns des autres en îlots par le parenchyme
fondamental de Técorce. Il y a même des branches du C. Cassia où ces
îlots sont assez régulièrement espacés les nus des autres et peu inégaux.
Le parenchyme cortical primitif reparaît en dedans de cette zone, plus ou
moius entremêlé de quelques éléments scléreux isolés et de quelques
fibres libériennes. Enfin, le liber lui-même est régulièrement partagé en
tranches peu inégales par des rayons médullaires formés de deux à quatre
séries radiales de phytocystes à coupe rectangulaire. Au milieu des fibres
du liber, chaque tranche contient une ou quelques larges cavités remplies
d’une substance mucilagineuse. La plupart des phytocystes de toutes les
couches précédentes renferment des grains de fécule plus abondants que
dans la cannelle de Ceylan.
Les fruits non mûrs de cette espèce s’exportent de Canton sous le nom
de boutons de Cassia; c’est une épice qui jadis entrait dans la fabrication
du vin d’Hippocras.
3. Cinnamomum à Cassia lignea. — Sous ce nom, appliqué plus particulièrement
chez nous à une cannelle de qualité inférieure, originaire de
l’Inde, on désigne d’une façon plus générale en Angleterre les cannelles
de second ordre, encore appelées Cassia Bark, et parmi lesquelles on
compte même la C. de Chine. Le C. Tamala N e e s , espèce du Khasya, du
Sikkim, du Népaul, du Silhet, donne un de ces Cassia lignea de l’Inde du
Nord. Les C. iners R e i n w . , parvi f lorum N e e s et obtusifolium N e e s
produisent, dit-on, aussi de ces écorces dans le Khasia. A Java et à S u matra,
il y a une sorte de cannelle qu’on voit parfois dans nos officines,
et qui est formée de morceaux d’écorce complète, à surface plus brune et
plus ou moins rugueuse. On l’a attribuée et au C. Cassia et au C. B u r manni
B l . Ce sont des produits que l’on s’efforce de plus en plus de proscrire
de la pratique. Notre Codex n’admettra plus désormais comme médicament
que Técorce du C. zeylanicum.
On employait jadis dans la médecine européenne les feuilles de Mala-
bathrum, qui sont encore usitées dans TInde et se récoltent notamment à
Mysore, sur des Cinnamomum vivant à l’état sauvage. Ges feuilles sont
oblongues ou linéaires-lancéolées, el atteignent jusqu’à 25 centimètres de
longueur; elles sont plus minces que celles duC. Cassia et sont inodores.
Teut-être sont-elles celles du C. iners R e i n w . On a cependant admis un
C. Malabalhrum (Batka), dont les feuilles, plus grandes que celles du
C. Cassia, sont remarquables par leurs trois grandes nervures. Elles ont
une certaine saveur de cannelle, et Técorce de cette plante sert parfois à
falsifier la cannelle de Ceylan.
La médecine faisait aussi jadis usage de Técorce de Culilawan, qui était
une des cannelies-giroflées des officines, écorce à la fois piijuante, astringente
et mucilagineuse ; elle était d’origine malaise, et provenait entre
autres du Cinnamomum Culilawan B l .
b. — Cin n amomum à camphre.
Il n’y en a qu’un, le C. Camphora N e e s {Laurus Camphora L. —
Camphora officinarum N e e s ) (fig. 2239). C’est un arbre qui atteint 10 à
15 mètres de bauteur, à tronc lisse, à branches étalées, vertes quand elles
sont jaunes, glabres, chargées de feuilles alternes, persistantes, à pétiole
grêle et flexible, à limbe ovale, ordinairement atténué aux deux extrémités
ou subobtus à la base, aigu ou acuminé au sommet, entier, peu épais, mais
un peu coriace, à bords souvent un peu rigides ou subcartilagineux, d’un
vert pâle et luisant en dessus, blanchâtre et pruineiix en dessous, penninerve,
à nervures secondaires peu nombreuses, distantes; les deux inférieures,
nées à quelque distance au-dessus de la base de la côte, égales à
peu près à celle-ci en épaisseur et s’élevant parallèlement aux bords qu’elles
rejoignent supérieurement. Leur angle axillaire est occupé par une fossette
glanduleuse, concave en dessous et saillante en dessus. Les fleurs sont
petites, d’un blanc jaunâtre, disposées en cymes pauciflores (souvent tri-
liores), peu nombreuses, échelonnées sur un axe commun axillaire, grêle,
plus court que la feuille axillante. Le réceptacle charnu, obconique, est
atténué à sa base, et les folioles du périantbe sont finalement étalées. Le
fruit est ovoïde, lisse, ordinairement pourpre ou violacé, accompagné à sa
base dn réceptacle obconique.
G’est un arbre du Japon et de la Ghine, d’où il a été transporté dans
tous les pays chauds et tempérés du globe, même dans la région méditer